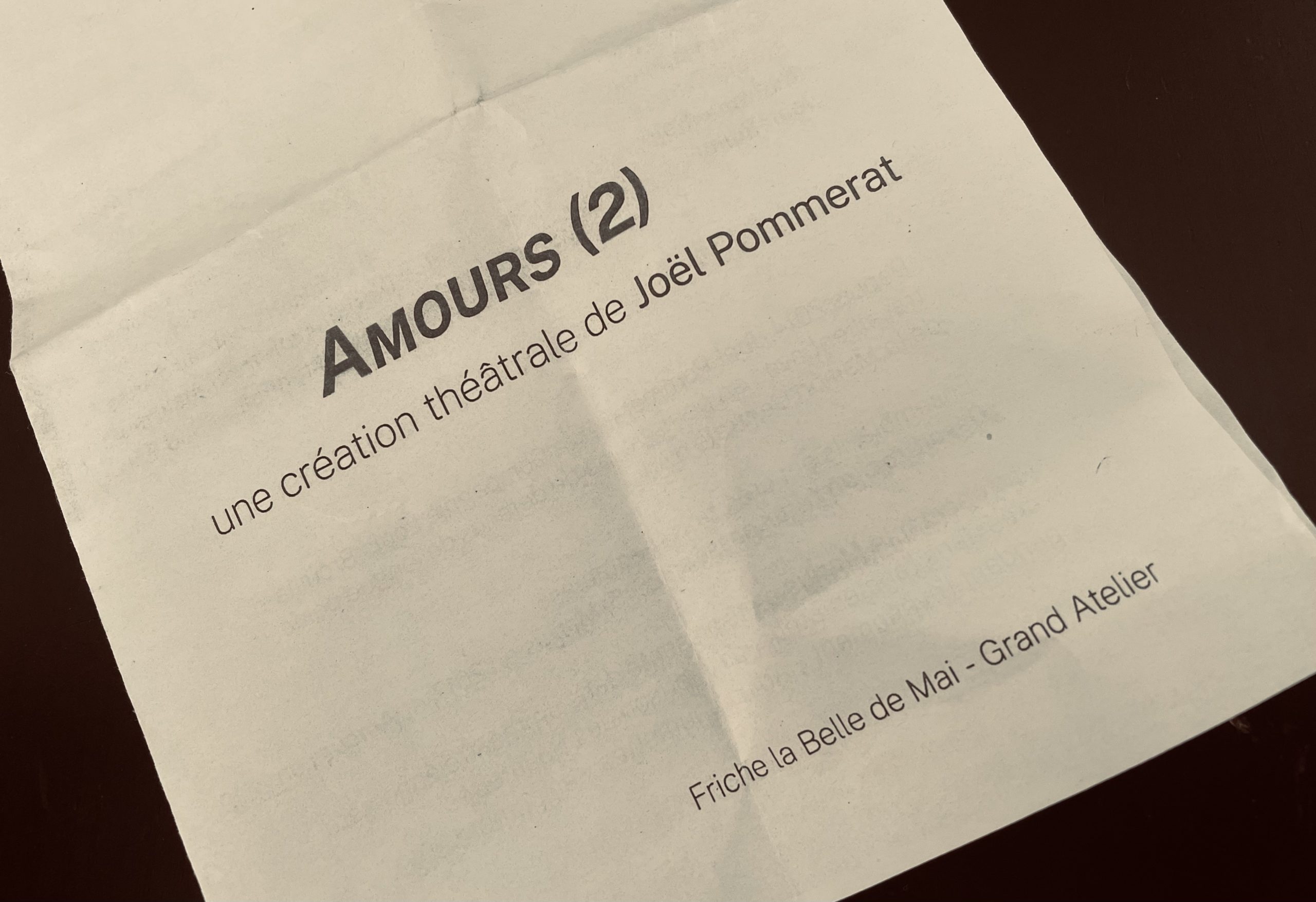
Joël Pommerat | des amours à bout portant
Par Arnaud Maïsetti
Amours (2), une création théâtrale de Joël Pommerat
Avec la collaboration artistique de Guillaume Lambert et Roxane Isnard
Avec Agnès Berthon ; Élise Douyère ; Samir Hammou ;
Roxane Isnard ; Redwane Rajel ; Jean Ruimi
Production Compagnie Louis Brouillard ;
en collaboration avec la Maison Centrale d’Arles
et la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud-Est.
Marseille, La Friche Belle de Mai, janvier 2022
S’il semble vain de parler d’amour, c’est que le mot est tant usé, tant délavé et dégradé, qu’on ne peut rien lui faire endosser qui n’ait été déjà porté, et soit sublimé soit sali. Puis, l’amour sert bien souvent à faire écran pour résoudre faussement toute l’épaisseur des liens qui unissent les êtres et mieux taire ce qui les fracture. Justement : c’est ce chemin de la complexité et des contradictions — si périlleux, mais tellement fécond — qu’emprunte Joël Pommerat dans sa dernière création, d’une beauté crue et déchirante. C’est qu’il ne s’agit pas ici de dire ce qu’il en est de l’amour, mais de traverser sa pluralité, et surtout d’observer, à hauteur d’épaules, ce qu’on ose dire en son nom qui est souvent d’une terrible violence. Plutôt que la grande scène spectaculaire, plutôt que la fable en surplomb, exemplaire et édifiante, ce sont dix fragments arrachés à son répertoire que propose Pommerat, et tout change : ainsi à l’os, l’écriture se révèle telle qu’en elle-même, cruelle et dévastatrice, drôle et irrévocable, dénudant les êtres et les révélant. Dix scènes, qui sont autant de théâtre des amours blessées où l’aveu témoigne des non-dits : dix moments ultras brefs qui désossent le spectaculaire de la scène pour jeter, dans l’intimité de la présence, mille façons d’être à l’autre et pour soi-même le visage monstrueux de l’amour comme on ne peut pas le dire.
Une heure, un peu plus : une traversée par éclats — comme le verre brisé d’un miroir. De La réunification des deux Corées (2013), Cet enfant (2005) et Cercles/Fictions (2010), Joël Pommerat s’est saisi de quelques scènes — une vingtaine, réduite ensuite à dix — tournant autour de ce qui est un thème seulement en apparence : l’amour y est à chaque fois un levier servant à soulever ce qui fonde la relation entre deux corps, deux désirs. Dix fois, on rejouera le théâtre entêtant de la déchirure : dix fois, se saisir de l’instant où tout se joue. Un théâtre par intensité successive, par déflagration.
Un père reproche à son fils la manière dont il élève son enfant, et ce fils de lui répondre, charriant des années de ressentiment, au nom de la honte éprouvée d’être celui qui s’est tu devant la violence de son père ; deux amies se souviennent de leur rencontre : l’une des deux, malgré elle, met à mort cette amitié, en rapportant combien l’autre lui paraissait arrogante alors ; une femme quitte son amant, mais sans pouvoir lui donner les raisons ; une jeune mère, incapable d’élever son enfant, l’abandonne à ses voisins, par amour… « Par amour » est toujours l’explication qu’on serait tenté paresseusement de donner aux situations aberrantes qui engagent notre désir, à nous-mêmes inconnu. À mettre à nu ces situations, Pommerat opère vivant ce désir : sans la chair des récits, sans le long développement des devenirs, des raisons, des alibis, il reste ces corps flottant dans leur existence et dérivant à bord de leur solitude. Nous-mêmes, renonçant à deviner les raisons, n’envisageons que les conséquences qui seules importent au présent : les dévastations.
Car le présent est le seul critère, le moment du danger. Il est ce lieu où se dénouent brutalement tout à la fois la crise et les individus : où l’une et les autres se libèrent au prix de la déchirure. Plus que l’amour, inconsistant et multiple, c’est bien le présent qui semble la matière avec laquelle travaillent les acteurs et le metteur en scène : ce territoire en partage, de bascule et de vérité. Théâtre en présence, c’était le titre d’un bel essai écrit par Joël Pommerat en 2007 : et c’est précisément là que tout se joue. Resterait à dire en présence de quoi, de qui ?
Aux scénographies précises et impressionnantes des spectacles de la Compagnie Louis Brouillard — spectaculaire qui en est son empreinte, sa marque —, répond ici, comme en contrepoint et en creux, une scène dépouillée, et plus encore. On est dans les entrailles de la Friche Belle de Mai, pas même dans une salle, plutôt un sas entre deux espaces, quelques néons au plafond, quatre murs qui délimitent à la fois le plateau et l’espace visible : une dizaine de chaises posées contre ces parois qui accueilleront le public, placé sur l’espace de jeu, comme à bout touchant — la parole des acteurs surgira parmi nous, assis comme nous, du même endroit du monde et pourtant ailleurs, se levant, mais comme pour prendre appui sur le théâtre, avant de le quitter, disparaître derrière les murs ou revenir s’assoir à côté de nous. Les noirs de plateau qui sont comme une signature des spectacles antérieurs ne sont obtenus qu’en éteignant les lumières, à vue. Le spectaculaire ne tient plus à l’impeccable fabrique de l’illusion, mais relève tout entier de la parole et des présences, livrées, ainsi, paumes ouvertes. Spectacle de l’intimité, pour un théâtre où l’intimité est véritablement l’enjeu, celle d’une effraction, d’une impossible formulation. Spectacle qui ne pourra être accueilli qu’hors des théâtres, mais dans de tels espaces de l’entre-deux, « pas fait pour ça », où l’indétermination du lieu appelle aux territoires multiples des scènes, à ces possibles innombrables. « Un théâtre a capella », dira l’un des acteurs lors de l’échange qui suivra le spectacle : la formule est belle qui témoigne aussi bien d’un dépouillement que d’un risque, d’un saut dans le vide et d’une libération.
Il fallait sans doute cela pour dire — dans une langue elle-même nue, mais jamais banale — l’amour, et ce qu’il en coûte, les violences qu’on inflige en son nom et qui, elles aussi, mettent à nu, font le vide. Il fallait cet espace vide pour l’emplir de toutes ces terreurs du lien, des beautés aussi de ce qui reste innommable dans ce qui noue les êtres ensemble, malgré eux. Ces amours déjouent la tentation de dire le tout de l’amour : au contraire : il fallait ce tourniquet des situations pour ne jamais épuiser ce que, sous ce mot d’amour, on désigne mal, et dont on ne fait l’épreuve que dans la tension, les choix impossibles, ceux qui désarment.
D’une scène à l’autre, théâtre(s) sans cesse déplacé(s) par le vertige qui se produit, dans le déferlement des scènes : ces amours répondent à la même dramaturgie du conflit qui libère les forces et jette les acteurs à chaque fois dans des situations intenses ou extrêmes — brutalement, les acteurs abandonnent un rôle pour un autre, exigeant d’eux tout à la fois une empathie totale et un relâchement absolu, une précision folle dans la saisie des enjeux, mais sans jamais s’appesantir ; à chaque fois, tout a eu lieu, de l’amour et de ses impasses, mais il faut tout reprendre — c’est comme s’il n’y avait jamais de leçon, que des désastres ou des reconnaissances.
Cette création, arrachée des textes antérieurs, dépouillant une certaine manière de faire du théâtre, comme s’il s’agissait d’un précipité chimique rassemblant les expériences passées, mais les réduisant à son extrême degré d’intensité et d’exigence, se saisissant de la fable seulement dans l’épreuve de feu qui en révèle les failles et les puissances, témoigne aussi d’une expérience de création. Depuis plusieurs années, Joël Pommerat intervient en Maison d’Arrêt auprès d’un groupe de théâtre fondé par un détenu, Jean Ruimi, aujourd’hui libéré. Autour de lui, et dans le compagnonnage avec le metteur en scène, s’est écrit et joué un premier spectacle — Désordre d’un futur passé, écrit par Jean Ruimi —, puis une adaptation de Marius de Pagnol, présenté au public dans la prison des Baumettes à Marseille : spectacles interprétés par les détenus eux-mêmes et travaillés au long d’ateliers au sein de la Maison centrale d’Arles. C’est dans ce cadre qu’a été élaboré Amours (2), qui fait suite à un premier Amour, déjà rêvé sur la même forme. Mais ce second Amour a fait le mur : mêlant d’anciens détenus avec des comédiennes de la compagnie, il donne à entendre, à égalité, le travail d’acteurs et d’actrices aux trajectoires multiples : c’est aussi cela qu’on entend, ces voix traversées qui se livrent au seul présent qui importe, celui qui se fonde sur l’horizontalité de l’échange.
« Ça recouvre quoi le mot « amour », alors ? Ça recouvre tout, ça ne recouvre rien ! Si on veut raconter d’une manière un peu plus fine quand même, on est obligé de prendre d’autres chemins », confiait Bernard-Marie Koltès. Amours (2) ne recouvre rien sous le mot d’« amour » des complexités qu’il engage, mais en fait le point de départ de chemins qui visent à observer les êtres et leurs contradictions, et à jouer, dans la radicale invention du présent, entre ce qui les déplace et ce qui les ouvre à eux-mêmes et à nous.
