
Pas de quartier
Le rouge éternel des coquelicots de et par François Cervantès, avec Catherine Germain, Gilgamesh Bellevillle, 5-26 juillet 2019.
« L’écriture a toujours été la colonne vertébrale de mon travail, elle préexiste au théâtre, et c’est à travers elle que j’aborde le théâtre, y compris les formes les plus corporelles ou les cultures les plus lointaines. »
François Cervantès et sa compagnie L’entreprise sont implantés depuis 2004 à la Friche la Belle de Mai à Marseille. Dans les quartiers nord, il fait un jour la rencontre de Latifa Tir qui tient un snack en face du théâtre du Merlan. Ses parents algériens ont immigré dans les années 1950. Raconter cette histoire intime et collective ne s’est pas fait à la va-vite au bout de quelques mois de résidence. C’est le fruit d’une lente imprégnation, de conversations au long cours, de la recherche d’une forme théâtrale et d’un art du récit qui soient à même de la transmettre sans l’aplatir dans une dimension exclusivement documentaire.
Le snack de Latifa est toute sa vie, un prolongement de son corps, un petit théâtre du monde en regard du petit monde du théâtre, un anglicisme qui a du mal à rivaliser avec la noblesse d’un hellénisme. L’écriture de François Cervantès tente de rétablir une porosité entre les espaces, les temporalités, les langues et les corps.
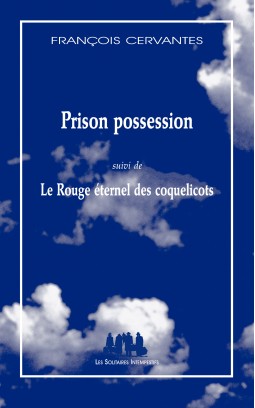
Le snack est en sursis, chantier oblige. Les gens du quartier se mobilisent, occupent l’esplanade, ne sont pas loin d’en faire une ZAD. En un renversement carnavalesque, à la fois drôle et violent, les caïds du coin s’en mêlent, mettent les décideurs face à leur promesse de le reconstruire un peu plus loin. Latifa gagne peu à peu en assurance, parvient à manier les mots comme des poings. Cette épopée minuscule, cette victoire locale, se situe à une juste distance entre la mélancolie de gauche et la croyance aux lendemains qui chantent.
Catherine Germain, que le dramaturge-metteur en scène côtoie depuis une trentaine d’années, énonce sobrement son monologue et incarne tout aussi sobrement cette femme, jusqu’à susciter paradoxalement un effet de métempsychose, d’animisme, de transmigration des âmes, une présence, comme on ressent une présence dans la nuit, spectrale. Elle nous accompagne dans une divine comédie qui revisite les morts ayant fait l’histoire des quartiers nord de Marseille, que les promoteurs immobiliers méconnaissent, terrassent, abrasent.
J’avais vu Catherine Germain, il y a longtemps, jouer Médée dans un spectacle de Laurent Fréchuret à Sartrouville, se démenant parmi des échafaudages imposants et de la musique live. Latifa est à sa façon une Médée, dépouillée des oripeaux du mythe. Cette fois, le plateau est nu : juste une petite table et une chaise de bistrot qui rendent sensible l’absence du snack à l’arrière-plan. Ce que fait Catherine Germain en solo, sa façon de se laisser posséder par un personnage qui est aussi une personne, son abondante chevelure châtain clair déployée, son visage qui devient aussi parfois un masque tragique, sa diction intériorisée qui déplie les images contenues dans les mots, les rend mentalement présentes à l’esprit des spectateurs, me semblent se tenir au plus près des recherches d’actrice que mène par exemple Valérie Dréville, elle aussi passée par Médée.
Des gestes rares et simples retrouvent l’aura communicative d’une ritualité : revêtir une perruque brune pour entrer dans la peau de Latifa, ou que Latifa entre dans sa peau, faire de son corps le réceptacle d’un corps autre, de son histoire, de son habitus, de sa parole, maintenir tranquillement ce trouble énonciatif ; fumer une cigarette et qu’apparaisse un nuage de poussière ou le fantôme du père ; ouvrir des pendillons entre le réel et l’imaginaire.
Par une rare osmose entre la silhouette, le visage de Catherine Germain et les lumières de Dominique Borrini, le temps compté du spectacle, une petite heure, atteint une durée, une consistance, une épaisseur sensible qui la dépasse : un abîme sépare l’entrée en scène de l’actrice en converses, jean évasé et tee-shirt, femme encore jeune, et le noir final qui éternise sa persona. Chacun se prête en somme à un exercice d’effacement : de François Cervantès au profit de Catherine Germain, de Catherine Germain au profit de Latifa Tir, de Latifa Tir au profit d’une fragile mémoire générationnelle qu’elle cristallise.
