
Novarina, langue vivante
L’Animal imaginaire de et par Valère Novarina, TNP de Villeurbanne, 12-21 décembre 2019.
L’Animal imaginaire est une pièce-somme qui incite à revenir sur quelques grandes lignes dessinées par l’œuvre de Novarina au fil du temps. Chez lui, la scène se renouvelle par le trou du souffleur, aussi invisible que déterminant. À la fois unique et multiple, il se dissémine dans le corps de chaque acteur. Trous ambulants et souffleurs virtuoses, trouvères anachroniques, ces corps parlants désarmeraient un anatomiste : bouche et anus semblent communiquer directement par un tuyau où passe et trépasse le souffle. Parfois, il y a fusion, « bouche excrémentielle ». Novarina n’offre pas aux acteurs des emplois, des rôles, des personnages, ni même des figures, mais des corps inouïs, puisant à la même radicalité, mais différemment, que le « corps sans organes » d’Artaud. Ses partitions requièrent un corps troué de toutes parts. On circule alors entre deux extrêmes : un corps entièrement poreux, perforé, qui finit par se confondre avec le souffle, dans un devenir aérien ; un corps tiré par le bas, burlesque, essoufflé, marionnette démantibulée, porteur christique des planches du théâtre ou cadavre animé de soubresauts sur une civière.
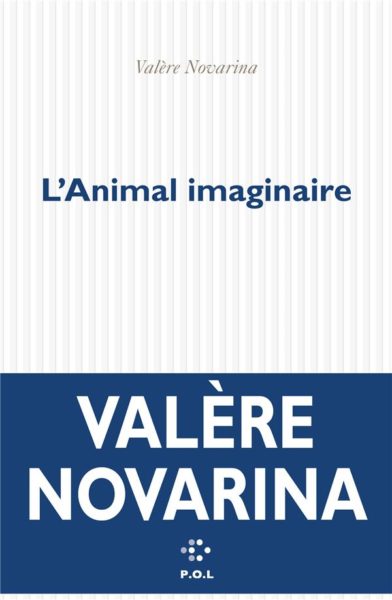
Apprendre le novarinien, passé l’étonnement ou l’agacement, ne se réduit pas à l’imiter, ni même à le pasticher ou à le parodier, c’est épouser son rapport d’étrangeté à la langue, la manier dans sa plasticité, repousser de façon épidermique les tentatives de solidification ou de simplification de la langue. Il arrive que cette neuve langue coïncidasse avec un corps et fasse mouche par la bouche, laissant derrière elle les chiures des mots usés jusqu’à la corde : syntaxe obligée, automatismes langagiers, formatages en tous genres et autres avatars de la novlangue, tout ce qui bride la malléabilité du langage, sa dialectique insoluble entre figuration et défiguration, dont l’équivalent visuel sont les peintures de Novarina, dans la lignée de l’art brut d’un Dubuffet, qui occupent la scène, que les acteurs manipulent, déplacent, agencent comme ses paroles. Le poète-dramaturge réussit cette prouesse : à force de néologismes et de zigzags et de gags et de gageures entre argot et langue châtiée du 18e siècle, les quelques mots ou tournures empruntées au langage quotidien finissent par devenir étranges à leur tour.

L’Animal imaginaire est une pièce inédite qui reprend en partie certains morceaux d’anthologie des précédentes. Novarina, qui publie depuis les années 1970, a créé non seulement son propre répertoire mais aussi et surtout un idiome, au point qu’on peut se demander qui d’autre que lui pourrait s’en emparer. Heureusement, même à la simple lecture, ses pièces procurent une expérience non moins jouissive, mais différente, que leurs versions scéniques : certaines séquences prennent du relief à la lecture alors qu’elles tombent à plat sur scène ; l’inverse est aussi vrai. Pour les spectateurs, jamais le bouche à oreille n’a été aussi nécessaire. L’idiome de Novarina, pour se transmettre à un public, ne pas tomber dans le vide ou tourner en rond, a su composer avec le cirque et le music-hall chers à Beckett. Christian Paccoud est l’animateur de cette immense Opérette imaginaire, maniant son accordéon comme un instrument à compresser ou à déployer le souffle, cette musette de Novarina. Il nous gratifie d’un solo qui épouse les nuances d’une émotion contenue valant bien « les sanglots longs / Des violons / De l’automne » (Verlaine).
Les numéros d’acrobaties langagières se succèdent, présentés par une Agnès Sourdillon accoutrée en Madame Loyal : soliloques aux airs de morceaux de bravoure ‒ Figaro et Lucky font pâle figure à côté ‒, autant de tentatives d’épuisement du langage, ou de démonstrations de sa puissance générative ; répétition-variation du récit de vie d’une Personne (Valérie Vinci) puis d’une Autre Personne (Nicolas Struve), liste de temps verbaux dont certains mériteraient d’entrer dans l’usage (« le subjonctif patient », « l’imparfait postérieur », « l’inquiétatif », « le procrastinatif », « le traumatiste », etc.), synonymes à n’en plus finir de « dit-il » merveilleusement récités par René Turquois ; mais encore, duos endiablés qui revisitent un comique moliéresque, Le Bourgeois gentilhomme en particulier, à l’instar du Galoupe-Agnès Sourdillon qui subit « la somme contre les gens et les genres » de Raymond de la Matière-Manuel Le Lièvre, le titre de la pièce rappelant pour sa part Le Malade imaginaire… On craint parfois que les acteurs, comme devant un jongleur pendant un numéro périlleux, ne butent sur un mot, aient la mémoire elle aussi trouée. On est d’autant plus impressionné par leur réussite éclatante. Plus radicalement, il arrive que l’extase éprouvée par les acteurs, via la répétition des mots ou le malaxage du matériau sonore, se communique aux spectateurs, pris littéralement de fous rires. La durée, deux heures cinquante sans entracte, est un élément essentiel de l’expérience, tissée de flux et de reflux attentionnels, ceux-ci davantage dans les moments où Novarina pontifie à sa manière sur l’homme comme animal doué de langage ou sur le mystère du verbe fait chair.

S’il y a une chose qui distingue L’Animal imaginaire des pièces précédentes, à moins de remonter au Babil des classes dangereuses (1978), c’est sa tentative d’exorciser par la satire les hantises politiques de notre époque. Tout y passe, dès qu’est soupçonné un formatage du langage et de la pensée : psychanalyse (« Votre mère est le personnage-serrure de cette histoire »), dictature des identités (la députation des « peuples » qui présentent tour à tour leurs spécificités ridiculement nationalistes), écriture inclusive (dont Raymond de la Matière opère ce diagnostic : « Ne pouvant venir à bout des contradictions du réel et du désordre de la vie, nettoyons devant notre porte : simplifions le langage »), jargon médiatique (la tirade du Grand Communicateur-Dominique Parent), philosophie de Heidegger, Badiou et consorts (« Le politique est le nom du politique politiquant, de même que le cuisine est le nom de ce qui reste, à proprement parler, de cuisinal dans la cuisine une fois tout enlevé »), emprise des algorithmes (« Delenda est mathematica ! »), etc. Quand L’Ouvrier du drame (le régisseur Richard Pierre) traverse le plateau en regrettant « Nous souffrons de ne pas avoir la parole et cependant nous ne la prenons pas », on croirait entendre Michel de Certeau sur « la prise de parole » en Mai 68. Plus inquiétante et non moins drolatique, la séquence où Sosie (Dominique Parent) égorge Autrui (Manuel Le Lièvre) avec un gros couteau de boucher, tandis qu’est chanté en chœur « L’homme n’est pas bon, nom de nom ! », ne manque pas d’évoquer les vidéos de Daech. À la fin du spectacle, aux côtés de jerricanes naufragés des banderoles gisent à terre, en attente d’être brandies. À l’instar de la présence sur scène d’Edouard Baptiste et de Bedford Valès, deux acteurs haïtiens auquel Novarina tient coûte que coûte pour leur gestuelle et leur phrasé, on y inscrirait volontiers l’adage derridien « plus d’une langue » ou le mantra deleuzien « être un étranger dans sa propre langue ».

