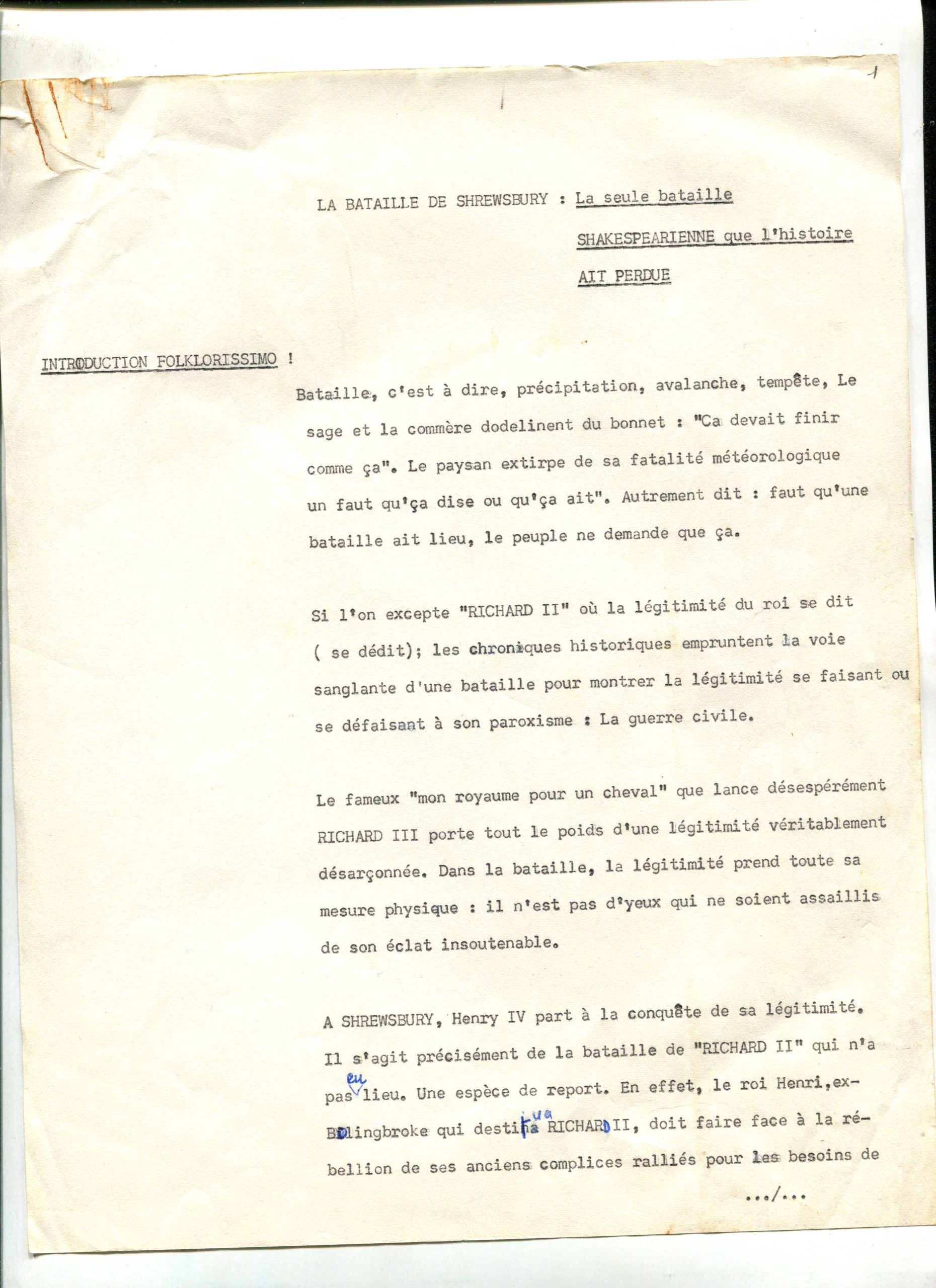
LA BATAILLE DE SHREWSBURY dans « l’Henri IV » de William Shakespeare : La seule bataille shakespearienne que l’Histoire ait perdue.
Metteur en scène, ancien conseiller jeunesse et sport, acteur, aujourd’hui Président de l’insensé, Jean-Pierre Dupuy a été également critique pour le journal Liberté Normandie dans les années 60. Il nous revenait de publier une critique inédite, de 1967, du Président…
Henri IV de W. Shakeaspeare. Nuits du Prieuré de Vivoin (Sarthe) Juillet 1967. Mise en scène : André Malartre. Décors : Christian Férré. Chorégraphie : Annette Mich. Comédiens : Michel Nicollet (Henri IV), Jean-Pierre Dupuy (prince de Galles), Falstaff (Nénesse)… et Adeline Chandebois, prostituée… Gisela Dreyer (et l’ensemble des participants du stage National d’Art Dramatique Jeunesse et Sports).
Introduction folklorissimo
« Bataille », c’est-à-dire, précipitation, avalanche, tempête… Le sage et la commère dodelinent du bonnet : « ça devait finir comme ça ». Le paysan extirpe de sa fatalité météorologique un « faut qu’ça pisse ou qu’ça pète ». Autrement dit : faut qu’une bataille ait lieu, le peuple ne demande que ça.
Si l’on excepte Richard II où la légitimité du roi se dit (se dédit) ; les chroniques historiques empruntent la voie sanglante d’une bataille pour montrer la légitimité se faisant ou se défaisant à son paroxysme : La guerre civile.
Le fameux « mon royaume pour un cheval » que lance désespérément Richard III porte tout le poids d’une légitimité véritablement désarçonnée. Dans la bataille, la légitimité prend toute sa mesure physique : il n’est pas d’yeux qui ne soient assaillis de son éclat insoutenable.
A Shrewsbury, Henry IV part à la conquête de sa légitimité. Il s’agit précisément de la bataille de Richard II qui n’a pas eu lieu. Une espèce de report. En effet, le roi Henri, ex-Bolingbroke, qui destitua Richard II, doit faire face à la rébellion de ses anciens complices ralliés pour les besoins de leur cause au Comte Mortimer que le feu-roi déchu (Richard) désigna comme son plus proche héritier. Mortimer n’est à vrai dire qu’un prétexte[1] dont Glendor, Worcester, Vernon, et Percy s’emparent allègrement pour donner à leur rébellion un blanc-seing.
Le mobile profond est à la fois politique et viscéral. Il ne s’agit rien moins que « s’emparer du pouvoir pour sauver sa peau ». Ces hommes prennent conscience que pour avoir été les complices d’un usurpateur, ils en sont restés les témoins gênants. Ils ont pénétré trop avant dans le « grand mécanisme » décrit par Jan Kott. Il ne peut plus leur échapper que leur seule tête suffirait à satisfaire l’appétit et la justice royale.
Dès les premiers tableaux la cause est entendue. L’ambition a saisi à la gorge le plus ardent des compagnons d’Henni IV, Henri Percy. Un combat à mort est engagé qui aboutira au XlIIe tableau sur le champ de bataille de Shrewsbury.
Cependant avec le dixième tableau nous sommes aux alentours de Shrewsbury. Nous assisterons aux ultimes négociations. Quel crédit faut-il accorder à ces manœuvres diplomatiques ? Si un moment Percy est tenté d’affronter en combat singulier le dauphin, c’est bien, pour que l’enjeu de toute la machination n’échappe à personne, mais trop d’intérêts se sont noués pour qu’un loyal duel les tranche. Dès lors les pourparlers deviennent suspects, ils ressemblent à la version revue et corrigée du dicton populaire « Fais croire que tu veux La paix pour mieux faire La guerre ».
A la limite un compte à rebours commence dès le dixième tableau, le heurt serait inéluctable : André Malartre jouera sur cette limite. Les négociations procèdent plus de la manœuvre tactique que d’un désir profond d’aboutir.
Il fallait du même coup montrer au public simultanément ; des chefs parlementant et des armées déjà « placées sur orbite », déjà en marche.
Ordinairement les « préparatifs » sont suggérés par la présence de quelques soldats de gabarits respectables et armés jusqu’aux dents (le couteau entre les dents). La convention fait le reste : Une armée vous habille son grand seigneur comme Courrèges sa midinette.
Le « parti-pris »[2] d’André Malartre excluait que la solution fut rapportée à l’exhibition de deux armées livrant les signes décoratifs de leurs préparatifs. Il fallait produire des signes actifs [3] et dramatiques.
On voit poindre la nécessité de mouvement-commentaires des propos tenus par les chefs. Architecture gestuelle dans laquelle pouvait s’insérer le texte. Il nous reste à décrire les moyens mis en œuvre.
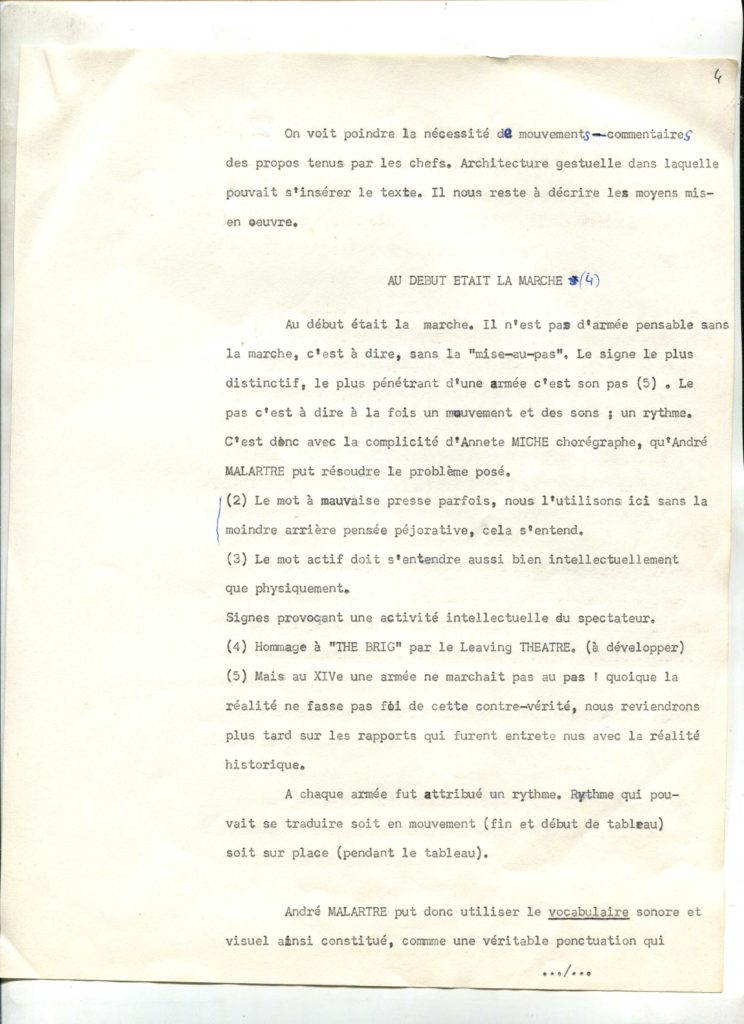
Au début de la Marche[4]
Au début était la marche. Il n’est pas d’armée pensable sans la marche ; c’est-à-dire, sans la « mise-au-pas ». Le signe le plus distinctif, le plus pénétrant d’une armée c’est son pas[5] . Le pas c’est-à-dire à la fois un mouvement et des sons ; un rythme. C’est donc avec la complicité d’Annette Miche chorégraphe qu’André Malartre put résoudre le problème posé.
A chaque armée fut attribuée un rythme. Rythme qui pouvait se traduire soit en mouvement : en début ou fin de tableau ou sur place -pendant le tableau (rythme battu).
André Malartre put donc utiliser le vocabulaire sonore et visuel ainsi constitué, comme une véritable ponctuation qui s’inscrivait dans les discours tenus par les seigneurs. Il faut y ajouter pour retrouver la notion d’architecture que nous évoquions, la marge de manœuvre offerte dans 1’occupation de l’espace scénique : chaque armée étant composée de sept à huit comédiens pouvant proposer tantôt un dessin graphique (position en ligne) tantôt une forme seulement sculpturale (position volume).
Nous avons pris note de l’activité physique des armées, il nous faut maintenant en examiner les conséquences au niveau du public et là nous parlerons activités intellectuelles, d’abord l’activité militaire, empêchait que le spectateur croie aveuglément les belles paroles des belligérants. Le spectateur était de fait en mesure d’estimer et apprécier l’art de feindre par les mots et la vacuité de leur pouvoir. Pouvoir renvoyer au seul art poétique, rhétorique du discours, oralité ; vacuité puisque les mots énoncés ne pesaient plus sur le cours des choses. Bref, des mots dans le vent mais quel vent ! nous en reparlerons (vent de l’Histoire ?)
Enfin le rythme-ponctuation s’offrant comme convention requerrait l’accord du public, accord qui impliquait une interrogation, une crédulité première qui dans le meilleur des cas aboutissait à une intelligence de la convention, et à son acceptation en tout état de cause.
Dans un deuxième temps, l’interrogation allait jusqu’à l’interprétation du signe même, du produit brut en somme. Travail de lecture. Et cette dernière opération renvoyait à une vision critique de la chose militaire.
Que l’armée soit fondée sur un système plus ou moins bien construit de conditionnements… de cela il n’est pas facile de disconvenir. Mais qu’est-ce qui qui fait véritablement une armée ? Le « civil » ! L’aptitude du « civil » à faire du jour au lendemain un bon militaire. Le service militaire est fait pour entretenir cette virtualité ; il faut donc que l’armée soit un laboratoire pavlovien. On entend le « une deux », et malgré soi, on salive !
Malgré soi : tuer !
Par conséquent l’exposition sur une scène de ces rapports de conditionnement, qui lient le civil au militaire, est occasion de distancer les dits rapports. Les mettre en crise. A condition qu’on entende bien le Théâtre comme une manifestation de civil à civil.
C’est, il me semble, une fausse évidence. On peut se donner sur scène pour les combattants sur le front culturel d’une cause politico-militaire ; on peut plus simplement entretenir très fort l’illusion du spectateur et lui faire croire qu’on est des petits soldats accessoirement comédiens.
Nous sommes arrivés à ce point de notre relation ou nous allons entrer dans le vif du combat. Une bataille sur scène pose des problèmes passionnants. Il existe de solides traditions… Reste à tenter de nous en écarter. Mais pour innover, il n’en faut pas moins passer par les filières classiques. Les garder en références. Au principal nous retiendrons deux types de procédés.
« Pauvre soldat, pauvre misère » La guerre, la peur, les tripes. Le cœur qui saigne : arènes sanglantes. Comme chante Jacques Brel, « c’est l’heure où les anglaises se prennent pour Montherlant ». Donc, du spectateur, hâtons la larme. On s’appuie sur le processus éprouvé de l’identification. Application calculée de la douche écossaise ; le comédien joue la dialectique peur-courage dont la résolution finale donne le produit recherché et apprécié : l’héroïsme… Mort ou vivant celui qui échappe au massacre devient héros (voir la psychologie des anciens combattants).
Mais au demeurant quelque mort bien jouée donne à l’héroïsme tout son prix. Le spectateur bat le rappel de ses émois, en équilibre entre l’apitoiement et la jouissance. Que l’on ne s’y trompe pas, une telle recette a encore ses champions. Metteur en scène -Renard pour public – Corbeau. Mais la fable, malgré tout commence à en être connue et usée et nous voyons plus souvent l’identification passer du sentiment à la raison et la bataille devenir un exposé stratégique. C’est là le deuxième type de procédé auquel nous faisons allusion tout à l’heure.
« Mon capitaine »
La guerre, la ruse, l’intelligence ; l’esprit qui calcule, cartes d’État-Major, comme chante encore notre J. Brel « C’est l’heure où les Anglaises se prennent pour Wellington ». Abandonnons le soldat avec lequel l’identification vole bas, et cueillons au Walhalla des génies militaires source d’une plus noble inspiration.
Qui garde la tête froide au cœur du combat ? L’état -major, mon capitaine ! La stratégie nous tient. On joue du comédien comme du soldat de plomb. Le tout aux couleurs du temps et nous avons l’appellation contrôlée « cape et épée », à moins que sous l’égide du cinéma, nous n’options pour le côté « western ». Il est vrai que le français est friand de livres d’histoire. La bataille est donc historique et son degré stratégique la situe dans le temps.
Nous avons évoqué deux procédés non pour le plaisir d’en déplorer les facilités, mais bien parce que la bataille de Shrewsbury revisitée par Shakespeare, fut, par certains de ses aspects, un étrange événement, étrange et étonnant. Une bataille certes, mais mal fagotée. Digne de ce nom ? à VOIR ! Retour sur stratégie.
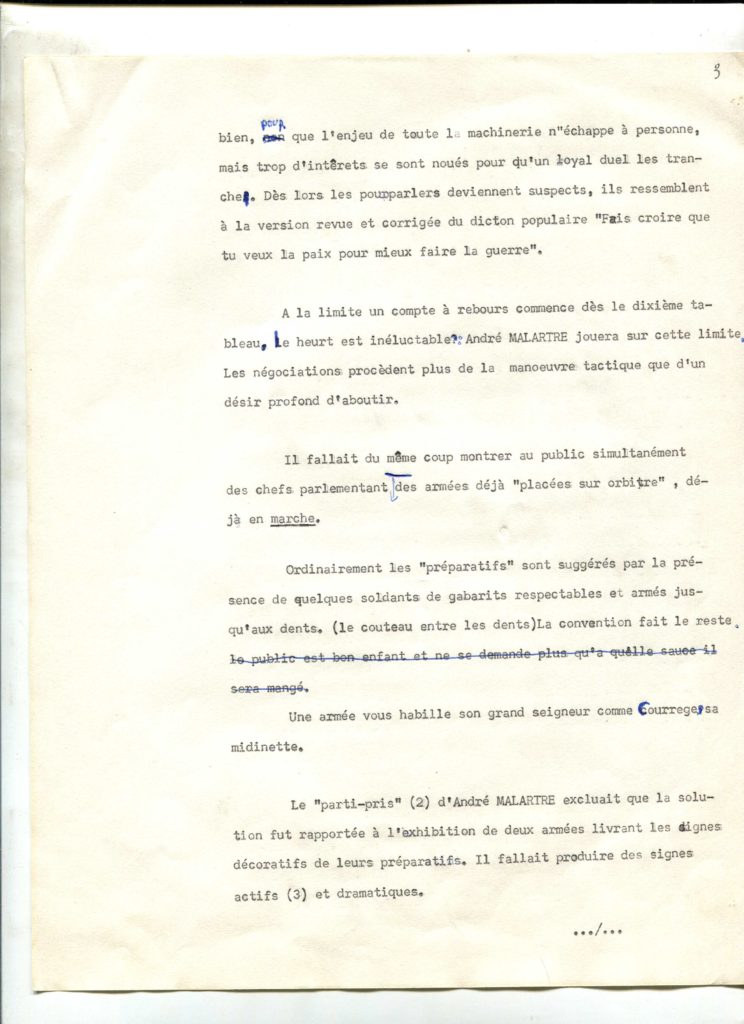
« Du football américain »
Les historiens confirment. Il y a une « vraie » bataille de Shrewsbury. Qu’a-t-elle pu être, à quoi a-t-elle ressemblé ?
Nous sommes, au XVe siècle naissant ? Il parait à peu près certain qu’un compte-rendu visuel, photographique de la « vraie » bataille serait aussi déconcertant qu’invraisemblable. On peut en appeler à une séquence extraordinaire du « Falstaff » d’Orson Wells qui nous montre la mise en selle des chevaliers sur leurs destriers à la limite de l’imaginable, tellement c’est compliqué et laborieux… Monuments d’handicap physique. Invraisemblable !
A la limite du concevable, voilà où il faut se tenir pour se faire une idée possible d’une bataille en ces temps-là.
Le seul cinéma peut donner cette idée par les moyens réaliste (et encore !) mais sur un plateau de théâtre ? Il faut transposer et une transposition dépassant l’imagination. Par exemple, mettre en scène les figures d’un match de Rugby. C’est sur cette idée que s’est construite la représentation de la bataille de Shrewsbury, doublée de ce qu’une rencontre sportive peut être une bataille sublimée.
Le décorateur Christian Ferre poussera l’idée jusqu’en ses limites et nous pouvons à l’instar des critiques parler de stock-cars ou de football américain.
Identification out ! Shrewsbury football américain vaut comme sport inconnu et énigmatique quant à ses modalités, par contre la violence en est très perceptible et extrême. Si l’on s’interroge sur la position du spectateur devant un tel rapport à lui imposé, on s’aperçoit que l’originalité du parti-pris exclut l’identification et renvoie l’observateur à une réflexion critique. Il n’apprécie plus Shrewsbury, en tant que document sur l’art militaire mais, il s’étonne et s’accommode d’un fait visuel original qui lui donne une idée « poétique » d’un fait historique inaccessible ! Une proposition qu’il accepte ou réfute en s’offrant une capacité d’y croire… En quoi se reconnait le pari et le risque entretenus par le metteur en scène. Contrat poétique. Mais ce n’était pas là peu s’en faut le seul propos de la bataille.
Elle était construite à trois niveaux dans l’ordre où nous les exposerons : « les soldats, les seigneurs, Falstaff ». Trois niveaux de perception comme trois points de vue.
Dans une première phase, les deux armées tuaient, et étalaient aux yeux du public un récital de gestes sanglants. Dans une seconde phase, les deux armées couraient dans le même sens, fuite-poursuite affolante, ronde infernale : qui fuyait ? qui chassait ? C’était là une citation fulgurante de la dialectique peur-courage. Mais on voit bien qu’ici, il n’était pas possible de la vivre, mais seulement de la percevoir.
Enfin la bataille (des soldats) se terminait brusquement par une chute générale. Écho du geste mécanique de tuer, la mort systématique. Le soldat meurt sans avoir rien compris. Pour reprendre Jan Kott, il ne crée pas l’histoire, il en est victime.
La lumière n’était évidemment pas absente des débats ? Souple dynamique, violente elle découpait l’espace scénique suivant une architecture baroque d’ombres et de lumières. Violente, elle giclait comme l’éclat d’une lame fouillant les entrailles du monstre bataille. Elle donnait un climat hallucinant voir fantastique. Elle donnait le temps, la durée, en la circonstance ni le jour ni la nuit, elle transportait Shrewsbury hors du temps, hors de toute date Futuriste. Bataille qui nous attend !
En contre-point, le son-bruitage était construit sur une cacophonie métallique. C’était l’intervention sonore du fer absent de la décoration et des costumes. A nouveau, nous trouvions devant une citation suggestive qui, elle, fixait la bataille en son temps. Ces allées et retours incessants du jour d’aujourd’hui aux jours d’hier nous paraissent propre à fixer la modernité de l’œuvre : actualisation justifiée parce que non abstraite. Il s’agit plutôt de ce que Jean Duvignaud appelle « un imaginaire qui cherche sa réalité ».
André Malartre a offert au public une bataille imaginaire qui cherchait sa réalité. Et je la crois pour ma part plus vraie, plus proche du réel que n’importe quel montage ou reportage théâtral sur les conflits de l’heure.
« Le soldat »
Le soldat-type portait collant, chasuble, cagoule noire, cuirasse, casque, botte et bouclier. Le tout le rendait non-identifiable. La gamme des gestes et mouvements qui lui étaient possibles, étaient restreints. Par exemple, il ne pouvait pas se relever seul d’une chute. Son champ de visibilité s’inscrivait dans la ligne droite. Le comédien éprouvait son équipement comme une prison. Il devenait son corps au moment où l’observateur ne percevait plus l’humanité du corps.
Christian Ferre usa de deux matières modernes pour la confection du matériel : cuirasse, casque, bouclier en polyester, bottes en vinyle, ce qui plus est, il rendit évident l’usage de ces matières. Ainsi les armures ne furent pas maquillées en trompe l’œil, mais peintes de couleurs vives : le luisant qui en résultait provoquaient une affiliation directe à la carrosserie tapageuse des bolides de formule I (monoplace). Le rouge et noir des royalistes faisaient pendant au bleu bouton d’or des rebelles, (couleurs empruntées à la mythologie du sport). Les armes étaient réduites à un signe : bâtons de bois peints aux mêmes couleurs que les armures. D’ailleurs les soldats ne s’entretuaient pas… mais disant cela nous empruntons déjà aux desseins de la chorégraphe.
Au début, à la fin du tableau XIII, les soldats sont en action constante. Ballet au temps fort ou faible, selon ce qui se dit et fait par ailleurs sur le plateau, chaque armée ayant reçu son répertoire de geste-vocabulaire s’ajoutant aux rythmes déjà évoqués. Les deux armées ne se rencontraient pas (au sens classique du terme) C’est à dire qu’il n’y avait pas réponse de l’une à l’autre[6] (style coup par coup). Plutôt, donc dialogue de sourds, chacune parlant sa langue propre. Nous retrouvons dans cet aveuglement une caractéristique du football américain qui est un sport où la tactique, outre qu’elle distancie la stratégie moderne qui fait la part de l’improvisé, renvoie à l’idée de conditionnement. Le soldat est ainsi une machine à tuer. Il tue, systématiquement et aveuglément.
La perte d’identité
Nous avons dit « modernité », développons. Les costumes des soldats dérobaient au public leur identité. L’absence de rencontres confirmait l’opération. L’emploi des matières concrétisait une volonté d’éliminer l’homme, de le tuer dans l’œuf. Absence d’identité sur signifiée. Mort de l’identité et de la personne[7]. C’est que les guerres d’aujourd’hui sont gagnées et perdues par le soldat inconnu. Invention sublime, apothéose de la boucherie moderne : l’institution prospère du soldat inconnu.
Écoutons ce qu’en dit Roger Caillois qui évoque la naissance du mythe. L’anonymat de la façon la plus significative et la plus conséquente, devient un titre de gloire ; et la bravoure, l’initiative, l’audace, l’abnégation de chacun des plus braves, s’inscrivirent dans chaque pays au bénéfice d’un malheureux être qui fut peut-être pacifique et peut-être craintif, mais qui avait l’avantage de n’être plus personne : d’avoir été consommé plus complètement qu’un autre et d’avoir donné jusqu’à son identité.
Pour donner son identité au théâtre, il faut supprimer tout signe de reconnaissance. Quand le spectateur ne reconnaît plus l’homme sous le masque : le jeu est tronqué, le spectateur frustré[8]. Il nous a paru intéressant de provoquer cette frustration. Par ce biais le spectateur est mis « hors de lui », hors de ses références. Il ne peut plus exercer sur cette bataille le jeu des références morales et esthétiques qui constituent plus ou moins consciemment son acceptation de la guerre.
Il considère donc, l’espace d’in instant, que cette bataille l’exclut, exclut la personne, donc sa personne, ceci quel que soit son degré de participation. Mais le spectateur n’était pas sans recours, nous verrons maintenant avec les combats des seigneurs, comment il pouvait s’évader. Fausse évasion bien entendu.
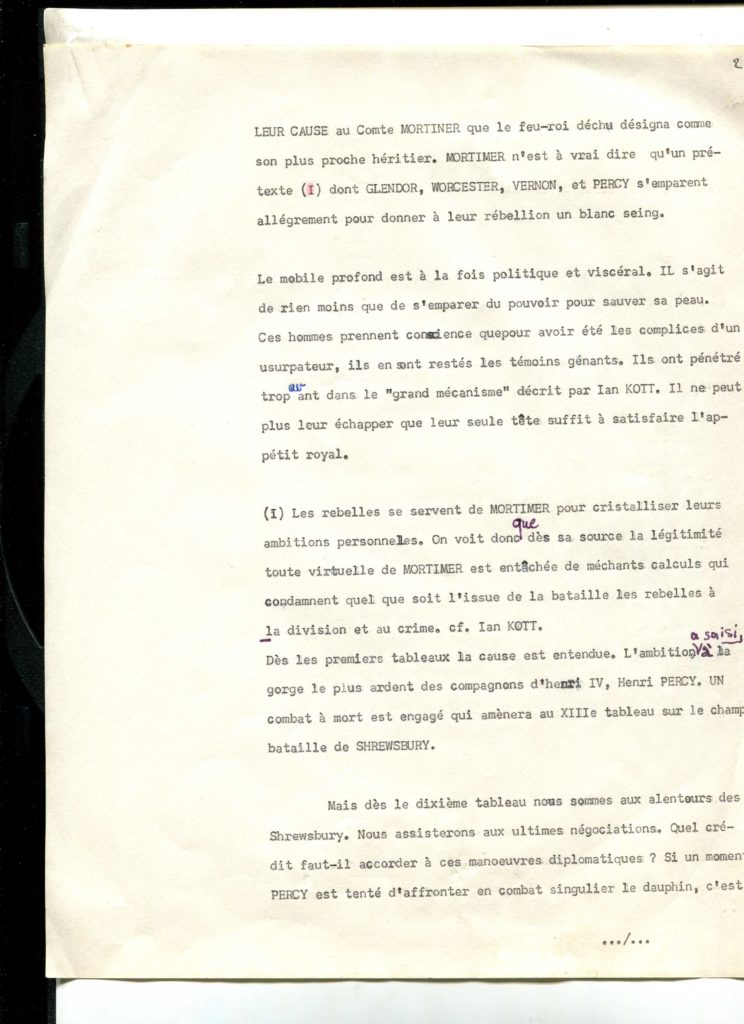
Au héros moderne : le seigneur connu et reconnu
Du soldat anonyme nous passons au seigneur. Il est identifiable. Mais là encore plus que cela : sur-identifiable. Identité sur signifiée ! En effet, chaque seigneur portait sur son armure soit sa lettre initiale (style de super nom) soit un symbole. Citation toujours. Portant cette fois-ci sur le goût contemporain pour le héros. Si l’anonymat glorifiait le simple soldat, la sur identification des seigneurs les rendait immortels, célestes, quasi divins. Autre modalité les rendant inhumains à certains égards… et on note à nouveau une exclusion de l’homme, de la personne au profit cette fois-ci, du mythe. Perceptible au second degré, il pouvait donc sembler au spectateur qu’il trouverait là ce que la soldatesque n’offrait pas. D’exclusion en exclusion nous arriverons tout doucement à Falstaff… mais n’anticipons point. Le tableau XIII est en fait constitué tout entier par les duels des seigneurs et les commentaires de Falstaff.
Ces duels, André Malartre les régla dans un couloir situé en avant-scène. Les seigneurs livraient un tournoi. Étaient dessinés implicitement une lice, un champ clos (d’honneur ?)… Devant, derrière, autour de ce champ, les soldats évoluaient. Ils ne constituaient pas une simple toile de fond, ambiante. Ils disposaient du plateau, le tenaient. En fait la masse « soldat » troublait quelque peu le rituel des duels. Chaque seigneur plaçait sa tirade sur l’honneur. Honneur qui visiblement ne concernait pas les soldats. L’honneur n’était donc que l’affaire personnelle de quelques privilégiés. L’honneur qui s’identifie. Au bout du compte, un carnage pour permettre aux seigneurs d’exister, de jouer le jeu des héros. Il en coûte cher et chair en viande d’avoir des héros désincarnés !
Nous avions donc bataille dans la bataille, et inscrit de l’une à l’autre un rapport critique de l’idéologie guerrière. D’ailleurs le spectateur ne pouvait pas se payer d’illusions sur les échanges verbaux des seigneurs. Les proclamations étaient lancées avec force et violence … et les mots procédaient alors plus de l’armement que du langage. Ils tombaient comme coups d’épée sur l’adversaire[9]
Falstaff : Le grand tout
Enfin l’heure de Falstaff est venue, venue d’ailleurs bien avant la bataille même. Toute la construction vient s’anéantir, s’éclairer, vivre et mourir dans Falstaff et confirmer l’opinion que Jan Kott a de la pièce : « Dans les deux Richrd et les autres Henry, l’histoire est l’unique dramatis persona. Tandis que dans Henri IV, le héros est Falstaff ».
Résumons-nous. Une bataille anonyme nie et éclaire une bataille personnelle. Accordons que cette dernière l’emporte dans l’esprit du spectateur. Triomphe de courte durée, il vient achopper sur les commentaires d’un HOMME, le seul homme véritablement présent, Falstaff.
Nous avons exposé des forces antagonistes, qui ne sont pas la soustraction, produit de la rivalité de deux camps, mais les contradictions de deux termes (de deux classes si l’on préfère) Seigneurs-Soldat. Le produit affronte un individu, carrefour de tous les calculs, auxquels il va donner un sens personnel. L’opération est gigantesque, à la mesure du personnage. Falstaff fait le poids.
Un simple soldat – Falstaff – défend une éthique dans l’une des scènes les plus fortes de la pièce. Il dira présentant ses recrues : « Eh bien quoi ! Ils sont assez bons pour se faire trouer la peau. Chair à canon ! Ils rempliront une fosse aussi bien que des troupes d’élite ; des hommes mortels, mon cher, des hommes mortels ! »
Quant aux seigneurs, il leur réserve son magistral plaidoyer sur l’honneur. Il intervient au tableau XI citons :
« Alors, qu’est-ce que l’honneur ? un mot. Qu’est-ce qu’un mot ? du vent. Oui, tout cela se tient jusqu’à présent. Où se cultive l’honneur ? Au champ d’honneur. Qu’est-ce que le champ d’honneur ? C’est la terre des morts. Est-ce que les morts apprécient cet honneur ? NON. Le voient-ils, le touchent-ils, l’entendent-ils ? Donc, l’honneur chez un mort, ça n’existe pas. Et chez un vivant est-ce qu’il existe ? Peut-être. Qui le reconnaît ? Personne. Dans ces conditions-là je n’en veux pas. L’honneur est un grand vide en forme d’écusson. Ainsi finit mon catéchisme » Ainsi parla Falstaff.
Il y a donc confrontation de tous les instants entre Falstaff et les éléments constitutifs de la bataille. Or Falstaff y est mêlé. Non point en tant que participant, puisqu’il prétexte la peur, pour n’y jouer aucun rôle. Il devient donc un observateur-critique du carnage. Pour le confirmer dans cette position le décorateur l’habilla de cuir, matière humaine par opposition au polyester. Falstaff gardant tout son caractère humain, distanciant par là-même la bataille. Il n’est même plus nécessaire d’appuyer sur la peur qu’il en éprouve, et de lui imposer une partie de cache-cache. André Malartre installa résolument le héros dans une fonction médiane entre le public (voir parmi le public) et la scène.
Que Shakespeare ait une chaude sympathie pour le coquin, la chose n’est pas douteuse. La langue que parle Falstaff est du meilleur cru, Shakespeare a plaisir à parler par sa voix et à partager avec lui son goût du verbe.
Falstaff est taillé, configuré pour parler de la bataille, la raconter. Verve du verbe. Son art est là, et n’est pas de se battre.
Revanche du poème sur l’histoire ? Rappelons-nous « Qu’est-ce que l’honneur ? un mot, qu’est-ce qu’un mot ? du vent ! ». Et pourtant, paradoxe, c’est avec ses mots, son art poétique, que Falstaff/Shakespeare rend tout le remue-ménage historique, dérisoire. Les seigneurs qui se battent n’ont qu’un mot à la bouche : l’honneur ! Falstaff annule leur verbe (étroitement lié à leur bataille) par son verbe ! Il y a vent et vent !
Ainsi donc l’homme rond triomphe, et avec lui, le public. Mais ce dernier boira le calice jusqu’à la lie et le spectateur avec lui. Ultime et sordide pirouette. La bataille se termine sur le geste ignoble d’un Falstaff[10] éventrant un cadavre. Tuant un mort. Il pourra raconter qu’il a tué son homme ! Le spectateur choisit : pour s’entendre raconter des histoires et reconnaître « son » histoire, il faut passer par les bas-fonds ou subir la parole des seigneurs… du pouvoir !
Mais le spectateur-lambda a trop abusé des bons offices de Falstaff, il a trop cru, s’en sortir et tirer son épingle du jeu avec la complicité du ladre…, il lui faut avaler le poisson avec les arrêtes !
C’est donc la revanche du poème avec ce qu’il en coûte au poème d’exister !
Il faudrait parler plus longuement des rapports du public à Falstaff, mais nous aurions alors à déborder du cadre que nous nous sommes fixés.
La confrontation poésie-histoire n’est-elle pas au bout du compte, la confrontation de Shakespeare à son propre système de pensée, à son usage de la langue ; confrontation de la manière et du fond, de l’apparence (mot-vent) et du réel.
C’est là, si on le veut bien le moteur dramatique de cet Henri IV. Falstaff disparaîtra, et avec lui la toute provisoire revanche du poète et l’histoire continuera à tourmenter la terre et l’humanité comme elle a toujours fait.
Jean-Pierre Dupuy Aout-Septembre 1967
[1] Les rebelles se servent de Mortimer pour cristalliser leurs ambitions personnelles. On voit donc, que dès sa source, la légitimité toute virtuelle de Mortimer est entachée de méchants calculs qui condamnent quelle que soit l’issue de la bataille, les rebelles à la division et au crime » cf. Jan Kott.
[2] Le mot à mauvaise presse parfois, nous l’utilisons ici sans la moindre arrière-pensée péjorative, cela s’entend.
[3] Le mot actif doit être compris aussi bien intellectuellement que physiquement. Signes provoquant une activité intellectuelle du spectateur.
[4] Leçon retenue du « THE BRIG » du Living theater qui éclaire les modes de conditionnements sophistiqués et irrésistibles de toute machine militaire.
[5] On objectera qu’au XIVe siècle qu’une armée ne marchait pas au pas ! Quoique la réalité historique n’en soit pas établie… Se pose la question des rapports du théâtre et de ses conventions avec la réalité historique. Rapports complexes entre un art et une activité d’ordre ou de prétention scientifique (l’Histoire).
[6] Ainsi, on ne peut plus considérer tout à fait la bataille sous l’angle rencontre sportive. La conséquence en est l’impossibilité pour le spectateur de s’identifier à un supporter.
[7] Personne au sens de l’humanisme chrétien.
[8] Savoir qu’une main, un doigt… suffisent à rendre l’identité présente sur une scène.
[9] N-B. Interviewé après spectacle, un spectateur dira crument qu’il a apprécié les combats des seigneurs parce qu’il les reconnaissait (c’est le mot employé) et que par contre les soldats lui paraissaient confus voir gênants !
[10] N-B. Impossible avec la figure de Falstaff d’ignorer l’origine du théâtre qui se développe avec la figure de « Ruzante » d’Angelo Beolco. Notamment le rapprochement est inévitable avec « Ruzante revient de guerre ».
