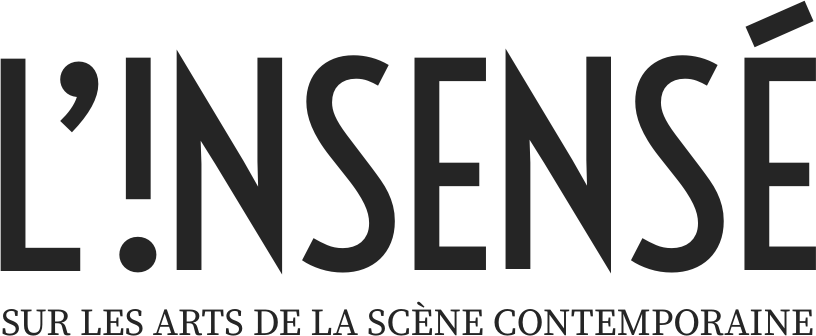Par autan : angoisse et bourrasques
Par autan de François Tanguy et le Théâtre du Radeau, Festival d’Avignon, 12-14 juillet 2025
Un mot pour commencer sur le surtitrage en anglais de Par autan, diffusé sur deux écrans côté jardin et côté cour, et qui enserre le plateau : pourquoi pas en arabe, langue officiellement invitée au Festival cette année par son directeur Tiago Rodrigues ? Non, actons plutôt l’hégémonie économique, militaire, politique et culturelle des US de Trump. Passons au filtre réducteur de la langue véhiculaire mondialisée le babélisme assumé de ce spectacle, comme de tout spectacle de Tanguy, disparu en décembre 2022, et du Radeau. Oublions leur compagnonnage au long cours avec les traducteurs d’œuvres en langues doublement étrangères : parce que dans d’autres langues que françaises, parce que langues de poètes. Faisons fi de l’amitié élective avec André Markowicz et Françoise Morvan, traducteurs de Tchekhov et Dostoïevski, qui font entendre une autre langue russe que celle, brutalisée, de Poutine. Restons sourds à un poème de Góngora, à une chanson de Mendelssohn, aux fragments de Shakespeare, de Kleist et de Tchekhov, prononcés dans leurs langues respectives d’origine, volontairement laissés sans traduction ‒ peut-être pour rappeler l’intraduisible, et frayer un accès au sens par le sensible.
À la Fonderie au Mans, bâtiment industriel investi par le Radeau depuis les années 1980, le maître mot est l’hospitalité. Sur les gradins du gymnase du lycée Mistral, chaque siège en plastique a été conçu pour concentrer le plus de consommateurs de spectacles possible dans le moins d’espace disponible. Tout est fait pour indisposer le public face à ce qui ne cherche justement pas à s’imposer, et qui paraît tellement isolé dans la programmation : fragilité du poème dramatique aujourd’hui, à l’image des scénographies de Tanguy qui font signe vers les baraquements forains. Ce n’est donc pas de spectacle et de public qu’il faudrait parler, mais d’un rapport de singularité à singularité.

Il y a un langage Tanguy, côtoyé pour ma part depuis Onzième (2011), et dont on retrouve dans Par autan les rudiments : barbes et ventres postiches, chapeaux melon, perruques ancien régime, costumes d’antan, chaises en formica, châssis et tableaux, portes, parois et verrières coulissantes, animaux empaillés, vielles lampes… travail de couture ou de montage des fragments d’une bibliothèque et d’une discothèque… enchaînement de gestes, de mouvements et de stases… dans lequel se fond burlesquement l’équipage Frode Bjørnstad, Samuel Boré, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly et Anaïs Muller.
Travail de couture ou de montage d’un spectacle à l’autre, tout autant : Item (2019) se terminait par une chanson murmurée en chœur par les comédiens réunis autour d’une table, dans une lumière au ton clair-obscur, un petit rideau de dentelle frémissant sous l’effet de l’air, côté cour. Comme une ritournelle habitée par une angoisse qu’elle tentait pourtant de dissiper. Ce pouvait être des forains autour d’un feu de camp en rase campagne. La chanson allemande évoquait une femme en chemise, tête rasée, pancarte Judenhure au cou, à Nuremberg, dans les années 1930. Le petit rideau de dentelle frémissait pendant la chanson mélancolique. On pouvait ne pas y prêter attention, ou bien se souvenir du léger rideau rouge voletant lui aussi dans la Bérénice (1984) de Grüber et Aillaud…
Avec Par autan, le vent s’engouffre : vent du Haut-Languedoc et de l’ouest de la Montagne Noire et des Corbières, redouté, violent, annonciateur d’orages. Mais le dernier spectacle de Tanguy est plutôt le lieu d’un double mouvement contradictoire. D’un côté, jamais peut-être il n’aura autant été étreint par l’angoisse, celle qui vous serre la gorge, soustrait l’oxygène, amenuise le possible. Dès l’ouverture, via les mots de Robert Walser, Laurence Chable avertit : « En quel temps sommes-nous donc, qui voit des artistes jetées aux lions, à côté d’une chaîne qui cliquette, devant une épée qui soupire, en compagnie de gens qui ont l’idée saugrenue d’habiter dans des caisses en fer ? » Version plus adaptée au Radeau que la formule de Hölderlin « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? ». Il s’agit pourtant du même cri d’alarme, derrière la pudeur du burlesque. À l’autre extrémité du spectacle, on entend cette rengaine d’une cantatrice (Martine Dupé) sortie de La Noce de Tchekhov : « Éventez-moi, éventez », « J’étouffe ! Donnez-moi de l’atmosphère ! » Là encore, sous couvert de comédie, l’angoisse. Entretemps, on déplie une cruelle scène d’exécution arbitraire, tirée de Richard III : « Est-ce qu’on vous a choisis parmi la multitude des hommes pour égorger l’innocent ? Quel est mon crime ? Quelle est la preuve qui m’accuse ? Quel jury légal a transmis son verdict au juge sourcilleux ? » Et chaque exécutant de faire taire le « petit fond de conscience » qui lui reste en pensant à la « récompense » attendue. Entretemps, on se retrouve aussi coincé dans l’impasse des faux dilemmes, des oppositions binaires : « le particulier et le général » (Kafka, Journal), prononcé comiquement à l’allemande par Erik Gerken, ou encore « le héros tragique » vs « le chevalier de la foi » (Kierkegaard, Crainte et tremblement).

Dès lors, comment desserrer l’angoisse ? Par l’autan. C’est le deuxième mouvement, celui-ci d’ouverture, de soulèvement, plutôt que de constriction, de chute. Les bourrasques ne sont pas ici des ennemies. Elles animent le plateau, le désencombrent, le métamorphosent à vue d’œil en Radeau : bruits de tangage, de poulies, craquements de bois, grincements de cordage, planches qui basculent, rideaux-voiles-linceuls soulevés par la force du vent qui souffle depuis la coulisse, comédiens qui luttent pour avancer ‒ peu aidés par leurs défroques et leurs accessoires. Le début du spectacle est ponctué par la « réclame » qu’un habitué des lieux (Vincent Joly) fait du « Cabaret de la Montagne » (Robert Walser, Les Rédactions de Fritz Kocher), qui pourrait servir de refuge par gros temps, un peu comme la Fonderie au Mans l’a été, l’est encore, pour des artistes exilés, de la Bosnie à Gaza en passant par la Russie. Beaucoup plus tard, un « général authentique, majestueux, comme ça, vieux, dans les quatre-vingts ans » est invité à la noce tchékhovienne. Il se croit encore à bord de son navire : « Gabiers, parez à hisser le grand perroquet et les cacatois… et dès qu’on a largué la toile, en bas, on raidit les amures sur le minot, on abraque les drisses ». Il radote. Personne « n’y comprend rien du tout ». Le vieil homme finit par sortir. Réapprendre ce langage, c’est pourtant une question de survie. De même, « La prochaine fois il faudra penser à votre équipement sportif avant de venir à la Montagne, on ne sait jamais. Mieux vaut prévoir ».
Un dernier mot sur le dernier mot : Laurence Chable dit du Robert Walser ‒ tous deux n’ont jamais quitté Tanguy. On retrouve un avatar de notre cantatrice : « une étoile rougeâtre traverse en un éclair le bleu profond du ciel et vient se prendre dans la coiffure de la cantatrice. C’est une parure éblouissante. » Apothéose de la cantatrice. Le possible dissipe in extremis l’angoisse. La scène est obturée par un petit drap blanc rectangulaire. On entend les mots de Walser et la voix de Chable, filtrés par ce rideau-voile-linceul. C’est un peu aussi un écran blanc, ou une page blanche, sur laquelle chacun peut projeter, à partir de ces mots, ce qu’ils ouvrent, soulèvent, en lui, d’imaginaire. Non, la mort, vieux capitaine, n’aura pas eu le dernier mot.