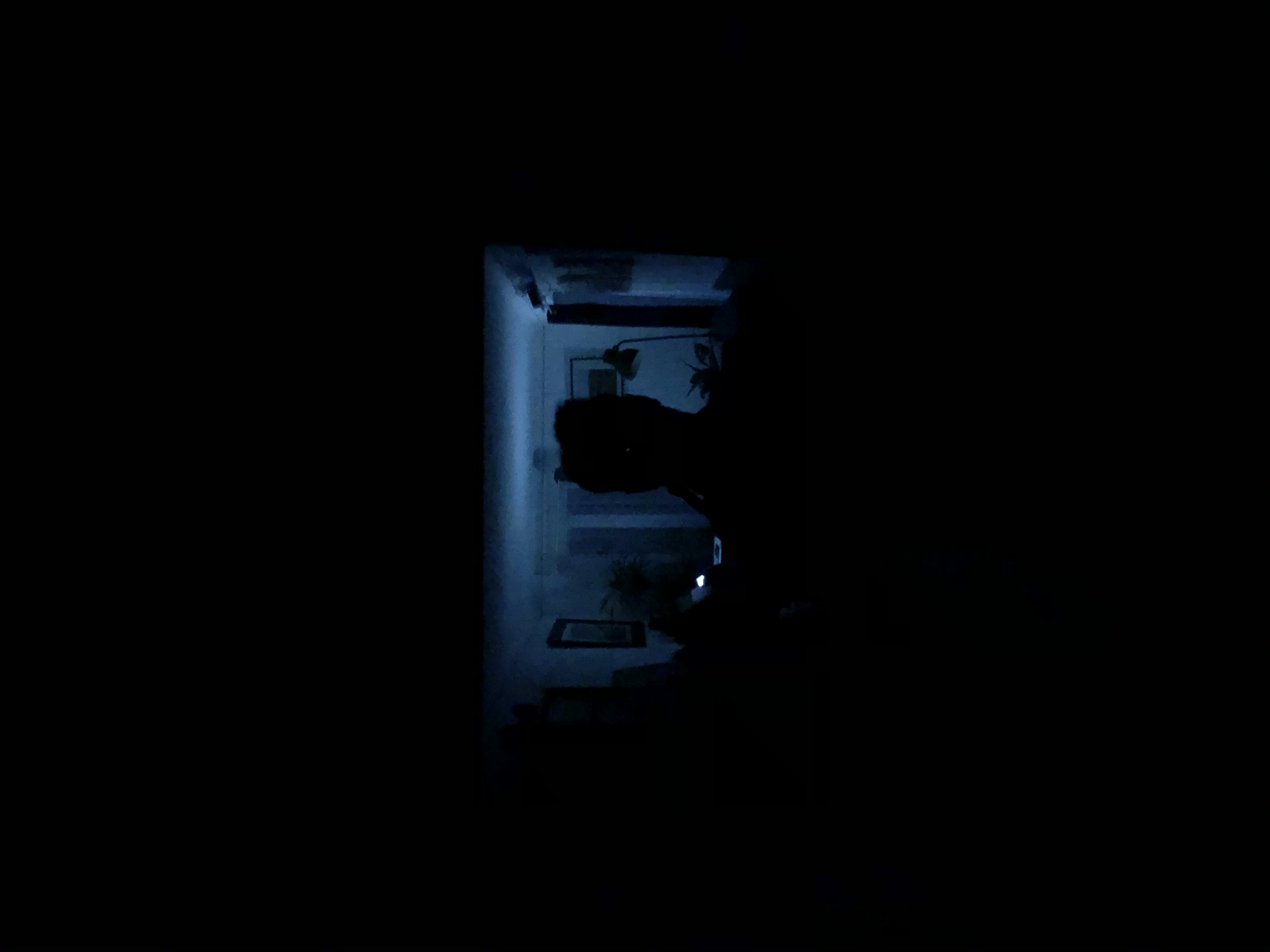
Autocritique de la terreur
Le 2 nivôse de l’An II, il neige quand on met baïonnette au canon. Hoche donne les ordres, qui devaient tenir en peu de mots, peut-être tenez bon, n’ayez pas peur, mourrez les yeux ouverts, suivis de considérations tactiques de peu d’importance, quand soudain : un boulet frappe l’arbre sous lequel il hurlait dans la mitraille — il continue : quand soudain : un second boulet frappe le cheval sur lequel il hurlait dans la mitraille. Lazare Hoche, général de l’armée du Rhin, hurle encore plus fort : ces messieurs voudraient sans doute me faire servir dans l’infanterie.
Quand on cherche des images par quoi ce qui tombe dehors, la pluie, la mitraille, ou des pièces de canons de 34 livres, plus doucement encore les heures, la fatigue ou la peur, on en trouve mille au hasard comme celle-là : quand tombe ce qui tombe dehors, et nous désarme, qu’on est nu : que le combat pourtant est là. On n’a pas d’autres choix que de répondre à la fatalité que, ce qu’elle nous impose, on l’a voulu. Qu’on en fait étendard.
Oui, les images me débusquent, me trahissent. Puis, je n’oublie pas que c’est un orateur anonyme qui, le 5 septembre 1793, a demandé que la terreur soit mise à l’ordre du jour. Qui était-ce ? Cette part de moi qui m’appelle ? Cette part collective de nous qui nous exhortent à être terrible afin de mettre au défi le monde de l’être.
C’est Vendémiaire cette fois. On décrète la Loi des suspects. Seront punis et condamnés non seulement ceux qui s’opposent à la Révolution, mais encore ceux qui en sont indifférents. Dans la lutte, l’indifférence aussi engage. Moi-même, de quoi suis-je coupable par indifférence ? De tant : de trop. De même, ces images en grand témoignent aussi de la petitesse de mes actes : et qu’il faut pourtant se dresser contre cela : la culpabilité de se sentir coupable.
Puis, toujours, tenir ferme la haine de l’intériorité, cette intériorité dans laquelle il est si tentant de trouver refuge, consolation, vérité.

Il n’y a pas de consolation et c’est cela qui sauve : il n’y a pas de rédemption et c’est cela la vérité : il n’y a de vérité que comme l’amour, provisoirement accordé pour la vie. Il n’y a que de la peine, et dans celle-ci trouver sa joie ?
Oui, il n’y aurait que des rendez-vous qu’on se donne à soi-même, et toujours on est en retard. Comme dans la phrase. Il aurait fallu dire cela, et c’est toujours devant soi, ou après, et trop tard.
Il y a quelques antidotes. Ne pas faire état des moments nuls de ma vie. Ou : je meurs trop lentement.
Tous les jours, tâcher d’être à la hauteur de celui-là avec lequel on se donne rendez-vous et tous les soirs, se coucher au long de soi-même, en peinant trouver de quoi l’avoir justifié. Par exemple : ce soir. Alors se coucher seulement si on a a extrait ce qu’il fallait de soi pour se défaire de la peine du monde ; est-ce toujours le cas ?
Hanté par les images révolutionnaires ces mois. Se plonger, quand tout dort autour de moi et que le temps commence enfin, mais qu’il reste deux heures de veille, parfois moins, parfois seulement dix minutes, ou quelques secondes, dans la geste révolutionnaire : les discours à la Salle des Manèges ou aux Jacobins, suivre heure par heure ce qui se noue entre le Grand Comité de l’An II et la Commune Insurrectionnelle, les cris dans les Sections, essayer de suivre à la lanterne les mouvements de fond des masses, négliger les grands mots, ce qu’on a fait de ces mois, ce que le pouvoir a fait de ces années révolutionnaires et de ces très jeunes hommes qui ont posé la liberté ou la mort : réduits en Grands Hommes panthéonisés pour mieux les enterrer — Je méprise la poussière qui me compose et qui vous parle. On pourra persécuter et faire mourir cette poussière ! Mais je défie qu’on m’arrache cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et dans les cieux (Saint-Just). —, cracher sur la poussière même, mais avaler la cendre : et dans la hantise, chercher les passages secrets par où le présent peut frayer : ne trouver que des squelettes souvent, des cadavres en décomposition qui portent mon nom et ma fatigue.
On se fait des promesses. On se donne des rendez-vous de plus en plus précis, de moins en moins exigeant : on s’y dérobe parfois ; ou seulement, on n’est pas prêt. On est lâche aussi quand il faut admettre que sa vie est un carré et que le monde est un rond et qu’il faudrait mieux marteler la vie que le monde, qu’il faudrait mieux ne pas cesser de vouloir des losanges plutôt que de se coucher le soir en comptant les étoiles mourir.
Presque au même endroit sous le même arbre qui n’existe plus, un siècle plus tard : une même armée française, qui n’a plus la liberté à répandre, mais la salissure stupide de son honneur, va charger : presque contre les mêmes hommes. Le colonel Lafutsun de Lacarre hurle les ordres, sans doute les mêmes que Hoche en moins sublimes, parce qu’il a en face de lui un escadron de cuirassiers et que Hoche n’avait que des soldats de l’an II issus de la Levée en Masse, celle qui avait arraché les souliers du bourgeois pour avancer dans la boue, et sur ces pensées, on avait laissé le brave colonel, qu’on retrouverait presque dans l’ouverture du Voyage au bout de la nuit, et qui parle et qui va dire Chargez, mais qui ne le dira jamais : un boulet a arraché sa tête. Le cheval a pris peur, et s’élance furieux sur les troupes prussiennes. Les Cuirassiers avaient marqué un temps d’arrêt : ils ont regardé leur Chef, sans tête, aller sur-le-champ de bataille sabre au clair et à l’envi sur le terrain battu par l’artillerie, et aller encore parmi les mourants et les morts mêler son sang au sang répandu : puis les soldats du 3e escadron font aller les chevaux et en hurlant vont suivre le colonel décapité pour s’en aller perdre la bataille et bientôt la guerre.
Voilà une autre hantise venue : une autre image qui me hante, où je me cherche inlassablement. Suis-je, de l’image, la tête tranchée ou le boulet prussien, le champ de bataille, le regard du Cuirassier ahuri, ou la trompette d’ordonnance, fauchée aussi en même temps que le colonel, mais dont le cadavre n’aura pas la gloire et le ridicule atroce de se lancer contre l’ennemi, ou la main gauche du Capitaine Bloume, qu’il cherchera toute la nuit suivante sans la trouver. Suis-je le ciel sur Reischoffen ? Suis-je rien ? Les batailles que j’engage sont intérieures : et souvent l’ennemi est invisible, souvent il est en nombre tel qu’il ne s’abaisse pas à combattre. Les batailles que j’engage sont perdues avant toute chose, et je les mène peut-être pour cette raison : je ne sais pas si cela en vaut la peine, mais la peine est grande.
Au rendez-vous avec moi-même, je trouve la tête du Colonel qui dit Chargez.
Hoche perdra la bataille de Wœrth-Frœschwiller. Le Comité du Salut Public fusillait alors les généraux défaits. Cette fois, Saint-Just lui dit seulement : Général, tu nous dois maintenant deux victoires. Je crois être assez familier désormais de la langue de l’Archange de la Terreur pour lire, non pas des encouragements, plutôt des menaces. Il remportera la bataille suivante, à Geisberg. Mais en Ventôse, tandis qu’il attend l’affectation qui l’entraînera sur d’autres triomphes, un décret d’arrestation l’attend. Quand on l’entraine à sa cellule, il est accueilli à l’entrée de sa cellule par Saint-Just. Une victoire, ce n’était pas assez.
Des images qui m’assaillent, desquels m’arracherai-je pour me lire : des grandes images qui me poursuivent pour dénoncer les moindres qui m’accablent, lesquelles sauraient dire que rien ne suffit, que le prochain jour est toujours le plus essentiel, que celui qui vient va terrasser ma peine ? Je ne sais pas.
Au rendez-vous avec moi-même, je n’y suis pas. Quelqu’un est là, il a le sourire de Saint-Just posé sur Hoche, la fulgurance du boulet sur le Colonel, le gout de la poussière, et le sel de larmes qui ne sèchent que sous le soleil de Thermidor.

