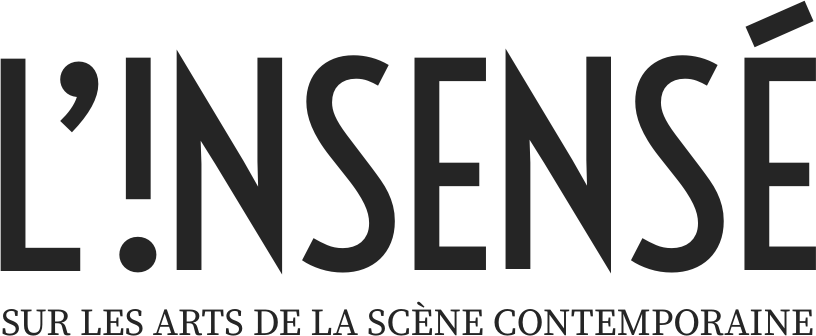Les Petites Filles modernes (titre provisoire)
TNP (Villeurbanne)

Boîte de nuit avec ado-absents
Après avoir exploré l’enfance (Le Petit Chaperon rouge, Pinocchio et Cendrillon), Joël Pommerat glisse peu à peu vers l’adolescence, depuis Contes et légendes, à présent avec Les Petites Filles modernes. Le nouveau spectacle recoupe aussi partiellement cette tentative d’épuisement des figures amoureuses qu’avait entamée La Réunification des deux Corées.
Les Petites Filles modernes (titre provisoire), de et par Joël Pommerat et la compagnie Louis Brouillard, TNP (Villeurbanne), 22 novembre-10 décembre 2025
Éric Soyer (scénographie et lumière) et le dramaturge-metteur en scène ne cèdent toujours rien sur l’expérimentation formelle. Plus encore, ils repoussent cette fois les limites de la boîte scénique elle-même, indissociable du dispositif frontal de la représentation théâtrale. Jamais la boîte scénique n’a été aussi fermée, cadenassée, grillagée, au cours d’un spectacle de la compagnie. Dans le même temps, jamais elle n’a été aussi ouverte, jusqu’au vertige. Les images scéniques jouent avec la perception du spectateur. La boîte engendre ainsi de multiples illusions. Dès la séquence d’ouverture, la profondeur de champ est hallucinatoire. Deux silhouettes apparaissent au lointain. La perspective est sublimée : plateau et cintres tapissés d’étoiles, côtés bordés par l’obscurité. Une voix établit avec le public un pacte fictionnel sur le modèle du conte, ce que laissait pressentir un titre de spectacle qui détourne celui du roman pour enfants de la comtesse de Ségur, Les Petites Filles modèles.

Il s’agit d’emblée de ne pas ramener l’adolescence vers un monde connu (des clichés, des statistiques, des faits divers, des discours), mais de faire éclater, y compris verbalement, toute son étrangeté. Le lien avec le monde adulte est quasi rompu : jamais on ne verra un personnage d’adulte sur scène. Les adultes sont ici réduits à des voix, elles-mêmes réduites à des injonctions (« vas te coucher », « dors », « travaille bien à l’école », etc.). Ce n’est pas ici l’adolescent qui bloque son lycée contre la réforme des retraites, qui s’inquiète du réchauffement climatique ou qui se radicalise sur des réseaux sociaux masculinistes : c’est l’adolescent éternel, comme on dit l’enfant éternel, dont on ne fait jamais le deuil. Peu importe les nouveaux moyens de communication ou les nouveaux lieux d’enfermement, l’adolescent, selon Pommerat, semble être celui qui toujours sera fasciné par un chanteur, toujours sera interpelé par ses parents, toujours vivra des amours impossibles, toujours déploiera la puissance de la fiction. C’est même ce dernier trait qui l’intéresse plus particulièrement. Son théâtre se reconnaît dans cette puissance de la fiction, prise au moment de son affirmation, de son jaillissement.
Mais la fiction est peut-être aujourd’hui à la fois un refuge, une évasion, et un piège, une nouvelle prison. Pommerat a bien conscience que la réalité virtuelle et le multivers sont en passe de s’imposer comme rapport dominant au monde. Et qu’il s’agit là d’un phénomène ambivalent. Le pari résolu de la fiction qui singularise son œuvre est peut-être fragilisé par cette inflation que produisent cinéma hollywoodien qui recycle ad libitum les Marvel comics, casques VR, centralité du smartphone et autres nouvelles technologies de l’ère de la post-vérité. La force du spectacle consiste à se tenir au point de fission du noyau fictionnel, lorsque celui-ci se scinde : soit il emprunte la voie des sociétés disciplinaires (utiliser la fiction comme moyen d’enfermement, concrétiser les cauchemars de Piranèse), soit il fraye un chemin alternatif (la fiction comme puissance de contestation de toute société disciplinaire, que ses prisons soient réelles ou virtuelles). Fiction contre fiction, en somme.

Les Petites Filles modernes tient cette ligne de crête grâce à deux figures, deux leitmotive : le miroir et le trou. Lors d’une séquence, nous sommes face à l’intérieur d’une chambre. La boîte scénique de la grande salle Roger Planchon du TNP semble immense. La rareté des signes disposés acquiert d’autant plus d’étrangeté et de mélancolie : un lit, un fauteuil, une chaise et une table, un ours polaire en peluche. Un échange entre deux personnages (Coraline Kerléo et Marie Malaquias) désigne le cadre scénique comme étant occupé par un immense miroir : avatar du quatrième mur théorisé par Diderot, ici hyperbolique, puisque ce miroir est censé être tourné vers l’intérieur de la chambre et donc renvoyer aux personnages leurs propres reflets ; miroir, de plus, sans tain puisque le public peut voir à travers lui (invisibilité du quatrième mur). Lors d’une séquence ultérieure, on retrouve la même chambre, mais cette fois comme si la mise en scène avait opéré un contre-champ : le miroir occupe non plus la face mais le lointain. Cependant, il ne reflète pas le public, qui se tient pourtant devant lui. Il ne reflète que les deux actrices. Moment qui rappelle les vertiges concoctés par Jean Genet dans la « maison d’illusions » du Balcon. Dans un « tableau » de cette pièce, il fallait que trois acteurs jouent avec le plus d’exactitude possible le rôle de reflets d’un personnage dans un salon. Roger Blin, lors de sa mise en scène, avait volontairement ménagé des bévues, pour exhiber le truquage, le « détail faux ». Chez Pommerat, on utilise la vidéo (Renaud Rubiano) : l’effet est bluffant, le public littéralement annulé (oserait-on écrire « cancellé », blague à part ?). Image scénique là encore ambivalente : qui dit la puissance de la fiction, mais aussi la néantisation de l’adresse théâtrale dans son propre vertige. C’est une image scénique portée à son absolu, un absolu théâtral, comme il y a eu lors du romantisme allemand la tentation d’un absolu littéraire. Le spectacle de Pommerat multiplie ainsi les jeux de miroirs à l’intérieur de la boîte scénique, pousse la réversibilité des scènes et des personnages jusqu’à inverser au dénouement les rôles de ses deux actrices (de façon low-tech : un échange de perruques suffit).
L’autre figure principale est le trou. C’est encore un élément indissociable du théâtre à l’italienne, le trou du souffleur, qui fusionne ici avec les terriers paradoxaux de Lewis Carroll. Un duo d’adolescentes se perd dans leurs univers parallèles. Chacune erre séparément dans des espaces labyrinthiques. L’une d’elles découvre un trou, un gouffre interdit, qui renvoie l’écho de sa propre voix, mais un écho chaque fois légèrement altéré et transformé, manière de revisiter aussi le mythe de Narcisse. Vers la fin du spectacle, qui la déclenche, elle saute à l’intérieur. Le temps d’un battement de paupières, d’un passage au noir dont Louis Brouillard a le secret, on la retrouve dans le lieu où elle est censée avoir atterri : espace saturé de motifs géométriques, de flux mathématiques, matrice, ou matrix, de son imaginaire. Ou bien tout ceci n’était que les divagations d’une adolescente suicidaire plongée dans le coma ? À chacun d’imprimer la légende, ou de la sceller dans une boîte hermétique.
Les derniers spectacles de Pommerat dessinent donc un grand écart : entre l’incarnation de la parole révolutionnaire, ses conditions matérielles de profération, son urgence, le sentiment d’être immergé au sein d’une assemblée en ébullition, dans Ça ira (1) Fin de Louis, et l’abstraction des Petites Filles modernes, abstraction qui a son charme, mais aussi sa froideur, qui laisse ces deux adolescentes à elles-mêmes, dans leurs mondes, coupés du nôtre.