
Brecht par Danielle Bré, ou lire le monde comme expérience
Le Labo du gai savoir, Cie In Pulverem Reverteris, D’après Têtes rondes têtes pointues de Bertolt Brecht, Mise en scène Danielle Bré, Avec Mathieu Cipriani, Sofy Jordan, Lauren Carla Lenoir, Bryce Quetel, Malte Schwind, Stina Soliva
Par Arnaud Maïsetti
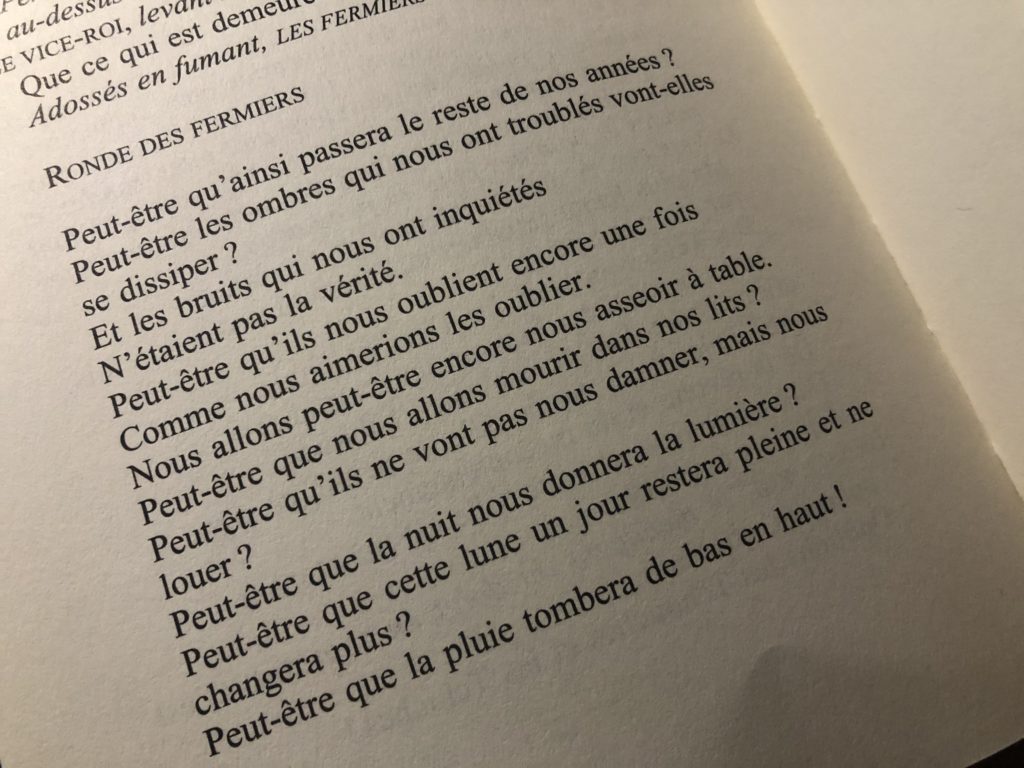
« Voyez, vous autres, comme il est difficile d’éplucher/Ainsi le fatras d’injustices et d’y trouver la justice/et de reconnaître dans les décombres/la simple vérité ». Le fatras que décrit Brecht n’est pas différent de celui où on s’enfonce, ces jours, et si les décombres semblent nommer notre présent, nous pouvons choisir lâchement de nous débattre en lui pour mieux nous y complaire : trouver docilement dans la crise des vertus, et renoncer. Ou au contraire : tâcher de lire dans le désordre les grandes lignes de force qui structurent notre temps afin de nous en arracher. Si l’œuvre de Brecht nous oblige, c’est dans cette mesure intransigeante : l’exigence de travailler à la complexité de l’histoire non pour la contempler et y loger l’impuissance, mais la traverser. Est-ce pour cette raison que l’héritage de cette œuvre est si retors, que sa pensée s’épuise si on la révère, qu’elle se dissipe en lui obéissant par respect, qu’elle ne demeure vitale qu’au prix de sa réinvention, au nom même de son exigence ? Le travail de Danielle Bré face au fatras d’injustices, dans les décombres, a voulu regarder l’œuvre de Brecht dans les yeux : elle s’est emparée de la pièce Têtes Rondes et Têtes Pointues pour mieux lire notre présent, ses impasses politiques, son illisibilité qui le préserve de tout assaut. Refusant d’aborder la politique sous son versant moral, mais élaborant le patient démontage des mécanismes des oppressions, renversant la dialectique brechtienne pour placer dans le jeu la raison et dans la pensée l’affect, le théâtre de Danielle Bré propose l’expérience cruelle d’un dévoilement : où hier comme aujourd’hui, la stratégie du pouvoir vise à substituer aux aliénations sociales les affrontements ethniques, où pour désamorcer la lutte des classes qui lui serait fatale, les gouvernants opèrent ce jeu de bonneteau qui, forgeant un ennemi intérieur, dressant la menace d’une lutte raciale, permet d’opposer les dominé•e•s entre eux. Lisant Brecht, c’est ainsi notre Histoire présente qu’elle déchiffre, pas à pas, mot à mot. Ce déchiffrage prend la forme d’un dialogue écrit dans les intervalles de la fable : dialogue de l’acteur avec son rôle, dialogue du théâtre avec le monde, dialogue du spectateur avec les forces qui lui restent.

Gouverner, où l’art de remplacer la lutte des classes par la lutte des races
« La vérité est concrète. » C’est la phrase qu’avait inscrite au couteau Brecht sur la poutre qui surplombait sa table de travail au Danemark, lorsqu’il s’y réfugie à partir du printemps 1933, quelques semaines après l’autodafé du 10 mai sur l’Opernplatz de Berlin où sous une pluie battante, une foule en liesse avait brûlé ses ouvrages au milieu de centaine d’autres. La vérité est concrète, elle prend corps et chair fumante dans l’Histoire. Ces années, Brecht assiste au cynique tour de passe-passe qu’on nomme montée du nazisme, et qui est pourtant ce complexe jeu politique de la démocratie qui se démet elle-même pour préserver ses intérêts de classe. Le grand jeu politique comme un paradoxal coup d’état permanent qui organise la conservation sociale, où l’enjeu de gouverner est l’art de contrôler les populations, le pouvoir réduit à la manipulation des opinions : l’œuvre de Brecht pourrait tout entière se tenir dans l’effort de rendre lisible ces lignes de force.
On sait vaguement l’histoire : quand le président Hindenburg nomme Chancelier l’homme fort du National-Socialisme, il tentait par là de juguler une crise sociale, économique et politique. Mais Brecht n’écrit pas pour pauvrement « dénoncer » depuis sa grange danoise, ni pour revendiquer : il s’agit plutôt de démasquer le jeu de dupes et de nommer le « pari » de la République de Weimar pour ce qu’il est, une mise où le capitalisme, sous la menace de son renversement par ses adversaires de classe — hante ici le spectre de Rosa Luxembourg — ne peut se maintenir que par le fascisme, qui ferait pour lui la sale besogne : celle d’une opération magique de substitution où les dominés se retourneraient contre eux-mêmes jusqu’à oublier leur solidarité historique et où chacun, luttant pour sa survie, serait renvoyé non plus à des rapports sociaux qui pourtant assignent à chacun sa place dans la chaîne des oppressions, mais à une identité arbitraire, biologique, spectaculaire aussi, car censément être visible sur le corps.
Dans le pli de 1933, Brecht se doit de revoir sa copie : alors qu’il travaillait laborieusement à une réécriture de Mesures pour Mesures, l’époque percute sa relecture de Shakespeare. Dans l’ancienne Dark Comedy, un monarque qui souhaite éprouver les capacités de son fils pour gouverner fait semblant de s’exiler pour mieux observer, caché, comment l’héritier exercera le pouvoir. Délirant sa volonté de puissance, jugeant arbitrairement les uns et les autres, violant, exécutant, jouissant de sa toute-puissance, le rejeton ne saura qu’affaiblir le prestige du pouvoir en l’exerçant pour lui-même. Le monarque reviendra pour punir, et donner la leçon, ambigüe, puisque donnant in fine raison sur tout à son enfant prétentieux, et se servant de lui pour assoir son autorité. Brecht reprend la trame d’un pouvoir qui ruse sa destitution, mais ici, le Vice-Roi — dont le modèle est moins le Souverain de Shakespeare que le vieux Hindenbourg — quitte un pouvoir qui lui échappe déjà pour un jeune homme ambitieux qui se présente comme le dernier recours à son maintien véritable : celui des structures économiques sans lesquelles cet État n’est rien. Or, voici que menace une insurrection révolutionnaire et paysanne qui a pris pour emblème la faucille. Du Londres de Shakespeare à celui de Marx… Donc, le Vice-Roi va faire un essai avec un parvenu, arrogant et déclamatoire : Iberin, dont le nom claque déjà comme un slogan, décalque qui voile mal le nom d’Hitler. Celui-ci a désigné l’ennemi : ce n’est pas le pauvre, mais l’homme à tête pointue, le Tchiche. La fable de Brecht prend les allures d’un conte atroce, d’une allégorie enfantine où Yahoo est le site géographique schématique de la tragédie allemande. La transparence du schéma est son arme : les Juifs/Tchiches permettent de désamorcer la menace communiste, tout en concentrant les efforts d’une Nation pour souder autour d’un Prince vainqueur et vengeur sa puissance qui saura consolider les seuls intérêts à préserver — la propriété privée, la prospérité assurée par la vente du blé, l’assise de Cinq Grandes Familles productrices.
La fable tramée dans l’histoire est tissée d’expériences concrètes. Le procès d’un riche — Tchiche — permet à Iberin d’affirmer les nouveaux principes d’un pouvoir qui semble prendre le contre-pied de l’ancien, à la grande surprise même des pauvres dont certains — Tchouches — se rallient à lui. Mais Iberin prend moins la défense des paysans que des Tchouches : inlassablement, l’un d’eux réclamera la fin de son oppression, et inlassablement, de plus en plus frontalement, Iberin niera même qu’elle existe, puisque, libéré du Tchiche, il ne peut réclamer une plus grande émancipation. C’est cette double trajectoire croisée — le riche De Guzman, qui monnaiera sa liberté ; le pauvre Callas, qui paiera le prix de son illusion — que raconte aussi la fable, trajectoire à l’intersection de laquelle se situe le corps de deux femmes asservies à la domination masculine : la sœur De Guzman, et la fille Callas, l’une promise au couvent, l’autre prostituée, les deux servant malgré elles les intérêts des frères/pères. Tout le récit se donne à lire selon la grille économique : on mise, on parie, on défend ses intérêts, on spécule. C’est finalement cette grille qui se donne à voir au dénouement, lorsqu’à l’issue d’une scène au cours de laquelle se succéderont deux paris, la puissance de l’argent reprend le cours des choses triomphantes, rétablira les pauvres et les riches dans leurs conditions respectives, dissipera l’illusion Iberin qui aura au moins permis d’écraser la révolte de la faucille, et appellera à une paix — mais « non pas molle ». Cette dialectique retournée, Brecht la représentera théâtralement à la fin par la réécriture d’une scène maintes fois éprouvée et éminemment théâtrale : celle des changements de rôles et des déguisements qui dévoilent pourtant la véritable nature des êtres. La fille Callas prendra la place de la riche De Guzman qui souhaitait se vendre pour sauver son frère ; le pauvre Callas prendra celle du frère De Guzman sur la potence, pensant acheter là sa liberté qu’on lui promet. Tout ce jeu de dupes est éventé finalement : les oppressions d’argent se révélant finalement comme seules maîtresses de la partie.

D’une dialectique l’autre
La puissance de la fable Brecht n’a pas seulement pour moteur ce dévoilement : le jeu dialectique infini qu’elle propose, la saisie par le théâtre du théâtre des affaires, les affects mobilisés pour dégager l’extrême complexité de ce qui est en jeu irriguent un texte dont l’allégorie permet de lire bien autre chose que la seule Allemagne du siècle passé. Cette dialectique attend, pour fonctionner à plein, que la scène à son tour s’en empare((Le spectacle annoncé des 12 au 13 janvier 2021 n’a été présenté qu’à des professionnels au théâtre Antoine-Vitez à Aix-en-Provence. Il sera repris la saison prochaine, quand la fin du monde aura fini.)). Danielle Bré refuse donc d’illustrer une période historique, plutôt tâche-t-elle de faire elle aussi ce pari du théâtre, celui des corps et des rôles assignés, des rôles émancipés de leur rôle qu’on leur fait jouer, des lignes tracées au sol comme sur nos mains où on nous lirait l’avenir, et des bascules constantes du tragique vers le burlesque, du drame vers l’épique, de la comédie de mœurs vers ce qu’on ignore encore, rire terrible qui se change en grimace.
Travaillant ces sauts d’un tableau à l’autre, le spectacle tente d’opérer à chaque fois le corps du théâtre de Brecht en même temps que notre époque. La dissipation des oppositions de classe au profit d’autres distinction — notamment ethnique, ou religieuse — n’est pas l’apanage des années 30. Et si l’analogie de notre époque avec celle-ci est souvent grossière, le spectacle ici ne fraie jamais avec l’outrance de rendre les situations analogues, précisément parce que la mise en scène écarte autant qu’il est possible la tentation de prendre l’Histoire pour modèle, plutôt travaillant à un minutieux travail de la dramaturgie comme précipité chimique.
C’est que nous assistons à une expérience. Celle des transformations incessantes, des renversements de fortune, des modifications des structures de pensée, des moments de retournements — tout cela à vue. Cette expérience est autant celle que l’on fait face à ce spectacle qui ne cesse de nous inciter à prendre ces virages, que celle des sujets qui devant nous les subissent. Ainsi le texte de Brecht est-il troué de partitions écrites à partir de lui, et prononcées par les acteurs échangeant au présent avec nous les pensées déposées lors du travail. On assiste ainsi à plusieurs couches de temps : le temps de la représentation rend visible aussi le temps de ce travail d’élaboration. Chaque acteur ira ainsi dialoguant avec lui-même, et exposant les luttes engagées contre son personnage. Ici, une actrice dira sa solidarité — jusqu’à un certain point — avec celle qu’elle joue ; une autre dira son incompréhension face à l’attitude de ce qu’elle incarnera ; un autre enfin, dira son intime empathie avec la détresse et l’intelligence sensible de ce qu’il donne à voir. Tous travailleront à défaire la perspective morale de tout jugement, plutôt cherchant à rendre pensable les points de vue, intelligibles les positions, mêmes les plus scandaleuses : quand par exemple Madame Callas n’annonce qu’à la fin d’un tableau l’affreux sort réservé aux Tchiches Lopez, alors qu’elle le savait depuis le début. Pourquoi cette attente ? On mesure l’intérêt dramaturgique du point de vue de la pièce, mais pas du point de vue humain. C’est la force, subtile, et la tendresse, infinie, de ce travail : d’œuvrer parfois en lutte contre le propre théâtre qu’on forge pourtant.
Puis, le renversement est d’une puissance singulière. C’est lors des prises de paroles réflexives des acteurs que se jouent surtout les éclats d’intenses émotions ; et c’est dans le jeu qu’au contraire se réalise en acte la pensée concrète. Chiasme de l’affect et du rationnel, du sensible et du ludique, qui affecte l’ensemble du spectacle d’un coefficient d’intimité où la pensée est sensible, où l’émotion est une pensée en mouvement, puisqu’elle donne à penser le possible des êtres qui en sont animés.
Le jeu, d’une concrétude physique, donne aussi à lire les lignes claires d’une trame franche. Au schématisme de la fable répond la complexité qui la met en branle, tout comme à la précision de direction se donne à entendre le libre jeu des subjectivités en prise avec un corps traversé par les temps disjoints des époques, du travail, des représentations. Sur tout cela plane comme la latence d’un drame toujours à venir, toujours suspendu à son annonce — les mouvements de la Faucille, les venues d’iberin, celles de temps nouveaux — qui fait régner sur le plateau la lourde tension d’une imminence toujours dissoute dans l’acte suivant qui annonce d’autres avenirs. On est, de ce côté de la salle, saisis à vif dans ce temps d’imminence qui nomme si bien tout à la fois l’impuissance politique de nos jours (« il faut endurer les temps difficiles ») et notre espérance (« les mauvais jours finiront »). Contre l’illusion de l’imminence frotte un jeu sans horizon autre que son propre temps, sans perspective de rédemption, sans morale du salut, remet à son plan d’immanence la politique comme ce libre mouvement des possibles, des survenues aberrantes, des présences consenties l’une à l’autre et à soi.
Il y a enfin la lecture subtile que ce travail permet. Dans les débats en cours de nos jours depuis le point de vue révolutionnaire, s’agitent les adversaires de deux causes : ceux qui considèrent comme structurant l’enjeu de la lutte des classes, et qui pensent une fois pour toutes que tout lui est subordonné. Et ceux qui jugent plutôt prédominantes les oppressions faites aux corps des dominé•es : anti-racistes, féministes, voire éco-socialistes. Cette dernière approche, par sa nouveauté, semble prendre le dessus sur l’ancienne, sans doute enfermée au sein d’organisations d’un autre âge. Le spectacle de Danielle Bré interroge ainsi — davantage que le texte de Brecht —, la place du corps de la femme dans les jeux d’oppression. Installant l’hypothèse d’une solidarité de fait entre les femme, par-delà les oppositions de classe, certaines scènes tentent de donner à voir ce que pourrait être, dans les faits et les gestes, l’intersectionnalité — cette combinaison des oppressions entre elles. L’implacable structure dramaturgique ne permet pas d’en finir pourtant avec ce qui semble l’indépassable organisation du capitalisme : que chacun soit finalement déterminé par la place qu’il occupe dans la chaîne de production, soit paysan, soit riche propriétaire. L’alliance des femmes paraît ici tout au plus affective, davantage que politique.
Reste la vérité du sous-titre de la pièce de Brecht : « Reich und reich gesellt sich gern » — jeu de mots accablant et intraduisible, ou seulement par l’espiègle jeu sur les parenthèses telles que le proposaient Ruth Orthmann et Eloi Recoing : « R(e)ich et riche font bon ménage ». Danielle Bré a, à son tour, comme traduit la pièce dans la langue de son théâtre : celui d’un drame des acteurs en dialogue avec leurs rôles, leurs actes, leurs drames, dialogue qui dialogue dialectiquement avec le dialogue des spectateurs plongés dans un intense travail de traduction pour mieux lire notre monde. Traduire le spectacle avec, pour interprètes, les interprètes d’une pièce, permet de traduire notre présent dans la langue sensible de la pensée qui seule serait capable de réarmer notre désir de penser autrement ce monde, pour mieux le forger autre.

