
Jatahy, re-tenue de soirée
Théâtre de la Colline, mars 2016

Car il y a un geste radical chez Christiane Jatahy qui la conduit à disposer en toute liberté du texte de Tchekhov, pour n’en plus garder que l’expérience de lectrice qu’elle en a fait. Dire sa lecture donc, ou comme l’aurait prétendu Roland Barthes, mettre en scène une « hémorragie permanente », un « déplacement infini ». Œuvrer à une « science de l’inépuisement » et revendiquer une « structure qui s’affole ». Non pas décoder, mais sur-coder. Non plus déchiffrer, mais aux contraire « entasser les langages » dont le lecteur est le destinataire, dont il est la croisée… et dont il est traversé. Et, enfin – et Jatahy en est l’expression – sentir que la « lecture est conductrice du Désir d’écrire ». Non plus interpréter donc, mais devenir écrivain (de plateau). What If They went to Moscou relève ainsi à part entière d’un désir d’écrire qui, chez Christiane Jatahy, prendra la forme (car l’écriture est avant tout une forme) d’un rapport au théâtre autant qu’au cinéma. Un rapport à la scène autant qu’à l’écran où ce que la scène couve, l’écran le dévoile… et réciproquement. Du plateau à l’écran, du jeu en direct au mixage en coulisse, de la scène immédiate à l’image différée… de l’un à l’autre, Jatahy fait jouer ainsi le « point de vue » (le sien, et celui du spectateur aussi) et « la vue du point » que sont aussi l’écran et le plateau. Variation sur « l’esthétique du point » en quelque sorte, où il s’agit dès lors pour Christiane Jatahy de « faire le point » (constat et bilan sur Les Trois sœurs et/ou des trois sœurs sur leur vie), mais aussi et encore (comme en photographie ou au cinéma), faire le point signifie « produire » la netteté ou, et disons-le autrement, tenter d’évacuer le flou, le flouté, le non-dit et gagner ainsi une forme de transparence qui éloigne les trois sœurs de ce qu’elles se refusaient de s’avouer.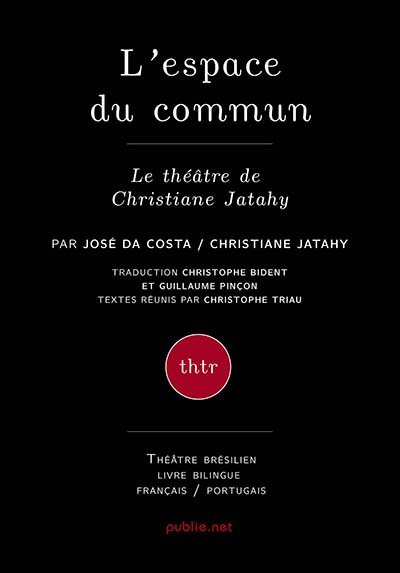
Orange (théâtre) ou bleu (film) ? De la couleur du billet d’entrée dépendra la perception du spectateur qui, au Théâtre de la Colline, est venu voir le travail – la recherche – de Christiane Jatahy sur Les Trois Sœurs de Tchekhov. Traversée par un théâtre intime que la metteure en scène brésilienne de Rio arpente déjà depuis quelques années, la lecture de Jatahy de ce texte – que Tchekhov apparentait à une comédie – est un lieu de métamorphoses. Au vrai un espace de passages entre des formes oniriques et des gestes quotidiens subordonnés à une théâtralité de l’actualité et de la simultanéité qui intercallent réel et fiction. Espaces clos et ouverts qui jouent de différés, de renouvellement de différences et d’inférences.
À l’image du titre What if they went to Moscou (traduisons librement par « Et si elles gagnaient Moscou ? »), Jatahy déambule dans « ce classique ». Elle l’éclate, le fragmente, s’en affranchit… au point de privilégier un mouvement d’errance casanier où la fratrie réunie forme, le temps d’une fête d’anniversaire, un peuple de solitudes assemblées, une communauté unie par les liens du désarroi, les gènes de la peine, un ADN de douleurs qui est la couleur de la vie. Un travail qui repose sur les soubresauts, les spasmes, les élans du cœur, la nostalgie des belles heures de bonheur et les états d’âme de trois sœurs…
Tchekhov : les 3 frangines en peine en panne
Que dire des Trois sœurs de Tchekhov qui n’ait été déjà dit ? Que faire des Trois Sœurs ? Que faire ou comment mettre en scène « ça » qui immobilise le temps, fige le mouvement, ouvre sur des vies intérieures, donne à la pensée sa forme suspensive où la décision vient à s’absenter…
Faire de « ça », comme Eric Lacascade, une forme chorale déglinguée reposant sur une énergie collective sur le plateau du Théâtre d’Hérouville ?
Faire comme Stéphane Braunschweig, à la Colline, disposer dans un intérieur bourgeois les trois sœurs, apparentées à des biblots, que l’on observera derrière un cordon de musée… ?
Que faire de « ça » où les allées et venues raréfiées des personnages forment des cercles qui se regardent comme l’onde qui se forme autour des noyés ? Ramener le tout à trois répliques n’est pas recevable pour ceux qui voient dans « ça », trois orphelines solidaires au milieu d’un désert, une crise de fin de siècle d’une famille désargentée, une expérience du désœuvrement à l’œuvre qui rouille tout jusqu’à la pensée des trois « petites filles », un drame de la non-issue où les paroles échangées tournent courts, une histoire de l’attente subordonnée à un départ toujours repoussé, une fresque de la Russie finissante dans un horizon sans fin… Pourquoi pas… ?
Mais il y a ces trois répliques qui n’en finissent pas de résonner.
Celle d’Olga, « notre père est mort, il y a juste un an aujourd’hui, le cinq mai, le jour de ta fête, Irina ». Une phrase ou un humus sémantique qui se livre comme le périmètre à l’intérieur duquel se déploie un geste archéologique à venir.
Celle d’André qui, un bref instant, au tournant de la pièce, habille presque sa pensée du vêtement de Faust : « Où est-il, mon passé, où a-t-il disparu ? J’ai été jeune, gai, intelligent, j’avais de beaux rêves et de belles pensées, mon présent et mon avenir illuminés d’espoir… Pourquoi, à peine nous commençons à vivre, devenons-nous ennuyeux, ternes, insignifiants, paresseux, indifférents, inutiles, malheureux ?… ». Soit un souvenir, ou disons plutôt un deuil de soi plus vif alors que la vie nous a enterré vivant.
Celle d’Olga, encore, « la musique est si gaie, si encourageante, et on a envie de vivre! […] Le temps passera […] on nous oubliera, on oubliera nos visages, nos voix, […] Oh, mes sœurs chéries, notre vie n’est pas encore terminée. Il faut vivre ! La musique est si gaie, si joyeuse! Un peu de temps encore, et nous saurons pourquoi cette vie, pourquoi ces souffrances… Si l’on savait ! Si l’on savait ! », qui fait confiance à l’oubli pour que s’entendent à nouveau le chant et l’avenir de la vie…
Dans l’écho que forment ces résonnances, la mort du père, l’errance à vie de la vie, et à l’horizon l’avenir et l’utopie de compagnie, Les Trois sœurs se regardent comme une variation sur un désir ennuyé et fragilisé, peut-être un peu cassé, certainement un désir embarrassé moins par la mémoire et les souvenirs, que par l’expérience d’une vie qui, jusqu’à maintenant, au seuil du départ fantasmé pour Moscou, n’a pas tenue ses promesses au point de livrer, surtout, une succession de désillusions, une vie d’éclats cassés.
Et de commencer à comprendre que « la fête », qui est l’espace de ralliement d’une communauté aux singularités quelconque, est avant tout, et peut-être seulement et finalement simplement, le lieu de rendez-vous de ceux qui entretiennent un besoin de consolation.
Bref, les dialogues dans Les Trois sœurs, moins sœurs Bronté en définitive, que sœurs bonnasses ou « sœur Emmanuelle au cube », s’apparentent malheureusement à de la guimauve, à de la poudre de Perlimpinpin, à du light alourdi par des propos d’oribus. Ou comment, finalement, les trois sœurs assurent le passage de la rêverie à la mièvrerie…
Et de voir se profiler l’épopée des frangines en peine et en panne qui « imagine what the people » … sans savoir (« si l’on savait » dit Olga) encore que la « Russie de papa » passera l’arme à gauche. Ou comment, avec l’ère soviétique qui se profile, on passera des pensées à l’eau de rose des trois sœurs de saccharose, à la cause commune du Sovkhose.
Alors que faire avec « ça », « aujourd’hui le 3 mars 2016, à 19H30 au Théâtre de la Colline… ? ». Phrase dite par Irina (Julia Bernat) qui demande l’heure au public, avant qu’elle ne poursuive par ce qui est ou sera en jeu « Nous voudrions parler du désir de changer et de la difficulté de changer »…
Le geste radical…What if they went to Moscou
Dès lors, What If They went to Moscou reléverait en quelque sorte d’un travail de recherche sur l’optique : « ce qui est à voir » et « d’où l’on voit ». Passant de l’un à l’autre, mêlant l’un à l’autre, l’exercice théâtral procéderait donc d’un souci de localisation. Voir ce qui est « là » et regarder « d’ici », et accepter, en définitive, que la combinaison plastique et poétique se mêlant à l’imagination créatrice entre l’un et l’autre produisent moins la précision qu’une complexité où le plateau et l’écran deviennent une ligne de fuite. C’est-à-dire, comme l’écrivait Gilles Deleuze dans Pourparlers, « une ligne de sorcière » qui désigne l’activité de la pensée… celle de Jatahy sur Les Trois sœurs, celle encore des trois sœurs sur elles-mêmes.
Et de sentir alors, dans ce va et vient, dans ce jeu de miroir déformant entre la scène et les images, d’abord, que le poids des trois sœurs pèse sur chacune d’elle. Comprenons par-là que la fratrie, pour autant qu’elle livre les énergies du collectif est, à part égale, un système carcéral qui prive les unes et les autres d’une liberté singulière. Les trois sœurs (entité) sont ainsi prisonnières de ce qui les constitue et les annihile en tant que singularité (Olga/Isabel Teixeira, Irina, Macha devenue Maria/Stella Rabello) vivante. La nostalgie, le souvenir, la mémoire, la vie commune… se regardent dès lors comme des formes corrosives et hostiles au vivre, mais des formes indépassables parce qu’elles sont aussi la vie. « Il faut vivre » dira Olga, dans Tchekhov.
Et de voir dès lors dans les petits séismes affectifs que met en scène Jatahy, les symptômes du déréglement de l’harmonie qui gouverne, a priori, à l’unité des trois sœurs. Comme, par exemple, Irina qui rentre dans une colère violente quand on lui pique son portable. Comme, par exemple, les trois notes d’une basse triste qui vient contredire « la musique gaie ». Comme, par exemple, les larmes rentrées d’Olga en marche vers la dépression. Comme, par exemple, l’invitation récurrente faite au public de venir les rejoindre et d’y apporter un air frais là où le confiné, le huis clos, le carcéral n’en finissent plus d’éroder les tissus de trois sœurs à fleur de peau.
Jatahy fait donc, à partir du deuil récurrent qu’observent les trois sœurs (celui lointain de la mère, celui proche du père et ajoutons y celui présent de leur vie singulière), « un point » sur le seuil où elles se tiennent. Seuil, ou espace intermédiaire, où l’amour manque d’amour, la vie manque de vie, et où la solitude elle-même semble amputée.
Côté scène, les verres de vin et de champagne ont un goût amer, le gâteau d’anniversaire est orné, finalement, de bougies funèbres, les portes-fenêtres n’ouvrent sur aucune perspective, les téléphones qui sonnent isolent, la musique rock ou populaire, de Lou Reed à Stings, n’adoucit plus les moeurs… et si le plateau est le lieu d’une énergie collective (propre à l’héritage des collectivo brésilien), il est aussi l’espace d’exposition de la manifestation d’un disfonctionnement qui souligne des pensées à la torture. Soit une façon de mettre à vue, dans l’apparence d’une vie socialisée habillée par l’artifice de la fête, un ensemble qui les inscrit dans un tragique domestique. Exilées en devenir, exilées en passe de partir, elles sont à l’image de ceux qui, en partance in-volontaire, se tiennent « une main devant, une main derrière ». Image, oui… image d’une déchirure !
Et alors que l’affection les conduit à s’enlacer, c’est un tub désuet de Françoise Hardy qu’elles reprennent en chœur « Tous les garçons et les filles de mon âge… » qui fait entendre une pure mélancolie.
Ainsi en va-t-il de What if they went to Moscou où Olga, Irina, Maria… esclaves d’un désir ou figures inconscientes d’un désir-esclave fait des trois slaves des ombres d’elles-mêmes.
Côté film, mauvais terme pour désigner ce qui relève en définitive du « documentaire », le cameraman sur le plateau saisit le tout venant où le gros plan trouve un contrepoint dans le saisissement du furtif et de l’éphémère. Images à la marge, en quelque sorte où la scène qui développait une force centrifuge (liée à la polarisation qu’exerce l’acteur qui joue) trouve dans l’image filmée un effet centripète. Observé à la loupe, pour ainsi dire, c’est le détail qui est ici privilégié, les conversations dans ses replis, les larmes qui viennent au coin de l’œil et ne sont visibles que par un « effet gros plan ». Le film que découvre le spectateur, après qu’il a vu la pièce, livre son lot de « secret story » où s’entendent les paroles out, les gestes off, et c’est tout un monde d’en-dessous qui vient à la surface de l’écran. Comme vient aussi une image de Datcha qui ressemble étrangement à une « maison de poupée ». Référence à Ibsen ( ?) qui posait la question lui « d’être soi-même » ou le pendant de la question de Jatahy « comment changer vraiment »… pour devenir soi ?
Et de regarder, sur le matelas à vue, le corps nu de Maria étreint par Alexandre où l’amour adultère ne renvoie qu’à rien d’autre qu’à un désir éphémère de rompre avec une solitude dont l’être a pris l’habitude. Episode d’enfermement auprès de l’autre qui laisse Maria, l’une des voix des trois sœurs, dans l’isolement.
Face A, Face B… Face à face
Sur le divan en front de scène ou sur le petit banc qu’elle rejoigne après la projection, face au public, Irina, Olga et Maria finissent presque comme elles ont commencé. Une question vient ainsi mettre un point au dispositif « Comment changer vraiment »… et Irina de reprendre en marquant l’accentuation « Mais vraiment »… Une question testamentaire, en quelque sorte, où l’intensité du « vraiment » souligne la volonté radicale et l’espoir d’en finir avec la disparition à soi, avec l’absence à soi… Un motif central dans What if they went to Moscou, ou un concept que Christiane Jatahy n’a peut-être plus quitté depuis qu’au terme d’un master en philosophie et arts, elle traita du concept « d’absence » chez Nietzsche et Schopenhauer. Et de quitter la salle, en ayant en mémoire Irina qui demandait l’heure, une nouvelle fois, au public… et qui à sa manière, souriante et inquiète, rappelait que le temps, à l’endroit de What if they went to Moscou s’invite comme un paramètre réel, une donnée qui renvoie ce travail théâtral à une actualité, à une présence.
