
La Reprise de Milo Rau… ou en découdre avec la banalité du mal
 La Reprise – Histoire(s) du théâtre (I), de Milo Rau.
La Reprise – Histoire(s) du théâtre (I), de Milo Rau.
Gymnase du lycée Aubanel. Festival d’Avignon In 2018
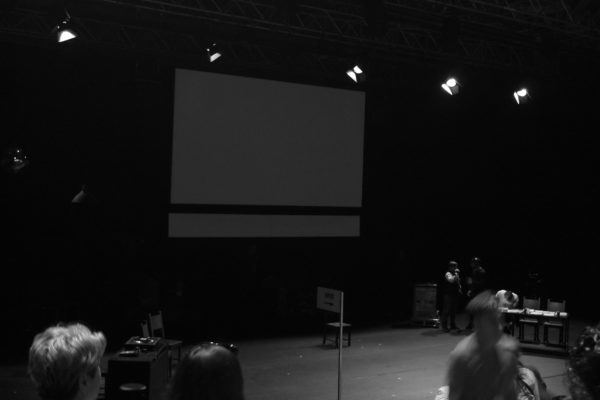
Deux ou trois choses à préciser avant…
Parle d’abord du rapport que l’on entretient au théâtre, lui qui, en même temps qu’il a pris récemment la direction du NTGhent, a livré un Manifeste « Dogma ». Manière de « prévenir » de la direction qu’il entend donner aux travaux qu’il conduira, qui seront accueillis et qu’il accompagnera. En 10 points (4 de moins que Peter Weiss quand il définissait dans les colonnes de Theater heute, en 1968, sa pratique du théâtre documentaire), Milo Rau, le 1er mai 2018 (un anniversaire en quelque sorte) publie un Manifeste en néerlandais, flamand, français et anglais… Ce qui, désormais, s’appellera le Manifeste de Gand. Rappelons ceux-ci :
— Un : Il ne s’agit plus seulement de représenter le monde. Il s’agit de le changer. Le but n’est pas de représenter le réel, mais bien de rendre la représentation réelle.
— Deux : Le théâtre n’est pas un produit, c’est un processus de production. La recherche, les castings, les répétitions et les débats connexes doivent être accessibles au public.
— Trois : La paternité du projet incombe entièrement à ceux qui participent aux répétitions et aux représentations, quelle que soit leur fonction – et à personne d’autre.
— Quatre : L’adaptation littérale des classiques sur scène est interdite. Si un texte – qu’il émane d’un livre, d’un film ou d’une pièce de théâtre – est utilisé, il ne peut dépasser plus de vingt pour cent de la durée de la représentation.
— Cinq : Au moins un quart du temps des répétitions doit se dérouler hors d’un espace théâtral, sachant que l’on entend par espace théâtral tout lieu dans lequel une pièce de théâtre a déjà été répétée ou jouée.
— Six : Au moins deux langues différentes doivent être parlées sur scène dans chaque production.
— Sept : Au moins deux des acteurs sur scène ne peuvent pas être des acteurs professionnels. Les animaux ne comptent pas, mais ils sont les bienvenus.
— Huit : Le volume total du décor ne doit pas dépasser vingt mètres cubes, c’est-à-dire pouvoir être transportable dans une camionnette de déménagement conduite avec un permis de conduire normal.
— Neuf : Au moins une production par saison doit être répétée ou présentée dans une zone de conflit ou de guerre, sans aucune infrastructure culturelle.
— Dix : Chaque production doit avoir été montrée au minimum dans dix lieux répartis dans trois pays au moins. Aucune production ne pourra quitter le répertoire de NTGent avant d’avoir atteint ce nombre. »
On l’aura compris, Milo Rau entend lier ou articuler chacun des projets esthétiques dans lesquels il s’engagera aux conditions de productions qui les soutiennent. Mais, et plutôt que les seconds déterminent les premiers, le metteur en scène intègre ceux-ci à l’esthétique théâtrale qu’il entend promouvoir. Revendication politique et idéologique, la Manifeste de Gand s’apparente dès lors à un Manuel de Résistance aux formes de l’industrialisation culturelle avec lesquelles s’arrangent trop facilement ceux qui font le théâtre. Contre le conservatisme et la collusion d’intérêt, contre l’immobilisme et le centralisme (trop de lieux théâtraux figurent cela), Milo Rau est bien en guerre avec les habitudes de son époque. Brechtien à sa façon donc (Rau n’hésite pas à citer L’Antigone réécrite par le patron du Berliner), son théâtre est une arme. La simplicité radicale, une réflexion sur le travail de chaque instant, la tentation de faire du théâtre un influent du monde… voilà (en quelques lignes toujours trop réductrices) la direction. Et de l’écouter, à l’occasion d’un entretien, préciser les choses :
« J’ai envie maintenant de construire une espèce de machine théâtrale à produire du théâtre, des films, des films dans le théâtre […] Manifeste Dogma [1], ça veut dire que 20% du travail définitif peut venir des modèles connus, mais tout le reste doit être imaginé. Il faut libérer le théâtre d’un excès de répertoire ».
Et plus loin d’ajouter :
« Je veux que le metteur en scène devienne un auteur avec son équipe et se libère du théâtre bourgeois ».
Ainsi, de Les Derniers jours de Ceausescu (2009), pièce où l’archive et le recours à la vidéo sont omniprésents à Le tribunal sur le Congo (2015), Milo préfère proposer une pratique théâtrale qui rompt avec les temporalités et les spatialités de la représentation traditionnelle. Il lui préfère un « hors scène » qui permet à l’image de s’inscrire dans une présence et une actualité. Loin d’affaiblir « la scène », ce protocole de travail qui ouvre les horizons, installe le jeu plus loin que les planches, est une manière de rendre au plateau sa fonction désertée : demeurer une sorte d’atelier d’où s’organisent les conditions d’exposition. Faire du plateau non plus un point de concentration et d’intensité de l’action, mais lui rendre sa fonction de point archéologique, généalogique, là d’où tout commence.

Vous n’avez jamais sucé une grosse bite !
Difficile de ne pas rapprocher le dispositif de La Reprise des traits scénographiques structurant de L’Instruction de Peter Weiss. Cette organisation de l’espace, partiellement évidé, en forme d’entonnoir où de part et d’autre d’un imposant écran blanc de cinéma, une table oblongue posée en oblique à cour et une autre à jardin mettent immédiatement le spectateur dans la position de celui qui assistera à un dialogue frontal, tout en étant aussi le témoin de ce qui sera projeté. Difficile de ne pas le voir, mais en définitive, c’est secondaire sinon que cela induit un rapport au procès, à l’organisation agonique du procès ou du tribunal. La Reprise n’est certainement pas réductible à cette idée, mais l’idée est là, bien présente d’emblée. Et qu’est-ce qu’un procès sinon le lieu où une énigme est à l’ordre du jour parce que le désordre a été de mise un jour.
Une énigme à résoudre donc ! Ici, celle qui vaut à un homosexuel d’avoir été assassiné pour une phrase. Une petite phrase hypothétique que Milo Rau prête à Ishane Jarfi qui, devant l’open bar (club gay) est embarqué dans une Polo grise qui apparaîtra plus tard sur le plateau dans un nuage épais de brouillard, parce que rien n’est clair dans l’histoire de ce meurtre sinon que quelqu’un devait mourir ce soir-là. Parce que c’est comme ça. Parce que ce soir-là, un homo devait mourir pour une phrase. Alors il y a la phrase de rien. L’énoncé de rien. La phrase dite sur le mode de la plaisanterie par Ishane, dite par étourderie quand on se croit en pays humain… « Vous n’avez jamais sucé de grosse bite ! » dit Ishane à trois héteros, dans la polo grise, qui sont en mal de « gonzesses » qui leur pomperaient le dard. Et la phrase dite par étourderie, dite en toute liberté, dite quand on se croit en pays humain, est mal entendu, mal prise et appelle « la banalité du mal ». Là est le motif central de ce drame qui tourne à la tragédie dans le vocabulaire journalistique (Rau l’a été journaliste). Parce que la phrase, c’est-à-dire, quelque chose qui touche au langage, n’est pas neutre et s’inscrit, comme Marcuse et Arendt entre autres, l’ont expliqué, dans le champ du politique et de la morale. Point de phrase neutre donc, et celle-là qui convoque la sexualité et ses modes de répression (relire Foucault) est, à tous les égards, politique.
Dans le coffre de la Polo, Ishane prie alors qu’il va crever de s’être cru, en 2012, en pays humain, à Liège. Mais voilà, Liège ou l’Europe (ajouterons-nous) par où est passé le capitalisme et son goût immodéré, voire dégénéré, des affaires, est une ville sinistrée de la mondialisation. Liège, comme le montre les photos projetées sur l’écran, est une ville aux cheminées froides. La sidérurgie qui entretenait là les foyers est désormais ailleurs, là où ça coute moins cher. Et les foyers de chômeurs sont légions, sans travail, mais pas sans vie. Les trois types de la Polo, comme Ishane, sont de ceux-là, attendant des frères dardenne (convoqués par Rau sur le mode humoristique, mais aussi essentiel d’un cinéma épuré) un emploi de précaire dans un énième film des petits frères des pauvres qui ont le souci du genre humain.
Et Rau de commencer La Reprise presque à cet endroit, par l’audition de « gens de peu » comme l’écrirait Pierre Sansot. Sur scène défilent ainsi Suzy, Fabian, Tom (des amateurs de théâtre) face caméra, qui parlent de leurs vies moribondes prises entre petits boulots (garder des cleps pour arrondir la fin du mois pour Suzy Coco la divorcée, prendre au mot le psychologue qui déclare un profile artistique pour Fabian Leenders qui s’invente DJ, écouter Tom Adjibi le belge d’origine béninoise prétendre au multilinguisme pour avoir un emploi de figurant chez les Dardenne et imiter le danois, etc.). Séquences drôles où le désarroi des vies exposées est compensé par le goût de la vie des auditionnés qui conservent l’humour. « Quand on a que l’humour à s’offrir en partage » en quelque sorte.
Séquence qui suit celle où Joseph Leysen parlait du métier d’acteur, du théâtre et de ce qu’il a à dire ou comment en faire, de l’apparition du comédien sur scène, du moment où l’acteur devient un personnage et repose éternellement la question du Persona, etc… jouant, histoire de rappeler ce que le théâtre de répertoire peut être un extrait d’Hamlet. Instant où il apparaît, in fine, en Minetti pour lui rendre, on ne sait, hommage ou pas. Scène où s’est intercalés, peu avant, le visage et la voix de Sébastien Foucault (ancien élève du conservatoire de Liège et complice de Rau depuis 2011) venu raconter que ce que l’on va voir a été l’objet d’une enquête. Lui s’est entretenu avec l’un des assassins en prison, a assisté au procès…
Et de regarder La Reprise comme un théâtre du reenactment (reconstitution) où « jouer au théâtre » revient à poser la question « qu’est-ce qu’on joue ? ». Et d’y répondre en 1H45, « on ne joue pas ». Non, « on ne joue plus ». Mais plutôt « il s’agit de re-jouer », d’entrer sur scène avec l’idée que c’est le lieu de l’actualisation et non de la représentation. Lieu du faire et non de l’imitation. Et d’évidence, parce que tous se sont documentés, les acteurs ici sont devenus des témoins. C’est-à-dire, au sens de superstes d’Agamben dans ce livre rare qu’est Ce qui reste d’Auschwitz, « celui qui a vécu quelque chose de bout en bout, a traversé un événement et peut donc en témoigner ». Du théâtre de Rau, on dira qu’il se forme à cet endroit-là, et qu’il impose que l’acteur soit celui qui est traversé.
La Reprise de Rau prendra alors la forme de cinq chapitres numérotés. Chapitre 1, Solitude des vivants. Chapitre 2, La douleur de l’autre. Chapitre 3, La banalité du mal. Chapitre 4, l’anatomie d’un crime. Chapitre 5, le lapin (Sara De Bosshere en flamand). Et d’un « épilogue » qui reprend, lors des auditions, l’histoire de l’acteur qui va monter sur une chaise et se pendre. Et, dixit Tom qui raconte l’histoire « si le spectateur ne bouge pas de sa place, alors l’acteur va mourir ». Cinq chapitre comme les cinq actes d’une tragédie, insiste-t-on du plateau avant de dépasser le dernier acte par quelques mots du Théâtre Impressions de la polonaise Wislawa Szumborska ; « Ressusciter sur les champs de bataille de la scène,/Réajuster les perruques et les vêtements,/Retirer le couteau de la poitrine,/Placer les vivants sur une seule ligne, avec le visage vers le public ». À la dernière image, l’acteur monte sur la chaise, passe la tête dans la corde, brume et noir. La salle applaudit. Et de se dire que personne n’aura bougé et que Rau a encore du travail avant de faire trembler le spectateur.

Faire le théâtre…
Qu’est-ce qu’on voit ? Comment on regarde ? serait-on tenté de dire à propos de la mise en scène de Milo Rau. Qu’est-ce qu’on voit exactement ? alors qu’un auteur-réalisateur, caméra à l’épaule ou sur trépied tourne les images en direct des comédiens qui s’exécutent, se mettent à nu, se livrent… L’image et son trouble est là opérante, tantôt prise directe et réfléchissant ce qui se passe sur scène ; tantôt presque identique mais enregistrée qui laisse voir un détail ou autre chose. L’image et son trouble, disons-nous, parce que l’image (trop souvent associée à un souci de spectaculaire) est ici le lieu qui problématise le regard et, en fait, la compréhension non seulement du fait divers rapporté, mais également de la fabrique du théâtre. À travers elle, c’est le temps, c’est le lieu, c’est l’action qui sont rendus complexes au sens où le rapport hypnotique qu’installe toujours la scène est brisé. En finir avec l’hypnose (disait Brecht), afin que quelque chose arrive. Pas de continuité donc, mais plutôt la création d’intervalles, de distances, de décrochages propices à générer chez le spectateur une alerte permanente.
C’est sans doute cela l’un des traits du travail de Milo Rau, faire du théâtre un espace d’alerte. Un champ de bataille scopique où le regard est sans cesse entre plateau et écran. Dans ce jeu de va et vient, scène comme écran, tout en étant complémentaire, joue également de concurrence et l’association des deux, simultanément, produit une logique de supplément.
Parallèlement à cette structuration du regard qui va modifier également l’écoute, Milo Rau, et ce d’un point de vue dramaturgique, fabrique son théâtre à vue. Comprenons par-là qu’il fait de chaque séquence le préalable nécessaire à la construction de la suivante. C’est un jeu d’emboîtements qui est ainsi mis en place et qui sert de conduite à l’histoire. Un peu comme si Rau voulait en finir avec l’effet de surprise (autre constituant du théâtre) qui rend chèvre le spectateur. En finir avec la surprise, en finir avec le goût du spectateur pour l’inattendu, en finir avec tout ce qui ferait que le théâtre serait maintenu à l’endroit d’une naïveté que cultive généreusement la pratique théâtrale… En finir donc, afin que commence un autre théâtre.
Ce que Milo Rau, avec La Reprise, amplifie avec l’intelligence de celui qui sait qu’il ne sert de rien de répéter les mêmes discours (celui du théâtre populaire a le cuir dur, celui du théâtre politique pas moins), mais qu’il faut au théâtre trouver le moyen de renouveler le discours qu’on tient sur lui et qu’il tient sur nous. Et peut-être de trouver les formes d’une intimité qui passe par un travail commun…




