Les émigrants, Krystian Lupa
création annulée Festival d'Avignon
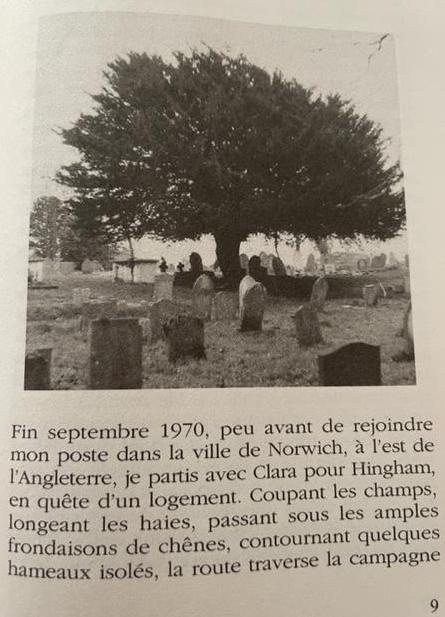
Les émigrants de Krystian Lupa… ?
Lupa : annulé en 2003, programmé en 2015 et 2016, « condamné » et annulé en 2023… Ce 18 juillet, un billet électronique, donc dématérialisé, dans le portable : à garder comme souvenir... Les émigrants de Lupa ne sera pas joué à l’Opéra théâtre d’Avignon pour la 77ème édition. Alors parler de ce qui vient à manquer… pourquoi ? Relire l’entretien des acteurs réalisé par Arielle Meyer-Macleod à propos de leur travail, à la Comédie de Genève ? Il faut craindre que, obéissant au show must go on, le silence se construira autour de ce « non-événement ». Jusqu’à la rencontre avec sa traductrice Agnieszka Zgieb prévue le 20 juillet à la Maison Jean Vilar qui disparaîtra elle aussi. En rester là ?
Qu’en dire…
« L’imaginaire, c’est un peu plus que l’imaginaire » écrivait Jean Duvignaud qui ne séparait pas la chose esthétique et poétique, des conditions de production qui l’environnent, et plus généralement de la société qui accueille les œuvres.
Avec l’annulation de la création de Krystian Lupa – Les émigrants de G. W. Sebald – à l’occasion du festival d’Avignon 2023, la bêtise, le non-dit et la corruption ont fait les choux gras des réseaux sociaux et de la presse culturelle, en les relayant, en les fabricant. Ce fut comme un jeu de « à qui mieux mieux » et chacun y allait de son petit argument, de sa petite dose d’acrimonie, de son petit poison/position : le grisonnant évoquant les cheveux blancs du vieux et des blanchis soi-disant responsables de l’état du monde (oubliant les luttes, les combats et les avancées qu’on leur devait). L’autre, poivre et sel, ignorant toute métaphore chez Lupa, prenant appui sur le drame des migrants et des enfants que rejette la méditerranée. Un tiers encore, dans le registre opposé, se lamentant telle une pleureuse sur l’atteinte portée au génie crie un « reviens »…
Au bal de la saison estivale, on assista à la multiplication des petits juges et autres donneurs de leçon qui, la main sur le cœur (ou le lieu occidental de la sincérité inattaquable), brandissaient des piques ornées de la tête du Polonais ou l’auréolaient des lauriers d’un César anachronique.
Qu’en dire ?
Idéologiquement, c’est un peu faible d’opposer le travailleur méprisé au génie nanti. Mais l’époque est ainsi faite que l’on est « avec les uns » et « contre les autres ». Stéréotype du choix du camp. Image représentative du choix du con. Ça manque de dialectique tout ça.
Stratégiquement, ça se comprend mieux et l’on ne peut soupçonner que les uns et les autres auraient oublié qu’un théâtre Suisse (la Comédie de Genève) et un festival d’Avignon, ça pesait tout de même plus lourd qu’un Polonais à la rue, bientôt octogénaire.
Philosophiquement, on leur en voudra à peine, mais tout de même. À défaut de tout excuser (et à raison l’attitude de Lupa est questionnable), peut-être auraient-ils pu écrire ou même crier que les conditions de travail artistique ne sont plus réunies sous le régime libéral qui uniformise les modes de production. Qu’en définitive, qu’on soit technicien ou créateur, les règles infernales (rythme, cadence, organisation du travail, salariés interchangeables…) s’appliquent à tous et toutes, comme à l’usine. Le responsable est donc un modèle économique ou un mode de production qui gomme la singularité du travail pour lui appliquer des règles de rentabilité unilatérale (gestion du temps). On ne vous demande pas d’avoir pris connaissance du « petit » essai de Laurent Vidal Les hommes lents, mais peut-être de penser l’origine des contraintes subies.
Moralement, vous aurez été, a priori, du côté de la victime. C’était sans surprise. Et c’est presque louable, mais ça ne mange pas de pain. Quand le « prolo » est malmené, il faut le défendre… Et c’est bien le seul endroit ou maladroitement, tout de même, vous aurez esquissé une analyse. L’argument majeure aura été « nous ne sommes plus à l’époque où… ». Et là de désespérer à nouveau… Car cela revient à légitimer ce qui se passait avant et penser que l’on fait mieux aujourd’hui… Raisonnement eurocentré qui ne tient pas compte des espaces où le temps n’a pas passé. On aurait pu attendre autre chose… Au hasard, par exemple, une analyse sur l’organisation verticale du travail, sur la manière de construire une équipe de création, sauf à penser que les techniciens ne sont pas eux aussi des créateurs, mais seulement des exécutants. Bref, poser la question morale de l’engagement, de la participation, etc. plutôt que de s’entêter à justifier un modèle de fonctionnement.
Enfin, artistiquement ? Artistiquement, rien ne fut dit sur Sebald et ce livre Les émigrants. Rien, pas un mot. Or ce n’est pas un Lupa que l’on ne verra pas à Avignon, mais une œuvre littéraire rare, de Sebald, jamais montée, adaptée, présentée.
Sophocle, Molière, Shakespeare, Ibsen et des trucs d’actualité (quand les premiers ne servent pas à illustrer le second) … comment y échapper ?
Mais Sebald… De mémoire de spectateur, le dernier fut Les Anneaux de Saturne de Kathie Mitchell, au gymnase Aubanel, en juillet 2012.
Artistiquement, à l’endroit de ce qui les regardait donc, ils auraient pu, sans se priver de leur goût de la curée, en bon paroissien du théâtre, ajouter à leurs accusations quelques lignes sur Les émigrants. On les aurait soudainement écoutés autrement.
Mais là-dessus rien. J’imagine « faute de temps » (c’est toujours le même argument).
Alors que faire ?
Alors une idée folle aura fait son chemin. Et si cela donne à ricaner, il me revient de parler de Les émigrants. Je vais imaginer ce que cela aurait pu être. Et, bien entendu, s’il ne s’agit pas de tout dire et de tout relever, il s’agira de ne rien manquer dans le peu qui sera rapporté.
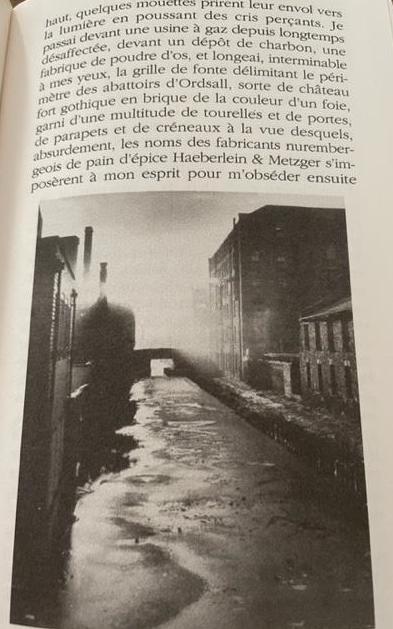
Lisant.
Peut-être prévenir d’abord que s’il faut entendre le titre[1], il ne doit pas rendre sourd aux pages qui suivent et vont de la page 9 à 276. Et qu’au terme de la lecture, il est difficile d’ignorer que Les émigrants apparaît avant tout, a priori, comme « la musique de la mémoire » dirait Pontalis ; et les tours qu’elle peut jouer. Mémoire faite de blancs, de trous, de béances… Archive imparfaite (le mot désigne aussi un temps en même temps qu’une mutilation). Mais archive tout de même.
Et « on sait très bien qu’il n’y a pas d’archives innocentes » comme le pensait Jacques Derrida. Et à travers elle qui est « arrangée » et s’arrange avec l’agencement des faits, c’est un monde de vivants, de fantômes et de spectres qui se repèrent (traces du réel) et de fictions qui naissent dans l’agglomération et l’entrecroisement de l’imagination et des vies vécues. Une sorte de jeu de piste infini, déréglé qui s’impose au narrateur : lieu d’émission et de réception de tous les récits. Lui, sans cesse, relance le jeu et cherche les ajustements. Après coup, ce sont les mêmes symptômes qui gagnent le lecteur. Effet miroir en quelque sorte où ce qui est renvoyé fonctionne par ricochets, par rebonds, par soubresauts.
Lisant Les émigrants et regardant les multiples photos qui sont insérées dans le cours du récit, c’est cela qui vient à la rétine et à la conscience. C’est cet amalgame entre ce qui a été vécu, qui peut être truqué (la photo p. 86, où aucune petite fille ne porte des lunettes) par l’activité mentale (l’écriture donc), et qui fait l’objet d’une mise en scène traversée par une multitude de récits. Archive, disons-nous, où l’on soupçonne qu’entre l’écriture et « les albums photos », entre le photographié et le graphié (l’écrit), quelque chose au creux de l’archive met en jeu un indiscernable autour duquel Les émigrants trouve son mouvement.
Voilà, pour commencer, peut-être que c’est cela qui viendrait à l’esprit (au terme de la première lecture) et qui serait dit aux interprètes.
« Vous allez être à l’œuvre pour que l’indiscernable devienne sensible, peut-être visible et audible ». Et chacun se tiendra à cette idée parce qu’en définitive, les vies que l’on croisera au long de Les émigrants (la multitude de personnages, la diversité des lieux, la temporalité qui va du début du XIX au XXI, les nombreuses situations et topographies, mais aussi les destins communs, les trajectoires communes, les lieux ou les points de chute identiques pour tous et toutes, etc.) installent ce livre dans un rapport à l’indiscernable.
Non pas le flou, le vague, l’approximatif… mais l’indiscernable.
C’est-à-dire, dans le récit, le moment où les limites et les frontières, dans le mouvement de l’exil, de la migration, du déplacement… sont des repères caducs. Car si les corps subissent celles-ci (dépaysement, bagages, bureau de l’immigration, hébergement de fortune, découverte, nouveauté…), il n’en va pas de même pour la vie de l’esprit. Pour le formuler simplement, « Quels rapports la mémoire entretient à la frontière ? », « Le souvenir s’arrête-t-il aux postes de douanes ? », « le passé ou le vécu se voit-il opposé, par le présent, des limites ? »
N’y a-t-il pas, à ces endroits de la vie intime, énigmatique et profonde des migrants, quelque chose qui relève d’un indiscernable et qui donne aux corps ses postures mélancoliques, ses solitudes tristes, cette nostalgie active, ce rythme funèbre à la pensée et aux gestes, son rythme quotidien… que l’on peut lire dans Les émigrants ?
Une photo de vacances perdue, un portrait d’antan illisible, l’odeur des Maultsachen, le croquant des biscuits de Meissen, la devanture d’un Grand Bazar, une couleur de ciel noir d’encre, la mer le soir, le relief d’un arbre dans un paysage, le cri du coucou japonais Hototogisu, une déambulation dans les quartiers paupérisés, l’image des ateliers le long des docks, une sensation de gène en marchant dans les beaux quartiers, un bibelot isolé dans un décor d’accueil, l’ambiance du bar Wadi Halfa tenu par une famille Massaï, l’auberge de l’Ange, le récit imprécis de la mort prématurée de Théo Bereyter racontée par la tante, les vitres brisées d’une manufacture, le son des sanglots de Theres, un derviche enfant, une résidence dans un hôtel de luxe recouvert de neige au matin, ou d’un pied à terre dans un hôtel sans étoile, un vilain tableau représentant le pays quitté accroché au mur, un bateau, un avion rutilant, un transport… une rencontre au terme d’un voyage, des bribes de conversation, une lettre chiffonnée, etc.
Tout cela relève d’une archive invisible qui habite sans cesse l’esprit. Et pour autant que le migrant a été inscrit dans un processus de déterritorialisation, ces détails du quotidien – du tragique quotidien fait de petites minutes supérieures – tout cela, donc, le reconduit à son point de départ, à l’instant d’un choix, d’une séparation, d’un détachement à des attachements… d’une vie qui n’est pas sécable.
D’une certaine manière, dans Les émigrants, il y a quelque chose du temps qui ne s’accorde pas avec son organisation chronologique (présent, passé, futur). Le temps de Les émigrants, c’est un « hors-temps » qui fusionne non pas des temporalités, mais qui assure la continuité de vies. Et c’est à cet endroit, encore, que joue l’indiscernable puisque ce « hors-temps » se mêle au temps qui passe, ou justement ce « temps qui ne passe pas » et qui fait l’épaisseur du temps même.
C’est dans ce rapport à des temps simultanés, brouillés, se chevauchant que s’écrit Les émigrants. « Temps » (et il faudrait enfin pouvoir ici isoler le « s » du mot invariable, y voir un pluriel donc) qui fait que dans Les émigrants, les figures que l’on croise et découvre sont habitées par la coexistence de lieux, de sensations, d’épisodes, d’accidents, de temps fusionnés… qui forment le tout d’une vie.
Dès lors, et si l’on suit cette idée de hors-temps, d’archive et d’indiscernable, et si d’aventure Les émigrants avait été représenté, il faut envisager que le symptôme dramaturgique à l’œuvre aurait fait en sorte d’amalgamer et de fusionner les différentes figures et les divers épisodes, tout en leur conservant, via un petit détail, via un léger écart, une différence. Ou, dit autrement, quand la différence permet justement d’entretenir une ressemblance. Puisqu’aucune vie n’est identique, même si le parcours de migrant favorise des points communs. Soit une manière, tout à la fois, de marquer des écarts et d’entretenir des continuités (thématiques, topographiques, chromatiques, sémantiques) entre les 4 sections du livre qui composent Les émigrants : 1/ Dr Henry Selwyn (de la page 9 à 33), 2/ Paul Bereyter (de la page 35 à 78), 3/ Ambros Adelwarth (de la page 79 à 179), enfin 4/ Max Ferber (de la page 173 à 276).
Les sections du livre…
Préalablement à une entrée dans chacune des sections, peut-être dire un mot sur ce qui est récurrent dans Les émigrants.
Commencer par souligner que les paysages urbains, les architectures, le regard porté aux pierres, aux façades, aux cheminées, aux intérieurs meublés, somptueux ou caverneux, aux espaces crasseux… ne sont jamais séparés d’un coup d’œil jeté à la nature et à sa diversité (arbres, herbes, animaux, monde minéral, animal et végétal). Ou une manière non pas de multiplier les descriptions, mais plutôt les translations, les déplacements, les migrations.
Souligner que les pays, pour les migrants qui essaient de quitter l’Europe, pour rejoindre l’Amérique, sont forcément la Suisse et l’Angleterre. Et qu’il y a là soit un SAS, soit une terre provisoire, soit une issue terminale.
Souligner également que le suicide, la dépression, la tristesse sont comme une respiration à chaque section. Soit une manière non pas d’entrer dans des psychologies, mais plutôt de rendre manifeste des états qui expliquent, peut-être, des rythmes, des postures, des façons d’être au monde, des repliements, des recroquevillements…
Souligner aussi que le personnage de l’instituteur ou de l’institutrice est constant. Ou une façon de mettre en dialogue « ce qui est dans les livres, les savoirs et les connaissances » et la réalité qui s’en écartent. Manière de faire miroiter, ici, l’écart entre une humanité idéalisée et une réalité trop souvent obscure.
Souligner encore que la guerre, l’exode du peuple juif, le peuple allemand sont indépassables. Soit une façon d’inscrire Les émigrants à l’endroit d’un témoignage quel qu’il soit, d’où qu’il soit et de livrer les raisons concrètes de certains exils.
Souligner que le motif de la rencontre, heureuse ou malheureuse, permet de traiter du dépaysement, de la découverte et d’ouvertures vers d’autres régions qu’elles soient topographiques ou mentales.
Souligner que le livre se développe en réseau, en atomes liés ; qu’il est parfois rattrapé par un « esprit d’escalier » qui inscrit le récit dans une étendue infinie. Manière d’emboîter les choses et les vies au-delà de leur vécu et de les faire miroiter ailleurs.
Souligner que ça parle, ça s’écrit en recourant à différentes langues, notamment la présence de l’anglais, parfois l’allemand mais rarement. Ou une façon de faire entendre les migrations qui sont aussi linguistiques. Manière de faire sonner l’étranger et l’étranger à la langue.
Souligner que la catégorie des migrants n’est pas homogène. Il y a ainsi les intégrés, parvenus à une forme de richesse ou demeurés dans la pauvreté. Il y a les arrivants, démunis. Il y a encore les résidents. Entre les trois, il y a l’accueil, l’hospitalité, des formes de dominations ou des rapports de lutte (y compris de classe). Il y a la bienveillance qui côtoie la charité ; la solidarité et l’entraide, mais également des formes de jalousie sourdes… Tout un univers de rapports humains donc. Mais surtout comprendre qu’entre les « intégrés » et les « nouveaux », c’est une histoire continue de déplacements, d’exils, de fuites, etc. Soit un renseignement sur les forces structurelles à l’œuvre dans les sociétés. Imaginer alors que certains vivent avec une valise toujours faite, quelques billets dans la poche du costume (comme Sartre), sur le « qui vive », sur le départ, tout le temps.
Souligner enfin que le « je » du narrateur (« ce pli grammatical » dit Blanchot), enfant ou adulte, est ce qui traverse l’ensemble des 4 sections. Chercheur, le « je » s’ouvre aux témoignages, aux récits qu’il recueille et qu’il fabrique, mais il est aussi celui qui pense, qui spécule, qui questionne, qui écrit le maillage, au présent, compliqué du récit.
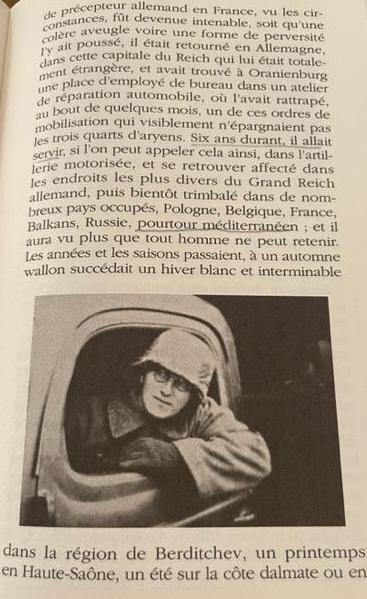
[…]
Alors juste après l’exergue minuscule, en bas de page (qui se répétera pour chaque chapitre), qui pose la question « et le reste n’est-il par le souvenir détruit » (énoncé troublant qui insinue que la mémoire et la vie, peut-être de migrants, mettent en péril quelque chose d’une intériorité profonde), il y a cette première section consacrée à Dr Henry Selwyn. Soit l’écriture d’une rencontre, la découverte d’une maison à la campagne, Prior’s gate, partiellement laissée à l’abandon, à Hingham. Un foyer curieux aux meubles laids « Altdeutsch » et où une jeune fille est un peu folle. Un lieu qu’habite Henry Selwyn, mais pas tout à fait puisqu’il se définit surtout comme « un habitant du jardin » laissé aussi à l’abandon où il « cultive ses réflexions » comme un « kind of ornamental ermit » et où il préfère la compagnie de ses trois chevaux et des plantes « ses seuls interlocuteurs avec qui il s’entend relativement bien ».
Section où l’on apprend encore que le Dr est un migrant juif qui a fui la Lituanie en 1899, avec toute sa famille, croyant prendre un billet pour l’Amérique et qui s’est retrouvé en Angleterre et dont le vrai nom est Hersch Seweryn. Homme déplacé donc, qui couve une longue dépression, qui a connu deux guerres, mais qui avait rencontré Johannes Naegli, un guide de haute montagne, en Suisse, peu avant la première guerre mondiale. Et ce guide qui disparait dans la montagne en 1914 a imprimé au Dr « la douleur d’une séparation [qui le conduit à rompre] avec le monde réel ». Incapable de surmonter cette douleur, il se suicidera avec son fusil de chasse quelques semaines plus tard. La fin de cette section étant marquée par la réapparition du corps du guide, en 1986, que rejettent les glaces de la montagne, alors que le narrateur évoque cet article lu dans un journal de Lausanne acheté à Zurich. Soit une réapparition 72 ans plus tard qui fait dire « voilà comment ils reviennent les morts ».
Peut-être le lecteur pourrait s’attarder sur les détails du suicide, peut-être sur l’état curieux de la jeune fille, peut-être notera-t-il l’évocation du sourire d’une institutrice ou la photo de Nabokov, peut-être s’arrêtera-t-il sur le jardin en friche… À la première section, peut-être Lupa aurait-il gardé ce motif du mauvais goût allemand « Altdeutsch ». Peut-être aurait-il sonorisé les deux guerres mondiales et ce coup de fusil du suicidaire. Sans doute aurait-il gardé ou montré le déchirement entre Hersch et Johannes, sur fond de relief montagneux glacé… Difficile d’imaginer ce qui n’aura pas lieu. Mais vraisemblablement, il y aurait eu, au plateau, quelque chose de l’ordre d’une solitude, d’une « âme en peine » et d’un ermitage.
Sans doute aussi quelque chose de l’incompréhension pour ce qui disparaît subitement. Un va et vient entre résignation et incompréhension. Et il y aurait eu, enfin, les feuilles d’un journal pris dans le vent. Et une voix qui aurait raconté que les morts n’en finissent pas de surprendre les vivants. Et rien ne dit que cela aurait été à l’ouverture de Les émigrants, puisque tout cela est filé dans les sections suivantes.
[…]
Et alors que le suicide de Hersch intervient à la fin de la première section, celui de Paul Bereyter est immédiatement lisible dès les 9 première lignes de la seconde section. Bereyter qui choisit de mettre fin à ses jours en s’allongeant sur la voie de chemin de fer ; la chose étant rapportée, une fois encore, par un journal local.
Instituteur aimé de tous, mais soumis aux contraintes du « Troisième Reich ». Homme ou « grand frère exemplaire » que ce Paul, radicalement différent de l’autre instituteur Maître Hormayer.
Bereyter qui refusait de donner des cours de religion et débordait le programme scolaire, aimait « les leçons de choses » qu’il inventait dans la nature avec ses élèves partis en virée. Bereyter qui aimait les marches dans la montagne, qui avait pour interlocuteur le cordonnier Colo « philosophe et athée notoire » et qui s’inquiétait du don incroyable qu’avait Mangold le simple d’esprit. Paul Bereyter qui était « en vérité le désespoir fait homme », presque tout « entier consumé par sa solitude intérieure », conscient politiquement de « l’anéantissement constamment à l’œuvre dans la vie de la nature ». Qui avait assisté à la déportation de son amie Helen Hollaender et qui, soudainement, plonge le récit dans la mise en place des lois aryennes et antijuives de l’Allemagne nazifiée. Paul Bereyter, le patriote qui s’engagera dans l’armée régulière allemande, parce qu’il était « profondément allemand ».
Section ou chapitre inversé donc, où l’on remonte de l’effet à la cause, de la mort de Bereyter à ce qui aura pu la provoquer. Chapitre où, soudain, l’Histoire fait son entrée visible : l’Allemagne nazie, les complicités, les exécutés, les patriotes, et le mythe de l’éducation humaniste qui s’envole avec la métamorphose des fonctionnaires de l’humanité. Moment où s’affirme la complexité des êtres, mais où surtout Bereyter, le patriote, est la figure de celui qui est attaché à sa terre. Sensation qui vaut sans doute aussi pour ceux qui sont contraints de la quitter. Chapitre des fantômes qui hantent l’Histoire, qui ne réapparaissent pas, mais sont néanmoins présents.
Il faut ainsi imaginer qu’il y aura à minima un bruit de train dans le lointain, le cliquetis des engins mécaniques militaires qui traversèrent l’Europe. Il y aura forcément ces bruits d’aboiement caractéristiques des quais de gare où les trains sont à destination des camps. Il y aura forcément un émigrant pris au piège qui prendra les traits d’un déporté. Il y aura forcément le visage d’Helen.
[…]
Les deux chapitres suivants (« Ambros Adelwarth » puis pour clore « Max Ferber ») sont d’abord plus volumineux (nombre de pages) que les deux premiers. Ce n’est pas un déséquilibre, mais une manière de rentrer dans la complexité labyrinthique de ces vies entremêlées et de mémoires-rhizomes qui s’entrecroisent et s’étendent sous deux formats, toujours avec la même précision, parfois écourtée, vers le détail le plus petit et la vue d’ensemble embrassée. Les pages de Les émigrants se lisent alors comme des cartes Michelin sur lesquelles sont dessinés des voyages, des tracés et des trajectoires, des étapes, des stations, des bifurcations, des mouvements d’aller-retour, des retours-en-arrière… Tout ou presque est placé sous le signe des guerres : « l’avant, le pendant et l’après » qui promeuvent des expériences et des situations différentes, partagées entre choix volontaires et/ou imposés.
À l’ombre de ces périodes, les vies ont été façonnées et modelées. Comme si tout ce qui était, même longtemps après, relevait d’un héritage. D’une certaine manière, pour partie, les émigrants sont tous les héritiers de cela qui a transformé les villes, les économies, les modes de vie, les existences… Et c’est peut-être là une chose qu’il faut relever : l’exil aura créé des relations nouvelles aux mondes, créant aussi de nouveaux mondes ou transformant celui qui était donné. Attachés à vie à une histoire, à une terre natale, à une langue… à de nouveaux territoires, de nouvelles pratiques linguistiques… les émigrants forment un peuple diasporique césuré. Ou quelque chose que Hölderlin, quand il convoquait cette notion (« césuré »), pensait comme la forme que prend le tragique. On pourrait traduire par « déchirer », si par-là on comprend une intériorité divisée où la division devient consubstantielle à l’être. « On vit avec » en quelque sorte et la mémoire figure ce lieu du « césuré ».
Histoire de mondes donc qui fait dire à l’oncle Kasimir « mein feld ist die Welt » (« le monde entier est mon domaine », est-il traduit). Ou une formule qui annule toutes les frontières, sans pour autant gommer la diversité des pays traversés. Et où la frontière annulée, les repères sont brouillés.
Héritiers et aussi notaires, en définitive, car « notaires » ils le sont tous aussi qui, par les familles qui s’inquiètent les unes des autres, éloignées mais toujours proches, se transmettent les secrets et les histoires qui peuplent ces vies en mouvement.
Lire Les émigrants, c’est comme rentré dans une étude notariale clandestine où chacun et chacune est en charge d’une ou plusieurs vies. Ou un morceau de connaissance est partagé entre plusieurs témoins qui forment à eux tous les racines d’un arbre généalogique. Arbre et existences… donc, comme peut-être l’indique la première photo au commencement du livre qui représente un grand arbre au milieu d’un cimetière.
Il y a ainsi quelque chose de patrimonial et de notarial dans ce récit.
Quelque chose qui fait de chacun et de chacune le « secrétaire particulier » d’un tiers et qui, comme le meuble du même nom, est construit sur le principe d’une cache à secret.
Au chapitre intitulé Ambros Adelwarth, c’est cette figure de « secrétaire particulier » qui apparaîtra à travers les témoignages de la Tante Fini et de l’oncle Kasimir (dont les versions ne se recoupent pas). Car si l’on entre dans l’intimité des Adelwarth (une partie vit aux USA et en Angleterre, l’autre est restée en Allemagne), si l’on est renseigné sur l’exil et l’installation des-uns ainsi que le « mal du pays » des autres, c’est surtout la rencontre d’Ambros Adelwarth et de Cosmo Solomon qui est scrutée.
Deux hautes figures de l’exil qui, dans ces temps de guerre, parcourent le monde, gagnent Jérusalem, et font vivre l’amitié. Deux légendes ou deux mythes, rassurants mais rares, comme seuls les exilés sont à même d’en produire. Deux classes sociales différentes où l’un (Cosmo) est fortuné, quand l’autre (Ambros) s’en remet à sa bonne fortune. Façon de nommer ici, la réussite de l’émigrant, sa manière d’avoir passé les épreuves de l’étranger, sa façon d’avoir « gagné » les droits de l’autochtone, etc. Et précisons que si, a priori, on pourrait voir dans « l’association » Ambros/Cosmo, une histoire de solidarité et de communauté, il n’en est rien, car l’intégration, au pays du self made man passe par l’abandon de ce que l’on a été, pour ressembler à ce que l’on ne sera jamais vraiment. Entre Ambros (passé maître dans les langues qui a été instruit de toutes les subtilités des métiers de l’hôtellerie en Suisse) et Cosmo (l’héritier de la banque new-yorkaise de son père, Cosmo le constructeur de machines volantes, Dandy joueur de polo et de roulette dans les casinos), il n’y avait rien de commun, sinon une amitié à faire émerger, à construire.
De New york à Constantinople en passant par Francfort, de Venise à Deauville et ses jeux aéronautiques en baie de Seine, de Monte-Carlo à Long Island, de la Croatie à Beyrouth à Alep… Cosmo le joueur engrange des fortunes et s’offre même un avion de l’industriel français Deutsch (ou déjà un mode d’annexion ou une forme de mondialisation à l’œuvre).
Et ce qui apparaît à travers le nomadisme de Cosmo et Ambros (nomadisme qui révèle aussi que l’exilé ne se satisfait jamais du pays d’accueil et qu’il est en transit), c’est encore et aussi le rapport spéculatif que prend le pli du monde. Cosmo fait sauter la banque dans chaque casino qu’il essore… Signe annonciateur d’un monde (financier) qui est au bord de l’explosion.
Et comme à l’écoute de ces vies, le narrateur ou le rejeton de la famille Adelwarth lorgne un temps ces destinés, songe à son américanisation avant d’y renoncer.
Années folles de ribouldingues et autres découvertes, tout a pourtant une fin et, sans que l’explication ne soit donnée, Cosmo, se retirant lui aussi dans une petite maison au fond du parc de la demeure familiale, plonge dans « une sombre mélancolie » au bout de laquelle la maladie mentale l’atteindra et le conduit à « percevoir dans sa tête ce qui se passait en Europe, le feu et le sang, les agonies, les décompositions sous le soleil ». Et de lire, là encore, le dévouement d’Ambros qui le nourrit de petites bouchées de homard, lui le serviteur, l’ami, le « frère » est-il dit. Ambros qui, à son tour, se réfugie dans une petite maison donnée par les Solomon. Ambros qui n’est plus lui aussi que l’ombre de lui-même après la mort de son ami. Ambros dépérissant à son tour.
La guerre, la première, est alors à l’œuvre. Et le vieux Solomon, le père banquier, tombe lui aussi en dépression, développant le syndrome de Korsakoy (où la perte du souvenir est compensée par des inventions fantastiques). Soit une indication qui vaut non seulement pour l’histoire des Solomon, mais également pour l’écriture, pour la littérature et la construction de Les émigrants.
Poursuivant la lecture, on voit alors le narrateur courir après son histoire, en quête d’une cohérence convenable auprès de qui pourrait lui donner. On y croise alors le Dr Abramsky, lui-même peut-être fou, qui lui parle du psychiatre Fahnstock, lequel aurait traité la dépression ou la folie d’Ambros et lui confie qu’il (Abramsky) aurait écrit un traité sur cette « drôle de figure » s’il en avait eu le temps.
La folie est partout, comme le souvenir et le monde le sont aussi. Un peu comme une maladie contagieuse de l’esprit… Une maladie que contracteraient plus facilement les exilés. Une sorte de virus qui guette et qui s’approche de ces vies. Maladie qui n’est pas sans roder autour du narrateur qui, en quête d’origines, de causes, de documentations finit par écrire : « comme toujours ou presque dans les rêves, les morts ne parlaient pas et semblaient un peu contrits et abattus. Ils se comportaient en coutre comme si leur condition d’exilés, pour ainsi dire, était un terrible secret de famille ». Obsessions ou syndrome de Korsakoy, le lecteur ne peut trancher. Lui-même est désormais dans la tourmente de cette recherche.
Comme pour le narrateur, le témoignage de la Tante Fini le rassure un peu et quand cela ne suffit plus, il s’attarde sur l’Agenda de l’année 1913 d’Ambros. Mi journal de bord, mi journal de voyage, mi note-book, qui révèle autant qu’il dissimule, qui donne des pistes autant qu’il les brouille. Journal d’Ambros où à la dernière annotation de l’Agenda qui est aussi les dernières lignes du troisième chapitre, il écrit : « le souvenir, ajoutait-il dans un post-scriptum, m’apparaît souvent comme une forme de bêtise. On a la tête lourde, on est pris de vertige, comme si le regard ne se portait pas en arrière pour s’enfoncer dans les couloirs du temps révolu, mais plongeait vers la terre du haut d’une de ces tours qui se perdent dans le ciel ».
Ultime note de l’Agenda qui devient carnet philosophique d’Ambros lequel, comme par malice, renvoie au narrateur et au lecteur (ce couple de curieux, ces petits Holmes et Watson) un commentaire sur l’action qu’ils conduisent. L’un et l’autre suivant pas à pas ces destins opaques ; le narrateur retournant sur les lieux, dans les hôtels… tentant, autant que possible de lever l’indiscernable.
Au vrai, se mettre en quête de ces vies délivre alors un nouvel enseignement et, parallèlement aux enquêtes qui tendent à identifier des situations, des lieux, des passages… la recherche livre aussi des états d’âme, des pensées, des réflexions de ces exilés qui, pour autant qu’ils sont pris dans les turpitudes de leur histoire, n’ont pas pour autant cessé d’avoir un lien avec « la vie de l’esprit » et l’existence de la pensée.
[…]
Il reste 101 pages et la lecture de Les émigrants sera achevée. Pour autant, le lecteur le sait déjà, l’effet de la lecture se poursuivra et lire un livre met toujours à l’endroit d’une hantologie dont il a déjà fait l’expérience, sans savoir ce qui soudain reviendra.
Sans trop être capable de mesurer ce qui arrivera, le peu qu’il a lu a pourtant déjà modifié sa mémoire. Paul Bereyter, Helen, Cosmo et Ambros, la tristesse de Henry Selwyn, la photo du grand arbre au milieu du cimetière, la petite fille sans lunette sur la photo, Deauville… S’il n’est pas devenu le familier des émigrants, ils ne lui sont plus totalement étrangers. Bien sûr, il n’est pas en mesure de parler de ce que vivent les émigrants, mais il a déjà éprouvé à travers ses propres voyages, au Brésil, en Angleterre, en Allemagne, au Liban, en Uruguay, en Italie… quelques-unes des sensations qui sont décrites : une manière de regarder une langue sur un panneau, d’essayer de parler avec un chauffeur de bus, de découvrir une chambre d’hôtel et ses environs, de marcher sans trop savoir où l’on va, de s’arrêter devant ce qui est pris pour un monument…
Il est, en quelque sorte, devenu plus attentif à ce qu’il avait vécu jusqu’à maintenant comme un touriste, car le touriste sait qu’il rentre. Il est devenu, en quelque sorte, plus proche des émigrants car, en définitive, il pourrait être l’un d’eux, peut-être un jour, puisque l’histoire est encore à venir et que la XXIème siècle semble s’annoncer noir.
En ouvrant le livre au dernier chapitre intitulé Max Ferber, ce sont les années 60 (précisément et d’abord l’année 1966) qui apparaissent, du moins au début. Les guerres mondiales – désormais la guerre froide et les guerres coloniales jalonnent cette période – ont laissé des traces partout, dans l’esprit et les corps, comme aussi des empreintes sur les villes. Si la reconstruction joue comme un gommage de celles-ci, rien n’appartient vraiment au passé. Les exilés, eux, sont entrés dans l’histoire comme une conséquence de tout cela. Ils sont d’ici et de là, et vivent maintenant comme : « comme des suisses, comme des américains, comme des canadiens, comme des anglais… ». Ils sont « presque », dira-t-on, afin de marquer la petite marge distincte qui les rend toutefois étrangers à la terre d’accueil.
Au commencement du dernier chapitre, c’est le « je » anonyme ou cette voix sans figure ni souveraine ni domestique, depuis le début – « je » ou le représentant d’une longue dynastie prise dans des origines dissimulées : celle du narrateur ou d’un personnage jamais nommé, d’aucun dirait « Sebald » – qui raconte son arrivée à « Manchester la ville d’émigrant », la « Jérusalem de l’industrie », port déclinant, pour ses « recherches ». C’est ce « je » qui découvre Manchester, après avoir quitté la Suisse, passé les tracasseries de la douane anglaise, et qui vivra dans la Pension Arosa ou un hôtel de passe que tient Garcie Irlam qui l’accueille dans une robe de chambre rose. Vêtement (dit candlewick) réservé « aux classes inférieures anglaises ». La première qui, s’adressant à « Je » lui rappelle qu’il est « an alien ».

Le temps a passé, les repères restent. La société anglaise, fermée, n’est pas le mirage du rêve américain ouvert. « Je » découvre sa chambre minable, son plaide typique et cette drôle de machine qui fait le thé et sert de réveil matin : Le tea-maid, dont une photo est jointe afin que l’on puisse se représenter l’engin digne d’un concours Lépine. « Je » à mesure qu’il s’enhardira, découvrira la ville telle qu’elle est, pauvre. Il en avait eu le pressentiment en la survolant la nuit, à son arrivée, elle qui ne brillait pas de mille lumières. Il découvrira l’ancien quartier juif derrière Victoria Station… il découvrira les dimanches d’ennuis profonds. Et c’est au hasard d’une errance dominicale, qu’il va entrer dans l’atelier du peintre Max Ferber.
Un chevalet au centre d’une pièce, de 12×12, Ferber le peintre gratteur qui, à mesure qu’il applique la peinture, la gratte ultérieurement, accumulant au sol une couche de poussière de « plusieurs pouces ». « La poussière, dit-il, lui était beaucoup plus familière que la lumière ». Ferber produisait donc de la poussière, réalisait des portraits et les anéantissait. Des portraits que « Je » regarde telle « une longue lignée d’ancêtres aux visages gris, surgis de leurs cendres ». Et c’est avec Ferber que « Je » découvre le Wadi Halfa, un bar clandestin tenu par une tribu Massaï composé d’un chef de quatre-vingts ans et ses enfants dont le plus vieux avait soixante ans et le plus jeune 12.
Ferber qui fait de son art « une étude de la destruction ».
L’histoire pourrait s’arrêter là, mais le récit se fait plus précis quelques années plus tard. « Je », rentré en Suisse, ne supporte plus le mode de vie helvète. En 1969, il revient à Manchester et découvre dans un journal que Ferber est devenu un peintre bancable, exposé, qui se vend cher ou sur lequel on spécule, alors que lui continue de vivre comme il a toujours vécu, à l’ombre de l’amandier qui jouxte son atelier.
Et alors que le récit de la rencontre entre Ferber et le narrateur n’évoquait rien de l’histoire dont ils sortaient tous les deux, l’immersion ou le retour en arrière va soudainement se faire dans la communauté juive allemande. Il serait vain de vouloir tout rapporter, mais peut-être quelques phrases donneront-elles des informations qui valent pour tous Les émigrants et chacun des chapitres qui le composent.
L’Allemagne nazie s’y trouve décrite et explique l’impossibilité de parler l’allemand : « Cette perte et cet ensevelissement de la langue [avaient] quelque chose à voir avec le fait que mes souvenirs ne remontent pas plus loin qu’à ma neuvième ou huitième année et qu’il ne me reste de l’époque de Munich après 1933 guère plus que les processions, les défilés et les parades pour lesquels visiblement les occasions ne manquaient point ». Période où apparaît « Un nouveau type d’humanité » qui se nourrira, entre autres, du périssement de la communauté juive.
Ferber, lui, a vécu tout cela, a vu ses parents déportés en 1941, a fréquenté à son arrivée à Manchester « l’école […] on eut dit un asile ou un pénitencier » où les enseignants était d’anciens acteurs. Pour la seconde fois, le « théâtre » apparait dans le récit.
Entre le narrateur et Ferber, la relation n’est plus simplement le résultat d’une rencontre, mais plutôt celle d’un passage de témoin, notamment quand il lui donne le journal que sa mère Luiza, née Lanzberg, a tenu de 1939 à 1941.
Journal où alors que le monde appartient aux bouchers, elle écrit son mode de vie au jour le jour, son quotidien… comme s’il fallait consigner ce qui a disparu en ces temps de guerre. Journal de femme au foyer qui parle recette, ménage, course, éducation des enfants, vie heureuse… dans un monde où plus rien de cela ne semble compter ou pouvoir exister.
Journal fossile, et rupestre, où sur les feuilles-parois l’écriture dessine les scènes de la vie qui a été enterrée.
Et c’est à partir de cette archive que « Je » reconstruit une histoire de l’Europe qui débordera sur le reste du monde. C’est à partir de ces lignes que les familles se « recomposent » ; que l’on apprend que le ghetto polonais de Lodz s’appelait « Polski Manczester » (Ce que Lupa ne peut ignorer en ayant à l’école de cinéma de Lodz) . Travail de reconstruction où « Je » confie : « mon travail d’écriture qui avance toujours à pas très lent ». Phrase qui explique moins une compétence d’auteur qu’une difficulté à recoller ces vies, à en retrouver les origines, à les découvrir en une langue qu’on ne parle plus ou que l’on a partiellement oubliée dans l’exil. Reconstitution où rien du nazisme ne semble explicable au plan rationnel et qui génère des hypothèses invraisemblables : « les Allemands n’avaient peut-être rien tant envié aux juifs que leurs beaux noms, si liés au pays et à la langue dans lesquels ils vivaient ».
Au terme du livre, en ce dernier chapitre, on est saisi par l’idée que Les émigrants se lit non seulement comme le récit de ceux qui découvrent un pays d’accueil, mais aussi et surtout ceux qui, après le désastre, découvre le pays de leurs racines. Dans ce double mouvement, « Je » est comme césuré, hantant les lieux, les espaces, cherchant les témoignages qui sont pris dans un compte à rebours qui veut que les traces, les paroles disparaissent avec le temps qui passe et que seule la littérature est à même de ralentir.
Non pas « le temps retrouvé » comme la quatrième de couverture le souligne, mais le temps immobile. Comme l’image immobile qu’est la multitude de photos qui jalonne le récit et qui, Barthes l’aura écrit quand il en parle, rappelle que : « ça a été ». Au vrai, l’énoncé qui pointe l’indiscernable ou la présence de la mort en lieu et place du principe argentique.
Esquisse scénique
On raconte que Rainer Maria Rilke, au cours d’une promenade, aurait dit : « supposons que vienne un temps où les tableaux et les statues que nous admirons aujourd’hui se soient désagrégés ou que vienne après nous une race d’hommes qui ne comprenne plus les œuvres de nos poètes et de nos penseurs, voire même une époque géologique où tout ce qui vit sur terre sera devenu muet ».
C’est cela qui me vient en tête quand j’achève la lecture de Les émigrants.
Supposons que les sociétés oublient ce par quoi elles furent traversées. Supposons que la mémoire défaillante, prise de trous de mémoire, conduise à nouveau ces sociétés dans les délires ou les désirs meurtriers qu’elles engendrent.
Supposons une amnésie.
J’imagine que Kristina Lupa n’est pas loin d’y songer également.
J’imagine encore que si Les émigrants a retenu son attention, ce n’est pas pour brosser une fresque historique. Pas davantage pour l’utiliser comme une parabole ou pour faire entendre le murmure d’une voix endeuillée. Mais j’imagine seulement, puisque son essai Utopia i jej mieszkancy (1994) n’est toujours pas traduit, que rien de ce que je pourrais dire n’échappera au fantasme.
Reste quelques bribes de sa parole Manifeste qui rappelle que sa pratique tend à essayer de saisir, « toucher le mystère d’un événement quotidien », et qu’il s’agit « d’être honnête avec soi-même et observer un dépassement des frontières que forme la conscience dans le processus artistique ». Et puis il y a cette expression inventée « Disclosure Theatre » qui, dans le Manifeste du metteur en scène, imagine le théâtre comme l’une des possibilités de connaître et de transcender les limites de la personnalité humaine. Un théâtre épiphanique devrait-on comprendre ?
Au vrai, Lupa s’apparente à un métaphysicien anachronique qui a en tête, comme Fiodor D, de « trouver l’énigme » qui fait de notre voyage terrestre, une lutte contre les hégémonies, à commencer par celle qui concerne le sujet qui croit en lui-même comme la seule origine de toute chose. Et en ce sens, la scène sera le lieu de l’apparition non plus d’êtres, mais de conditions d’étants. Soit des ombres, voire des l’un-seuls, qui vont et viennent au gré des tableaux.
Sur la scène de l’Opéra Avignon, le décor pourrait être alternativement un hangar, un quai de gare ou un hall d’aéroport, un intérieur de maison anglaise donnant sur un jardin à peine entretenu, une ruelle ou un boulevard. Peut-être quelques chaises dans un café d’antan ou une cantine scolaire abandonnée… on passerait de l’un à l’autre en recourant à quelques projections vidéo qui nous floueraient des frontières et des limites, tout en marquant un rapport à des temporalités distinctes où les rides de l’un, les costumes et la mode des autres, les paysages urbains (en ruines, en construction, à l’abandon), jusqu’aux sons qui rappellent que le temps qui passe est aussi une sonorité… seraient comme ce qui conduit le passage d’un temps à un autre, d’une mémoire à une autre, d’un exil à un autre. Un hors-temps. Il y aurait aussi des fondus enchaînés et des superpositions d’images, car seuls ceux-ci seront à même de mettre en place l’unité de ces familles et de ces personnages. Seuls ceux-ci seraient à même, également, de rendre le caractère spectral de ce récit kaléidoscopique.
Tout cela est possible, sans doute, mais comment en être certain ? Le mouvement serait-il ralenti et pris dans une forme de pesanteur qui tiendrait à la mélancolie, à la tristesse, à la dépression et aux issues funèbres qui les ponctuent ? Serait-il ralenti par la recherche ou l’enquête sur l’itinéraire de ces vies : ce tissage de cohérences et de logiques ?
Quelque chose d’un ordre mental en équilibre serait continu et il faudrait lui trouver également un son. Un son lointain qui ne serait ni plainte, ni douleur, mais une respiration musicale. Peut-être un rythme proche d’une ritournelle… une chanson fredonnée.
Chaque rencontre serait placée, tout d’abord, sur le mode des retrouvailles, ce qui induirait des comportements subtils de rapprochements, d’intimités à réinventer, d’hésitation gestuelle, de distance corporelle à dépasser ou pas, de complicités qu’il faut retrouver parce que le temps à désœuvrer les liens. Recueillir l’intimité de l’autre n’a jamais été facile.
Chaque rencontre avec un inconnu se ferait sur un mode enthousiaste. Comme l’enthousiasme, même retenu, qui est à l’œuvre quand il n’y a pas encore d’histoires et de passé commun. Chaque lieu serait un topos du possible.
De ces rencontres, Lupa aurait à cœur de faire entendre les tête-à-tête où le témoignage est mis en commun. Il y aurait écoute et il y aurait question. Il y aurait récit.
La parole soutiendrait ce nouveau mouvement qui serait non plus dialectique, mais poïetique. Il y aurait seulement ça. Quelque chose d’une construction commune servant à rassembler des vies éparpillées, à sortir de l’ombre des lambeaux d’existence.
Un rien de lumière viendrait alors éclairer le plateau… Elle s’apparenterait, peut-être, à celle des régions traversées : ici chaude, là éclatante, plus loin rendue à l’animalité entre chien et loup, parfois brumeuse… Elle relèverait de la rétine de l’âme.
Et s’il était un tableau que j’espérais de Les émigrants de Lupa, c’est peut-être ce qu’il aurait fait de Max Ferber, le peintre-gratteur comme je l’ai appelé.
Ça serait le tableau final. Et alors, en fond de scène, peut-être, parmi les poussières accumulées au sol, mi peinture, mi graphite, mi ruines… apparaîtrait le visage d’Helen. Un immense portrait, d’Helen Hollaender, sur une feuille de papier vieilli, au milieu des ruines de « Polski Manczester » et des tours de New York projetées en fond. Un portrait à peine visible, ou disons à peine reconnaissable (« celui des morts qui reviennent »), parce que de toutes les manières, le visage n’est pas le lieu de l’identité, mais seulement la surface changeante où s’impriment les années. Lieu des métamorphoses. On le confondrait, peut-être, avec le dernier autoportrait d’Antonin Artaud… celui de 1947.
Tout ce qui aura été joué aurait ainsi eu à voir avec un processus d’apparition et de disparition, dans un désordre logique puisque l’un jamais ne précède l’autre, pas plus que l’autre ne précède l’un, dans Les émigrants. Ou une œuvre, en définitive, qui n’aurait à voir qu’avec les commencements, les recommencements et l’indiscernable, l’ineffaçable.

[1] W.G. Sebald, Les émigrants, Actes Sud, 1999.
