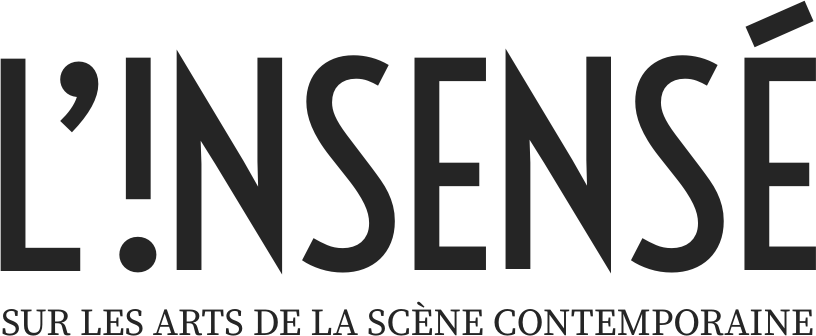Intimes convictions : scène de la vengeance et de la dignité
Article 353 du code pénal, d’après le roman Tanguy Viel (Minuit, 2017), mise en scène d'Emmanuel Noblet
Un homme confesse, et dans ce geste prend la parole comme un dernier recours où se rejouerait le procès du monde : il dépose devant le juge, devant nous, cette parole qui est à la fois témoignage, accusation, soulèvement. Le théâtre, ici, tient ensemble la scène policière de l’interrogatoire, la scène religieuse de l’aveu, et la scène politique de la prise de parole. Dans cette articulation, la confession devient adresse : elle ne cherche pas l’absolution, mais la possibilité d’être entendu ; elle ne demande pas pardon, mais appelle à partager une responsabilité. Sur le plateau d’Emmanuel Noblet, la langue de Tanguy Viel se replie sur l’intime pour mieux se jeter sur le collectif, et ouvrir la question de ce que nous faisons, nous, spectateurs-jurés, de ce qui nous est confié.

Le spectacle s’ouvre donc sur une adresse : un homme, Vincent Garanger, intense et précis, demande qu’on lui ôte les menottes pour pouvoir répondre – répondre au juge qui l’interroge, répondre de ses actes. Et soudain, ce n’est plus seulement un personnage qui se raconte, c’est une classe sociale qui trouve, par le détour du théâtre, une manière de dire ce qu’on n’entend presque jamais dans l’espace public. Quand la personne se jette dans {personne} – celui qui ne compte pas, n’a pas part, selon la formule de Rancière, aux partages de la parole publique – , pour devenir quelqu’un où fond le tout de l’humaine condition. Celui qui n’a pas voix au chapitre, soudain, lève la voix. Ainsi, ce qui s’avance sur le plateau, c’est moins l’histoire d’un crime que le récit d’une déprise qui viserait à reprendre possession de sa vie : celle d’un marin-pêcheur pris dans les rets d’un promoteur véreux, celle d’un territoire ravagé par la spéculation, celle d’un corps social relégué aux marges d’un monde qui se prétend moderne.
C’est l’histoire de Martial Kermeur, ancien ouvrier de l’arsenal devenu chômeur, trompé par un promoteur immobilier, un certain Antoine Lazennec qui l’a dépouillé de ses économies et de son avenir – Kermeur qui, dans un geste à la fois fou et implacable, finit par le jeter à la mer. {Finit} ? C’est là pourtant que commence le récit de Tanguy Viel (le spectacle) : aucun suspense. Oui, Kermeur est coupable aux yeux de la loi, et il ne se défendra pas – au contraire, dans ce geste pleinement assumé, il a reconquis sa dignité et ne s’esquivera pas. Seulement, sa « culpabilité » le rend-il « coupable » ? Pourquoi {au juste} a-t-il commis ce crime ? Le juge demande à Kermeur d’expliquer ce geste et de reprendre « depuis le début ». Le récit remonte alors en amont du geste criminel pour en retracer la généalogie, ce qui précède les premières pages — et c’est une toute autre histoire qui se raconte. L’histoire d’un homme trompé par l’Histoire, menti, d’un corps social humilié par le pouvoir économique ; l’histoire d’une région aussi, la Bretagne, que les promesses d’un progrès illusoire ont laissée exsangue : port abandonné, usines fermées, villages désertés. Le meurtre alors ne se comprend pas comme l’énigme d’un polar, mais comme le symptôme d’une faillite collective. Et le récit de raconter tout autre chose que les faits bruts et purs, ces faits recherchés aveuglement par l’instruction judiciaire et qui témoignent avec accablement : ce qui se raconte serait plutôt le renversement du corps victimaire en corps assaillant. La reconquête d’une dignité bafouée.
Sur le plateau, le lieu de la représentation — une cellule de commissariat de province, étroite et confinée — se déploie en un lieu représenté déréalisé : un chantier à l’abandon, avec son trou de terre dans l’herbe verte, un tombeau en friche où gisent les espoirs des hommes trop crédules. La situation d’audition de l’accusé devant son juge (interprété par le metteur en scène lui-même, Emmanuel Noblet, sobre et profond) se métamorphose ainsi en espace symbolique, où la contrainte carcérale et l’enfermement psychologique dialoguent avec la dépossession sociale et territoriale qu’incarne ce chantier laissé aux promesses trahies. Ce déplacement d’un lieu clos vers un extérieur apparemment vaste — la rade de Brest, la presqu’île transformée par les promoteurs et vite abandonnée — installe une tension entre enfermement et liberté illusoire, entre contrainte individuelle et dépossession collective. L’écran, qui diffuse de temps à autres des plans de la mer, accentue cette sensation d’espace ouvert, de respiration et de fuite possibles, mais toujours sous l’ombre du système qui broie. Emmanuel Noblet choisit ainsi la sobriété : dépouillé, le plateau est réduit à son ossature et renvoyé à l’énigme de son allégorie, scénographie faite silence pour que résonne la langue de Tanguy Viel — langue sans ornement qui épouse les contours d’une parole ordinaire et qui, par là même, rend visible ce qui trop souvent demeure hors-champ. C’est là que réside l’élégance de ce geste théâtral : refuser l’illusion spectaculaire pour laisser toute la place à cette langue patiente et latente, qui dit la misère sociale, les humiliations communes, la mécanique implacable par laquelle un homme est conduit jusqu’au meurtre. Le théâtre devient ainsi cette chambre d’audience où se rejoue, sous nos yeux, la tension entre la loi et la justice.
Et c’est là que le spectacle touche à son enjeu politique : non pas dénoncer de l’extérieur les violences économiques, mais les faire entendre depuis la perception intime de celui qui les subit. Le spectateur est convoqué, placé dans la position du juge, sommé de mesurer ce que veut dire « responsabilité » lorsqu’un système entier produit les conditions du crime. L’« intime conviction » que consacre l’article 353 du code de procédure pénale ne s’entend plus seulement dans le droit : elle devient la question adressée à chacun de nous sur ce que nous considérons comme tolérable dans l’ordre du monde. Il suffit de suivre le fil des mots pour entendre comment le droit, censé rendre justice, se retourne contre ceux qu’il devrait protéger. L’article 353 du code pénal devient alors le nom d’une brèche : la possibilité, dans les interstices de la loi, de faire entendre la légitimité de la colère face aux puissances de l’argent. Dès lors le théâtre redouble la scène judiciaire : il ne s’agit plus seulement de représenter une histoire, mais de contraindre chacun de nous à entrer dans la position du juré. Juré de quoi ? Non pas tant pour décider de jeter (ou non) un homme en prison, mais pour juger de ce qui fonde la vérité d’un fait, arraché à sa nudité, et le situer enfin sur le plan historique, dans sa conjoncture et sous l’immense prisme des structures sociales. L’article 353 du code de procédure pénale, lu en cour d’assises avant le délibéré, trouve alors sur le plateau une nouvelle adresse :
« Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “Avez-vous une intime conviction ?” »

Au théâtre comme au tribunal, rien ne nous est imposé sinon cela : répondre à cette question. Et c’est bien là, sans doute, la définition d’un théâtre véritable — non celui qui se contente de représenter le monde, mais celui qui nous oblige à nous situer en ce monde, éprouver dans le secret de notre conscience ce que nous tenons pour juste et vrai, à décider ce que nous faisons de ce que nous venons d’entendre.
Comme dans Le Procès de Kafka, le spectateur pourrait être tenté de se faire juge de l’accusé, de mesurer, de trancher, de classer le geste selon le code pénal et la morale. Mais le spectacle d’Emmanuel Noblet refuse cette tentation : il nous place dans une position plus juste et plus exigeante. Nous ne sommes pas appelés à condamner Martial Kermeur, mais à juger de notre propre humanité face aux conditions qui ont rendu possible son acte. Là où Kafka met en scène l’impuissance d’un individu face à un système opaque, Noblet et Viel nous offrent un espace d’écoute et de réflexion : la salle devient tribunal de nos consciences, lieu où la question n’est plus de savoir si l’homme est coupable, mais de mesurer la portée des mécanismes sociaux, économiques et moraux qui façonnent ce que nous considérons comme juste.
Politique, le mot jeté à tout vent sur les spectacles – mêmes les moins politiques, peut-être surtout les moins, ceux qui convoquent le motif social pour mieux le neutraliser dans le conformisme de sa représentation (comme si illustrer par la scène une question sociale suffisait de caution morale), alors que ce n’est pas le savoir de la domination qui nous manque, au contraire : « ce savoir ne nous donne aucune arme contre elle » note Rancière dans un récent entretien au Monde. « Il nous incite bien plutôt à nous soumettre à la nécessité des choses, avec la seule consolation de savoir ce qu’ignorent les ignorants et de mépriser les puissances qui nous méprisent. » Il est temps de sortir de la logique de la soumission et des illusions du savoir, pour entrer finalement par effraction dans le pouvoir : non celui qui fait autorité, mais celui qui donne capacité d’agir et de parler. Ce que fait l’accusé ici : il prend la parole car il le peut parler, alors il le fait.
Sur le plateau, la scène se construit comme ce jeu de corps et de présence : d’un côté, celui qui parle, Martial Kermeur, dont la parole contraint à l’écoute ; de l’autre, celui qui écoute, le juge, figure de l’autorité mais sans véritable emprise, et dont le rôle ne consiste qu’à relancer la parole. Cette partition crée ce rythme dramatique où la parole devient matière empathique : le coupable, en racontant sa dépossession, se transforme en victime d’un ordre immoral, et le juge, confronté à cette humanité, adopte son regard. Dans la conclusion, ce basculement se cristallise : le juge propose de masquer le meurtre en accident et de fabriquer ainsi une « erreur judiciaire », non pas pour tricher avec la loi, mais parce que la véritable injustice – la véritable {erreur} – est ailleurs : dans la manipulation politique, la spoliation orchestrée par le promoteur véreux que Kermeur nomme lui-même « erreur historique ». Une dramaturgie fait s’imbriquer alors puissance émotionnelle et vertige politique : la scène ne montre pas seulement un procès, mais expose la manière dont l’injustice structure le monde, et comment la parole, transmise et entendue, peut transformer la hiérarchie des corps et des responsabilités.
Dans cette tension, le spectacle refuse de se réfugier dans l’abstraction d’un propos. Il inscrit la fable au plus près d’une réalité sociale : la désindustrialisation, les promesses immobilières, les vies rendues précaires. C’est un théâtre qui ne cherche pas à « illustrer », mais qui fait de la conjoncture historique son matériau même : la scène comme lieu d’expérience où s’éprouve la violence du capitalisme triomphant, mais aussi la possibilité d’une autre écoute — celle qui reconnaît la dignité d’une voix, fût-elle celle d’un meurtrier. Emmanuel Noblet ne force jamais l’émotion, et c’est pour cela qu’elle surgit, tenace, poignante : dans la retenue des gestes, dans la clarté du phrasé, dans l’économie scénique qui donne à chaque silence la densité d’une mer prête à déborder. Le spectateur sort du théâtre avec la sensation sans doute d’avoir entendu une vérité qu’aucun tribunal ne saurait vraiment trancher. Geste {fou}, écrivait-on plus haut : tout le spectacle vient pourtant déplier cette folie pour lui donner sa rationalité et sa profondeur, sa nécessité aussi — car la vengeance de Kermeur n’est pas celle d’un désir privé de rétribution, mais celle d’un corps social entier qu’il représente. Ce geste de jeter Lazennec à la mer venge les humiliations subies par sa classe, les promesses brisées, les territoires ravagés. On se tromperait en lisant dans cette vengeance une impulsion uniquement punitive : elle rétablit bien plutôt une dignité bafouée, redonne corps à ceux que le système avait réduits au néant. D’un point de vue anthropologique, elle s’inscrit dans la logique des sociétés où le châtiment n’est pas strictement judiciaire mais moral et symbolique : venger, loin d’être cet acte purement destructeur, et fondateur – c’est reconnaître et restituer, c’est se donner à ses yeux d’abord une humanité restaurée. Sur le plateau, le meurtre devient ainsi acte de résistance et de mémoire collective, et le spectateur est amené à percevoir que la justice ne se limite pas aux règles écrites, qu’elle se joue dans l’écoute attentive et dans la mesure de ce que le monde fait aux vies ordinaires. La vengeance, ici révèle, dans sa radicalité, ce qui a été volé, et restitue ce qui ne peut l’être autrement que par la parole et le geste.
C’est peut-être là, le geste le plus précieux de ce spectacle : faire du théâtre non une reconstitution, mais un espace où l’intime et le politique se nouent, où un homme seul parle au nom de tous ceux que l’ordre social contraint au silence – parle et agit.
La force du spectacle d’Emmanuel Noblet réside dans sa faculté à tenir ensemble l’exigence esthétique, dans sa radicalité minimale, et la nécessité politique de conférer dignité et puissance à la geste sociale de la vengeance, sans céder ni à la tentation du pathos ni à la froideur démonstrative d’un logos pur. Ici, le théâtre ne prétend pas « donner la parole » : il la reçoit, la déploie comme pouvoir, même heurtée, trébuchée sur le bégaiement d’une langue qui ne domine pas son propos, mais se laisse habiter par ceux qui, d’ordinaire, sont exclus du champ du sensible, et nous met en demeure de ne pas nous en détourner. Et dans ce geste, il dit peut-être ce qu’il y a encore de vital, et de nécessaire à faire résonner des voix qui racontent la brutalité du monde et des corps qui lui tiennent tête — pour que nous n’oublions pas que ce monde, précisément, peut être combattu.