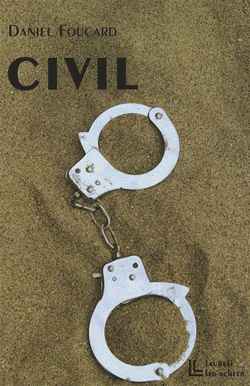
Littéralement virtuel, ou le mythe de la sécurité publique
Daniel Foucard est romancier. Mais ces livres ne se laissent pas facilement saisir… ils démontent nos mythes contemporains à travers une écriture ambigu, révélant, plutôt que résolvant, les ambiguités de son propre lecteur. Dans Civil, paru en 2008, il interroge la loi, le besoin de sécurité et l’idée de police au travers d’un livre étonnant et rare, qu’on dit situé dans la ville de Fun… Compte-rendu et entretien
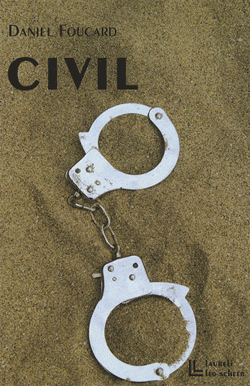 Daniel Foucard a publié cinq livres depuis 2000, ainsi qu’un certain nombre de textes en revue. Il participe à divers autres projets, notamment avec le musicien Portradium avec lequel il vient de faire paraître « Portradium Paul New », un récit accompagnant trois CD, aux éditions Dasein. Il nomme les premiers « raffinages », l’ensemble des autres interventions relevant des activités « off shore » ; en quelque sorte, les livres précisent ce que les autres modes d’intervention exploitent ou explorent sur d’autres territoires.
Daniel Foucard a publié cinq livres depuis 2000, ainsi qu’un certain nombre de textes en revue. Il participe à divers autres projets, notamment avec le musicien Portradium avec lequel il vient de faire paraître « Portradium Paul New », un récit accompagnant trois CD, aux éditions Dasein. Il nomme les premiers « raffinages », l’ensemble des autres interventions relevant des activités « off shore » ; en quelque sorte, les livres précisent ce que les autres modes d’intervention exploitent ou explorent sur d’autres territoires.
Dans un style presque documentaire, sans recherche formelle apparente, Daniel Foucard défriche les mythes de nos sociétés : la science, le sexe, le virtuel ou la police. Et il fait apparaître le mélange de fascination, d’imprécision et d’ambiguïté qui caractérise nos rapports à ces éléments structurants de notre vie sociale, de notre participation aux différents collectifs que nous croisons. Peuplements, paru en 2000 chez Al Dante, faisait le récit d’une exploration de steppes gelées lors de laquelle chaque choix, chaque rencontre avait un enjeu de survie – sans que l’on puisse décider s’il s’agissait d’une authentique aventure humaine ou d’un jeu vidéo. Novo, chez le même éditeur, rapportait des échanges standardisés entre amis ou collègues, dans lesquels s’exprimaient finalement rage, frustration et perversion sans que jamais ces sentiments ne parviennent à s’affirmer ou à s’assumer. Cold, paru chez Laureli (Editions Leo Scheer), désormais son éditeur, racontait comment un jeune homme était envoyé sur les bases scientifiques en Antarctique pour y tester une molécule aphrodisiaque dans ces communautés scientifiques isolées – ces tests se révélant aussi pervers que la vie dans ces collectivités fermées sur elles-mêmes. Civil enfin, son dernier texte paru en janvier dernier, exposait les cours d’un instructeur de la police nationale d’une ville appelée Fun. Celui-ci, Josh Modena, tente d’expliquer à ses recrues comment, en tant que policier, répondre à la demande sociale de police, de légalité, d’égalité et de sécurité. Mêlant observations lucides et purs délires, arguments publicitaires de gestion d’une audience (les civils, autre nom pour les citoyens) et réflexions sur le fondement mythique des lois, le texte multiplie les ambiguïtés et les niveaux de discours, renvoyant le lecteur à ses propres choix, engagements et croyances. Le texte n’est ni critique ni ironique, bien au contraire, il fonctionne par accumulation d’affirmations dont on finit par ne plus savoir quoi penser, découvrant du même coup les apories de nos propres discours sur la police, sur le besoin de surveillance ou de sécurité. L’instructeur se révèlera finalement un faux, un usurpateur plus policier qu’un policier, déroutant une dernière fois nos attentes de fiction (rassurante).
Le second élément marquant de cette écriture est sans doute la disparition qu’il opère de la « voix de l’auteur ». À travers ses textes, le lecteur ne sait rien ni du projet de l’auteur, ni de ses obsessions ou de ses opinions. En serrant au plus près son objet, il déroute les mises à distance trop simples, et donne à penser plus qu’il ne livre ses pensées. Littérature de l’ambiguïté ou du virtuel – c’est ici la même chose – plutôt qu’expression de soi ou d’une idée, agissant par des images précises, efficaces, ancrées dans le réel (ou le virtuel, c’est ici, encore, la même chose : ce que l’on peut imaginer peut arriver). Aussi il n’est pas surprenant que lorsqu’il est invité à se produire devant une audience, Foucard pratique « l’antilecture », selon son expression : il fait projeter un powerpoint sur lequel défile des sentences valant tant pour le libéralisme débridé ou réactionnaire que pour la gauche militante, sur les vertus de l’endurance et de la résistance, la nécessité de reconnaître les siens ou l’importance d’une gestion économique saine – et il dort sous l’écran le temps de la projection. On ne saura rien ni de ses intentions, ni de ses opinions. Avec lui, l’intériorité n’est plus le lieu magique de l’invention littéraire, le secret de l’individualité exaltée ; l’auteur n’est pas celui qui sait, qui défend quelque chose avec des armes singulières ou qui a vu avant nous ; l’image n’est pas le délire ou l’affirmation d’un homme singulier mais l’agencement précis d’une situation qui, pour décalée qu’elle soit, n’en révèle pas moins l’ambivalence des positions critiques communes ; l’individu est ici celui qui fait sienne les règles du collectif, et non celui qui les distancie. Littérature en marge pointant lucidement les apories de nos discours critiques, se situant quelque part entre la poésie contemporaine et la science-fiction, les textes de Daniel Foucard sont de ceux qui renouvellent en profondeur l’espace littéraire contemporain, ses fonctions et ses usages. Rencontre autour de cette écriture singulière.
EV. – Dans ton dernier livre, Civil, particulièrement – mais on pourrait le voir apparaître et se préciser à travers l’ensemble de tes précédents textes, tu utilises un style d’écriture qu’on pourrait qualifier de « clinique », dont tout effet de style semble évacué. Il semble que tu privilégies le récit, qui est particulièrement efficace et structuré, sur tout autre effet de style littéraire. Comment caractérises-tu ce style qui ne veut pas en être un, cette écriture impersonnelle, documentaire, cette langue qui semble ordinaire, « quotidienne », mise au service d’un récit ?
DF. – Cette question du « style » clinique est une question clef. Le mot est souvent employé pour définir mon écriture et je l’accepte volontiers en dépit de son côté répulsif. Il s’agit effectivement de guérir, de diagnostiquer, de bourrer de médoc une littérature en surcharge pondérale.
Je refuse les écritures de stylistes. Elles rendent hommage à une culture littéraire qui n’en a plus besoin. Le style est le travestissement du lire, or il est urgent de délire. Pas au nom d’un obscurantisme inculte et rampant mais pour réinventer une écriture qui colle définitivement à son époque en osant se défaire de ses règles usuelles.
Un aimant attire irrésistiblement la culture et la civilisation vers son recyclage. L’aimantation est radicale et on ne peut pas faire comme si on ne s’en apercevait pas. On peut toujours réécrire les mêmes livres avec quelques menues variantes mais ils risquent de rester sur le côté de la route, faute de mutation.
Pourtant, la lecture se porte mieux qu’avant et la production de livres s’amplifie. Il y a de plus en plus de choses à lire mais c’est tout notre lien à la littérature qui se transforme. Simple stockage, à l’origine, le livre s’est fait média et se voit média. User d’un style clinique, d’un style telex ou d’un style flux rss c’est déjà comprendre que la médiation est devenue l’unique objet de la littérature.
En ce sens, mon obsession n’est plus de pétrir la langue mais d’abord de la reconformer en inventant des protocoles. Ils sont obsessionnels, métaphoriques ou symptomatiques, mais jamais gratuits. Ils sont légérement hors normes, pas spectaculaires, ni hyper innovants. Ils visent la médiation et peuplent une transformation.
Mes livres consistent en la création d’un lieu 100 % fictif, autant celui l’action que celui du texte. L’école de police décrite dans Civil est ce type de lieu. On y trouve des dialogues sans guillemets sans tirets sans traits d’union sans autorisations, des digressions complètement marteau, des recettes inattendues, des explications alambiquées mais concrètes, de l’information brute et des fictions parasites, seul mélange capable de rendre compte du réel approximatif surtout quand on sait qu’aucune documentation n’a été employée pour l’occasion.
Civil est un livre psychédélique. Mon style clinique fonctionne comme un scanner déréglé accumulant diagnostics, pronostics, fausses pistes et délires.
En ce sens, « clinique » s’oppose sans doute à « critique » : Autrement dit, tu ne propose pas l’expression d’un point de vue, un sens de lecture, l’exposition d’une intériorité, tu ne mènes pas ton lecteur vers un point de clarté que tu aurais défini, mais dans la présentation « froide », documentaire presque – même si ton travail ne relève pas de l’écriture « froide » dans le sens où on l’entend habituellement, justement parce qu’elle ignore toute expression d’une subjectivité – celle de l’auteur ou celle d’un protagoniste.
Je ferais plutôt une distinction entre plaisir et désir dans les narrations. Les récits de plaisir seraient ceux qui ce rapportent au réel, s’attache à la description des détails, procure un plaisir de lecture par ce seul artifice. Ceux de désir évolueraient dans une autre couche, plus atmosphérique et plus illusoire, psychédélique encore, une couche qui autorise une multiplicité de spéculations donc moins de détails et surtout peu d’explications détaillées.
Cette couche est un mélange de virtualité : type jeux vidéos on line, d’hallucinations : dont ce goût très répandu pour l’insolite, de flux électriques : masse d’images et d’infos que nous consommons sans stockage, l’ensemble formant une zone informelle où le plaisir réaliste se dissout.
Ladite zone est peu identifiable dans mes écrits à forte coloration politique ou sociologique. Je spécule pourtant constamment avec inquiétude (désir) et détachement (plaisir), avec exagération (désir) et retenue (plaisir), avec invention (désir) et imitation (plaisir), avec trouille (désir) mais délectation à écrire aussi (plaisir). Je crois que le désir est plus collectif, il est presque un projet de société alors que le plaisir est plus personnel.
Dans ce contexte « désirant », l’auteur reste une puissance mais est aussi un suiveur. Le texte devrait être son seul pilote derrière lequel il conviendrait presque de se cacher. L’auteur lisant son propre texte devant un public rajoute un inutile effet de réel. Il nous dit un truc vrai et il est réellement là pour nous le dire. Public et auteur se font plaisir. Or, le plus souvent, L’auteur est un piètre « master of ceremony ». Le spectacle est le seul gagnant dans cet affaire, pas la médiation.
Pour revenir au texte même : Que pense l’auteur de ce regroupement d’ultra légalistes, apparaissant vers le milieu de Civil, qui pensent déstabiliser l’ensemble du système législatif en respectant à fond les lois ? Rien, ou plutôt son personnage principal, l’instructeur, pose cette question à ses élèves, espérant une réponse ou voulant les piéger, puis il passe vite à autre chose. Voilà où je suis : je me pose la question comme lui, comme eux, par lui et pour eux.
L’auteur est ordinairement le héros de son histoire personnelle or dans Civil il n’est qu’un protagoniste s’interrogeant.
Qu’est ce qui relève du désir, et qu’est ce qui relèverait du plaisir dans Civil ? Du point de vue de Modena et du tien ?
Les motivations de Modena sont multiples puisque c’est un mystificateur. Quand on s’introduit dans une école de police sous une fausse identité et qu’on y mène un enseignement c’est pour régler des comptes avec une histoire personnelle, avec une profession, avec la société. Or, Modena n’est pas un révolutionnaire, ni un terroriste. La vraie surprise de son enseignement pirate est qu’il est conforme aux enseignements traditionnels de l’institution policière. Il est un perfectionniste ou plutôt un refondateur. Il spécule sur les insuffisances de la conviction policière, républicaine et en rajoute donc une couche, épaisse. L’objectif avoué est de reconquérir un prestige personnel auprès de sa mère policière et de croire que le droit républicain a aussi besoin d’une telle reconquête. Quand il est démasqué par un instructeur infiltré, il n’oppose aucune résistance sachant que son enseignement viral va produire son effet. Le désir de Modena c’est de reconstruire. Son plaisir est d’être pris pour ce qu’il n’est pas.
Le mien est de construire et d’être pris pour ce que je suis : un écrivain. Je mets de côté mes capacités à observer, j’évite le témoignage, l’enquête. Civil reste une pure invention prenant en charge ce savoir diffus que nous accumulons à travers les divers médias, cherchant à définir une communauté civile de laquelle je suis assez éloigné faute d’intégration complète aux rouages puis procédant à un mélange des deux imprécisions pour créer une construction proche elle aussi d’une mystification.
Le plaisir vient de décrire une plage, d’y placer deux personnages dessus, de trouver un sens à cette rencontre, de le détourner à peine fixé, d’en provoquer un autre en vue d’une vision plus générale. Mon plaisir c’est de bondir. Avant arrière.
Dans Civil, le récit se déroule ainsi dans un centre de formation de la Police Nationale, mais sur l’île de Fun. Dans Cold, il s’agit de tester des drogues et d’évaluer des comportements, mais dans des bases polaires, et Peuplements raconte des explorations de steppes gelées, sans que l’on sache s’il s’agit d’un documentaire ou d’un scénario de jeu vidéo. A chaque fois, tu places tes récits dans des lieux isolés. Ce serait des zones de test, des « échantillons représentatifs » ?
Je ne connais pas les lieux en question, faute d’y être allé : Sibérie, Australie, Antarctique, Madère (Fun est la contraction de Funchal, capitale de Madère). Ce fait dissocie encore le plaisir du désir. Comment décrire un lieu qu’on ne connaît pas autrement que par une imagination frustre, peu détaillée, avec une documentation touristique de base. Mes récits sont juste déterritorialisés. On change de lieu, les règles changent. Le voyage m’intéresse moins que le déplacement. Voilà pourquoi je parle souvent d’écriture SF, pour « Sans Fixité », concernant mes livres. Pas de normes, pas de lieux précis, mais des choses à explorer, du désir d’abord.
Cold est l’histoire d’un agent porteur d’une drogue pouvant faire parler les scientifiques installés en Antarctique, sur leurs pratiques sexuelles notamment. Ses chefs s’appellent développeurs et ses volontaires (les scientifiques sur lesquels sont pratiqué les tests, ndlr) ont une sexualité robotique. Mais le seul véritable pays visité par ce récit est finalement la thématique virtuel / hallucination / zapping d’images électriques. Chaque élément, chaque rebond est synchrone avec ce postulat. Tel l’arbre qui cache la forêt, on découvre que le devenir de la science et celui des ressources en eau sont un simple prétexte à ce déplacement.
Des robots peuplent l’Antarctique comme des policiers peuplent les plages de Madère, les premiers ont un désir de science, les seconds un désir de droit. Quitter ses frontières est une insatisfaction permanente, une quête permanente, sans billet low cost.
Dans tes récits, il y a toujours des règles, très strictes – notamment dans les deux derniers, Civil et Cold. Mais dans le même temps, paradoxalement, on ne sait pas où est la loi, quelle est la légalité des actions entreprises. Dans Cold, on ne sait pas si l’action du testeur est avouée ou si c’est un test illicite. Dans Civil, on ne sait pas quoi penser de Modena, le policier instructeur, et de ses affirmations. Ce doute sur ce qui relèverait de l’invention des uns et des autres ou au contraire de règles déterminant les actions de chacun constitue d’ailleurs une grande partie du « suspens », si l’on peut dire, de la lecture : Il y a une action, mais on ne comprend pas en quoi cette action est déterminée par l’inventivité (le plaisir et le désir, justement) des protagonistes, ou au contraire par un cadre légal commun, ou enfin par des « programmes », des règles que chacun respecterait selon sa situation. Cette indécision entre l’individuel et le collectif traverse tous tes livres, si bien que Civil, qui l’aborde frontalement en mettant en question ce que seraient la loi et son respect, semble de ce point de vue l’aboutissement de tes écrits précédents. Qu’est ce que la loi, les règles, pour toi ? Au fond, c’est la question du collectif, de la communauté qui revient : qu’est ce qui fonde le collectif si les règles sont cachées? Serais-tu un anarchiste dandy – ce que je ne crois pas, justement parce que les règles sont toujours strictes, mais toujours cachées, incertaines dans leurs intentions, leurs raisons – qui penserait que le collectif s’invente dans l’instant, dans la rencontre? Qu’est ce qui relève du jeu ou de la règle dans une communauté ?
Un anarchiste dandy ? Quel kif ! D’accord. Mais mes vraies inclinations politiques sont un peu moins sexy, disons que je suis un égalitariste pragmatique, donc quelqu’un d’assez attentiste, d’assez intransigeant, d’assez parano. Disons encore obsédé de la liberté individuelle, un défenseur du recours donc du droit en tant qu’il autorise de multiples inventions utopiques en sa marge. Spécialement à notre époque où de nouveaux contrats sociaux postulent au remplacement de la loi, que ce soit par l’autorégulation des marchés ou les replis identitaires.
Je suis persuadé que les postulants, il y en évidemment beaucoup encore, tentent de hiérarchiser la société en rétablissant des distinctions qui vont permettre l’instauration de sociétés à plusieurs vitesses nécessitant plusieurs vitesses de prise en charge. Par exemple, le renouveau du sexisme qui devrait être un des thèmes centraux de mon prochain livre viserait à paupériser pour mieux exploiter, tant il est presque prouvé que l’égalité des sexes accompagne ordinairement la prospérité.
La loi ne peut guère se plier à ce type de recul larvé puisqu’elle s’ancre traditionnellement dans un système égalitaire : la loi est pour tous et toutes au même niveau de richesse et de recours. Reste à nos sociétés d’apprécier, nos chroniqueurs d’apprécier, nos politiques d’apprécier si ces lois sont objectivement égalitaires dans les faits.
Civil est une construction qui pose cette évidence égalitariste en la mettant à disposition de l’institution chargée de la faire respecter : la police. Alors, ironie ? Cynisme ? Naïveté ? Non : pragmatisme. Le seul individu pouvant aujourd’hui parler sans honte d’égalitarisme, tant le terme est contesté et illusoire, le seul : c’est un flic !
Les codes de tes narrations sont assez clairs : l’exploration/jeu vidéo dans Peuplements, le test d’une molécule sur des bases arctiques dans Cold, l’instruction des policiers dans Civil. Comme tu l’as dit, les récits ont lieu dans des territoires symboliques que l’on reconnaît sans peine, qui servent de cadre et de matrice à la narration – en précisant qu’il s’agit toujours d’espaces où se cristallisent les fantasmes d’aujourd’hui et qui constituent nos mythes contemporains : la survie et le virtuel, le sexe et la science, la loi et la police. Malgré ces cadres narratifs a priori évidents, courants, on se sait littéralement pas ce qu’on lit, justement parce qu’on ne peut pas déterminer les intentions de l’auteur ; on n’a donc pas ce sentiment d’être rassuré par quelqu’un qui commente, qui nous emmène dans son terrain de jeu perso détaché du réel. Grande force de tes récits, de ce point de vue, qui s’attachent au monde, au réel, au social, en les regardant précisément, avec lucidité, tout en en refusant le commentaire. Civil est exemplaire de ce point de vue. On ne sait pas quoi faire des affirmations de Modena, je crois. Il n’est pas simple de savoir ce que l’on pense de ses propositions – sur le besoin de sécurité, sur la nécessité de la police, sur l’idée que la présence de la police puisse relever d’un jeu. Ainsi l’ambiguïté devient un outil critique, une manière d’interroger nos fantasmes, ce que l’on accepte, ce que l’on décide et ce que l’on projette ou qu’on idéalise. Dans un monde ambigu, on ne peut répondre que par une littérature équivoque ? Ce serait ça, la fin des grands récits initiatiques, ceux qui construisent des repères (les mythes, en somme) ? L’ambiguïté est-elle fondamentale à tout récit ? Ou est-ce comme chez Dante, une manière de donner à penser ce qui relève du fantasme, du non-exprimé, de l’aporie, en lui donnant une forme – symboliser ce qui échappe dans la vie courante mais la structure, donner à penser en livrant une image du monde, sans lui donner un sens ?
Tu dis : C’est comme si l’ambiguïté devenait un outil critique. Super exact. L’ambiguïté n’est pas une démission, ni une lâcheté. C’est un détour. L’usage voudrait qu’on dise un détournement, mais je préfère détour qui est plus géographique. Équivoque est encore mieux, même si je revendique autant les deux, mais cette littérature équivoque en réponse à l’ambiguïté ambiante est exactement ce qui se profilera sous peu. Ces réponses très politisées mais insaisissables réclameront qu’on vienne reprendre les problèmes à leur source. L’équivoque gère mieux l’étagement des couches virtuelles / électriques / concrètes que les affirmations même en ces temps de trouble.
Le donner à penser par l’usage d’une métaphore dépourvue de sens rejoint le principe du tract. Comme un tract, il est convaincant, excessif, sans feed back. Le trouble vient de ce qu’on ne sait pas qui l’a imprimé. L’équivoque frise, là, la confiscation.
Il y a aussi des ambiguïtés et des équivoques qui se lovent dans des endroits imprévisibles. Comme cette particularité dans mon écriture qui est, je le crois vraiment, absolument unique vu les thèmes que j’explore : drogue, politique, enquête policière, conflits, bastons, suspicions, folie, etc. Elle est 100% non létale ! Pas une seule victime dans mes récit, pas un seul crime, même pas une herbe ou une bestiole exposées. Tous les participants sont ultra vivants et le repérer relèverait là aussi de l’enquête policière. Mon écriture est entièrement une schizophrénie vitaliste où chaque entité évolue dans un direct, comme la TV en direct, sans exception. L’équivoque peut régner sur ce terrain hyper joyeux.
Enfin, le problème de la filiation et de l’éducation revient en effet comme une double clé du récit dans ton livre. On ne va pas raconter précisément les dernières pages, mais on apprend que Modena a un souci avec sa mère, elle-même flic de renom. D’autre part, tu insères dans le fil du texte des notes qui semblent quasi-autobiographiques – ou du moins qui sont présentées comme telles – dans lesquelles un élève policier revient sur son éducation, sur la manière de voir les choses qui lui a été transmise. Ces inserts laissent penser, en plein milieu du récit, que la narration est codée – qu’elle a plusieurs couches, comme tu disais. Ces deux « clés », les notes et le chapitre final, qui font toutes les deux s’effondrer le récit principal, ont à voir avec la parenté – c’est-à-dire chez toi avec l’autorité et l’ambivalence, pour reprendre les premiers mots de la première note. En quoi individu, filiation et communauté s’opposent-ils, ou au contraire sont-ils indissociables l’un à l’autre ?
Cette histoire de filiation apparaît pour la première fois dans mes livres avec Civil. Jusque là mes personnages avaient des copains et des copines, seules connexions bio-sociales. Chaque individu était autonome autant hors champ que plein champ, ce qui tassait le champ narratif puisque chacun était présenté par ses faits et gestes, en direct.
Civil réintroduit d’abord l’individu, incontestablement l’une des plus belles inventions de la modernité. L’individu y est plongé dans un récit d’autorité, de sujétion, de respect, d’organisation et il est assez logique qu’une symbolique privée le guide dans cette quête de sens et de liberté. Mais il y a moins une métaphore de la structure parentale qu’un simple refuge.
Modena est coincé par ses supérieurs qui tendent vers lui un combiné téléphonique avec sa mère à l’autre bout du fil. Il résout ce problème en posant une simple question, qui est avant tout un simple signal de communication : « Maman ? ». Que va lui dire sa mère à lui, l’usurpateur ? Elle va prendre son parti ? L’insulter ? Exiger des excuses ? Lui dire que c’est dorénavant un héros de l’indépendance ? Avoir pitié ? Autant de possibilités rejoignant une seule évidence : elle va le ramener dans une sphère privée qui est la nourriture de tous les pouvoirs, de tous les gouvernants, cette sphère privée où le ressourcement vient de la certitude que les trahisons resteront sur le palier.
Effectivement, les inserts prononcés par Enzo, un des élèves de Modena, ont quelque chose à voir avec l’autobiographie puisque j’ai tâché, là, de me donner un peu la parole. Modena et sa mère représentent eux une immense boucle fictive qui rebondira sur une interrogation, sur un appel, tant qu’on refusera d’admettre qu’une filiation réussie repose autant sur de l’amour que sur une modernisation de l’individu. La mère est une flic réussie et Modena un flic raté, scénario étrange ou dérangeant selon les cas.
C’est pourtant l’enseignement de Modena que le lecteur a reçu et il est assez conforme aux attentes de l’institution. Modena n’entre pas dans la police, il a été recalé au concours, mais il rend hommage à sa manière à la belle carrière de policière l’ayant élevée : les filiations peuvent aussi être des fonctions, des trajectoires, des émancipations, encore une qualité clé de la modernité.
En guise de conclusion, je reprends ce mot d’un réalisateur hollywoodien entendu à la radio : ce qu’aiment voir les spectateurs c’est un individu qui a fait le mauvais choix. Cette remarque a considérablement habité l’écriture du livre. Mais là, le mauvais choix était d’être policier ou s’être fait passer pour un policier ?
Réalisé par mail fin juillet 2008.
http://www.leoscheer.com/spip.php?article749
http://laureli.over-blog.com/archive-08-2006.html

