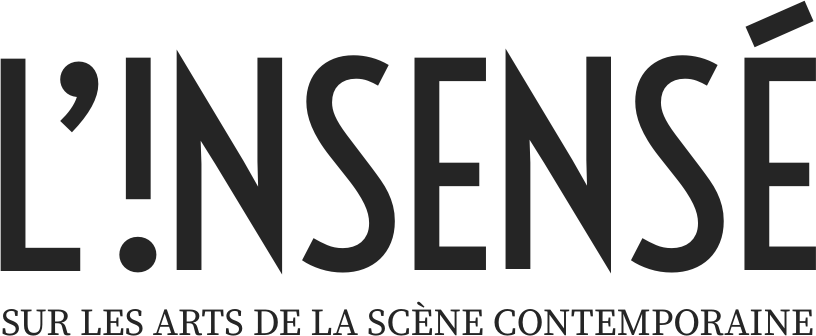Par autan… une sincérité inexTanguyble
Par autan, de François Tanguy, on devait le voir à Besançon, quelques semaines après le 7 décembre 2022 (où le soir, à la Passerelle, à Marseille, avec quelques camarades, on a trop bu pour noyer notre peine). Une grève de la SCNF nous priva de ce rendez-vous avec le Théâtre du Radeau. Majorel et moi-même, nous devions donc attendre… jusqu’à aujourd’hui, 13 juillet 2025, où Par autan, dans le festival d’Avignon, continue d’être joué, dans le gymnase du lycée Mistral.
Par autan… fin de partie.
[…] de Passim à Item, de Onzième à Soubresauts jusqu’à Par autan ; du paysage familier que forment ces poèmes-théâtraux ; à l’endroit de l’émergence magmatique de chutes empruntées à Walser, Kafka, Celan, Rilke, Shakespeare, Dostoïevski, Tchekhov… ; les mues esthétiques et poétiques du Radeau se regardent moins comme des métamorphoses que comme les peaux artaudiennes d’une idée filée, augmentée, travaillée et reprise… jusqu’à l’os.
Quelque chose qui relèverait, dans la pensée Deleuzienne, d’une pratique rhizomatique, où d’une pièce à l’autre, scènes après scènes, les lignes dramaturgiques empruntées par les interprètes tisseraient des voisinages, des parentés et des filiations indépassables parce qu’il y a chez le metteur en scène François Tanguy une pensée fibrilline que Par autan (ultime œuvre du metteur en scène) a formulé dès le début, au détour d’un fragment de Walser : « En quels temps sommes-nous donc… ».
Énoncé clé, en ces temps de démolition, qui fait écho à Proudhon « En quel siècle vivons-nous ? ». Phrase spectacle imprégnée du spectacle du monde et qui se verra déclinée, chez Rancière « En quel temps vivons-nous ? » ou chez Jean-Luc Nancy « Dans quels mondes vivons-nous ? ». Chacun à leur manière reformulant ce que l’époque livre. Les uns les autres, finalement, posant peut-être la question d’Hölderlin : « A quoi bon des poètes dans un temps de détresse » (cf. Pain et vin).
Question ou incompréhension ou agacement qui marque l’épaississement du dénuement, siècles après siècles, alors que l’obscurcissement de l’horizon gagne – Müller, lisant Hamlet, écrirait que « quelque chose est pourri au royaume de l’espoir ». Agacement qui, au moment du salut des comédiens et des comédiennes, prend la couleur et la forme d’un petit drapeau palestinien accroché aux cintres.
Moment solennel où, en rang d’oignon, comme une vieille garde humble qui rendrait un hommage funèbre, Samuel Boré, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly, Anaïs Muller et Frode Bjornstad rappellent que leur art n’est étranger ni au refus de l’oubli, ni à la vie.
Minutes longues, sous les applaudissements, où une poignée de comédiens et de comédiennes, silencieux et graves, aurait peut-être souhaité être rejoint ; faisant du théâtre et de sa rampe où ils se tiennent immobiles, un court instant, la base et le sommet, d’une pensée qui s’élèverait vers le peuple meurtri de Gaza.
Il n’en sera rien.
Ça applaudit. Ça applaudira sans qu’un silence devant le petit drapeau marque un trait d’union entre la scène et la salle.
Et les camarades du Radeau encaissent la salve de la salle. Ils font « bonne figure ». Ils jouent le jeu bon gré, mal gré. C’est la convention qui les exécute.
Le théâtre, définitivement, n’est jamais qu’un soubresaut. Et ce qui aura été entendu, tout au long de Par autan qui convoquait régulièrement l’occurrence de l’acteur, meurt là, à l’instant du salut.
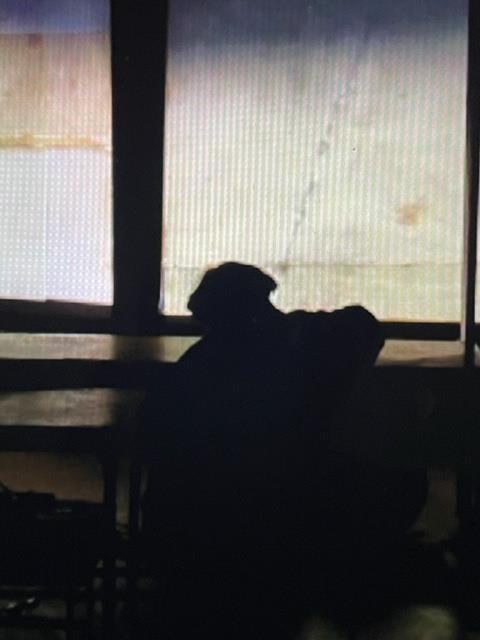
Sous le regard de l’hermine.
À la première image alors que la salle se remplit… elle est là parmi les panneaux de bois et les fenêtres voilées. C’est une hermine, la tête tournée vers le public. Immobile, aux petits yeux noirs, museau figé, aux aguets… la taxidermie a fait son ouvrage. Inquiète, peut-être, comme surprise par la mort et pour autant toujours sur le « qui vive ». Elle a son pelage d’hiver. Il est blanc… On serait en hiver, alors… ça serait un conte d’hiver qui commencerait…
Sans que je sache très bien pourquoi, furtivement, c’est l’essai de Felix Guattari Les années d’hiver et ce qu’il écrit qui vient à la surface : « dans quelle société de merde vivons-nous ? ».
Sous le regard de l’hermine : cet animal sacré dans la religion zoroastrienne, symbole d’innocence et de pureté en occident… Elle est là. Elle précède les autres images… C’est une image parmi d’autres, mais elle a la persistance de la première rencontre.
Comme les autres, elle est tout à la fois dans un isolement et mérite l’attention. Elle est là pour des raisons que l’on ignore. Elle est l’une des figures d’un bestiaire auquel Tanguy n’était pas étranger.
Que dire de plus de cette image qui précède celles de la mariée bousculée dans sa robe blanche, du chevalier errant à la carcasse métallique, de la chanteuse lyrique capricieuse, de la baronne vieillissante et mercantile, du moujik indomptable et intempestif, du général introuvable et ubuesque, de ces spectres kafkaïens chapotés de melon, de ces costumes dorés de prince à deux balles apparaissant soudainement…
Que dire de cette ménagerie de silhouettes littéraires malmenées, reconnaissables et pour autant déformées et démembrées ? Fragments sortis des corps de texte auxquels ils appartiennent, les extraits ou les précipités dont use François Tanguy, d’une création à l’autre, relèvent comme toujours d’un effet Frankenstein où un bout de texte, un lambeau de poème… est l’objet d’un cousu-main, à l’image des costumes qui procèdent d’un prêt à porter à la main des comédiens et des comédiennes.
[…] C’est l’hiver qui s’est installé au plateau. Comme dehors, en hiver, la lumière est moins forte, l’air plus épais, les sons sont différents, le mouvement plus lent… Rien n’est mort, tout est sommeillant. Comme en équilibre, prêt à éclore ou à crever, si jamais le froid venait.
L’hermine disparue, les uns les autres s’activent à peine. Derrière eux, contre une paroi transparente, une forme à peine humaine, avec un chapeau, est adossée et figure peut-être la présence désormais lointaine de Tanguy qui, dans chaque création apparaissait sans jamais être identifiable. Il avait la bougeotte, se comportait comme un déménageur, toujours en train de charrier quelques babioles ou machins, innervant le plateau d’un mouvement sans fin. Là, il est figé… comme l’hermine à l’air miné.
Ça meurt, au théâtre aussi.
Ils joueront ça aussi. Se relevant après un assassinat. Chantonnant après que… parce que, au théâtre, quand ça meurt ça se relève. C’est la magie du théâtre que de mourir plusieurs fois, de tomber plusieurs fois, de chuter à nouveau… et parfois, il y a la vie où la magie disparaît. Ça porte un autre nom et c’est « La vie de merde ».
C’est l’hiver. Et ça s’appelle aussi la « morte saison ». C’était à Avignon, un 13 juillet, au Gymnase du Lycée Mistral.

Un Monde sans pareil
Bien sûr, il y a ce titre : Par autan. Un nom de vent fort et puissant dont on dit qu’il peut « rendre fou ». Quelque chose d’un vent tourmentant, sans doute, qui ressemble au mouvement du vent que Soutine peint quand il sévit à Céret. Il souffle – à deux reprises seulement – sous la forme de bourrasques violentes qui viendront heurter les ombrelles et la bedaine des interprètes à la marche fragilisée, au pas mal assuré.
À deux reprises seulement. SEULEMENT !
Pas de quoi en faire un plat alors que la critique, balayée par l’autan, s’y engouffre et que, via ce biais, lui portant un intérêt de météorologue métaphysicien (des clones de Gillot-Pétré qui aura fondé « l’amical des ouragans »), le théâtre et le vent forment comme une notice d’emploi, l’un expliquant l’autre, et vice et versa.
Putain, les clichés ne meurent pas et reviennent fanfaronner dans les papiers qui rappellent qu’on ne comprend rien à la poésie, y compris celle de Tanguy.
C’est une NOUvelle CAApitale !!!!
Loin de ce bavardage, on pourrait se souvenir – néanmoins et juste – que Tanguy aimait regarder les films, notamment les films muets, aussi, et qu’il avait sans doute vu Keaton dans Steamboat Bill (1928) pris dans une tempête, un ouragan.
Keaton, autre modèle d’un ubuesque qui est à l’œuvre dans Par autan, comme toujours dans les créations du Radeau. Keaton qui le faisait marrer et lui donnait à penser parce qu’avant d’être un « clown », c’était avant tout un lutteur contre les éléments de toutes natures.
Et d’imaginer qu’au plateau – ce radeau où marinent les luttes et les résistances (si tant est que le théâtre puisse encore les figurer sans les nommer et sans recourir à l’actualité et au documentaire) – où vivent les combats vivaces d’arrière-garde (la lutte des classes) et les révoltes universelles (préserver la dignité)… les comédiens et comédiennes étaient aux prises, encore une fois, avec quelques combats infernaux et infinis, à mener.
Soit une autre manière de nommer une « idée que l’on défend », « un engagement auquel on tient », « des batailles où jeter son corps »… « la présence d’un soleil » ou d’un « rêve » dit Walser convoqué au long de Par autan. Un paradigme qui ferait du théâtre et de la pratique théâtrale, un ring (pour se rappeler au souvenir de Brecht), où se battre avec les ombres et ceux qu’elles hantent.
Dès lors, sans trop de certitudes (et pas davantage de quête de sens), regarder les comédiens et les comédiennes se battre contre ces éléments qui hantent la scène. Mettre en correspondance leur gestuel et l’idéal qu’il faut conserver, préserver ; dont il faut assurer la « survie »… malgré tout. Accepter que les luttes contre les éléments n’aient aucune forme, parfois aucune visibilité ni aucune logique sinon les gestes, les sons, les accents musicaux, les textes, les jeux que comédiens et comédiennes leur opposeraient. Voir dans un enjambement grossi et caricatural (figure de rhétorique) la tentative de passer au-delà d’un encombrement. Voir dans les déambulations bizarres l’annonce de la manière dont ils se prendront les pieds dans le tapis. Les écouter trafiquer une diérèse, une synérèse… sous leur postiche de figures fantoches. Voir dans le mouvement des bras qui brassent l’air une rixe avec des monstres infernaux, à la taille d’érinyes. Regarder la gymnastique des corps se débattant comme la tentative de « passer quand même », de « passer en force ». Regarder dans les hésitations et les ratages redondants – ces ratures esthétisées et poétisées –, les chutes récurrentes, les soulèvements avortés, ridicules, grotesques au plus proches du tragique, le combat perdu d’avance qu’il faut tout de même mener. Les observer quand il faut en découdre entre eux, pour une petite dote, un vêtement sans valeur, un mot de travers, une place à prendre … Imaginer dans le tranchant des lames d’épée, les chapeaux défaits, les regroupements en meute dans la coulisse, les « va comme je te pousse »… les signes drôles et mélancoliques de putschs sans devenir. Les voir à pied d’œuvre dans le crime, le larcin, les ratages, les amours plantés… comme les « décérebellés » (mot de Sartre dans la préface au Traitre de Gorz) qui forment le peuple du théâtre puisqu’au théâtre, tout n’est qu’illusion, sauf peut-être les pensées incontrôlées qui naissent chez le spectateur. Voir dans les muscles aux prises avec les langues étrangères et les mâchoires grippées, dans l’ombre des voiles, dans les trappes qui happent, dans un geste marionnettique, dans les fanfaronnades et les attitudes d’acteurs cabots… la perpétuité des luttes, y compris contre soi, entre soi, où un personnage shakespearien a pour adversaire d’un soir, la silhouette d’un personnage walserien.
Comprendre que Tanguy aura fait émerger une « langue de rappels ». « Langue de rappels » – au sens « d’escalade » en quelque sorte – qui encorde, assure sans les rassurer les comédiens et les comédiennes avec lesquels il travaille leur permettant de jouer avec le vide, de le déjouer, et de dépasser, toujours en équilibre, les obstacles du plateau ou l’obstacle qu’est la scène.
Et admettre que ce n’est pas tant ce qu’ils et elles racontent, que la manière dont ils et elles le racontent qui fait théâtre. Et que c’est seulement ça qui fait le reconnaissable et l’unique du théâtre du Radeau… ou un « Monde sans pareil » comme le dirait Maldiney quand il définit une œuvre d’art.

Quels chevaliers ?
Regardant Par autan, me revient un souvenir…
« La tentation du naturalisme aura fait bien de ravages dans le champ artistique » dit Jean-Pierre Dupuy qui arpente la scène – intérieur de salle de bain pavée de carreaux blancs astiqués par Laurence Chable en robe rouge sang – dans la mise en scène de Mademoiselle Julie de François Tanguy.
C’était il y a longtemps, ils avaient une vingtaine d’année.
Regardant le document vidéo de ce qui reste de cet instant, on ne peut ignorer que le préambule est un Manifeste qui va à l’encontre des hégémonies qui s’exercent sur la pratique du théâtre, sur les représentations qu’elle induit chez le spectateur. Et que Tanguy, Chable, dans Mademoiselle Julie, voulaient en finir avec cela qui fonde « les compromis bourgeois » (disaient-ils). Qu’ils étaient à la recherche d’une transe et que, si l’inconscient est structuré comme un langage, alors la réalité du théâtre (ce qui apparaît dans l’instant du jeu) suffit.
De cela, il me semble que Tanguy aura fait du théâtre en ayant en tête de lui garantir son autonomie. Qu’il aura, de Julie à Par autan, cherché à le préserver des rapports d’appropriation qui passent par la rationalité et sa complice la logique. Trouvant dans les formes qui suivront et qu’il reconduira d’un spectacle l’autre, les matières d’un vagabondage poétique pour le donner à sentir. Un vagabondage qui, dans Par autan, vient concrètement se matérialiser quand apparaissent les clodos de Godot, aux pieds fatigués, aux godillots délassés.
Figures métonymiques des comédiens et comédiennes du Radeau qui sont eux-mêmes des « vagabonds de l’intelligence » au sens où Max Stirner, dans L’unique et sa propriété, en parle : « […] au lieu de se tenir dans les limites d’une façon de penser modérée et de considérer comme vérités intangibles ce qui donne à des milliers d’hommes la consolation et le repos, ils sautent par-dessus les barrières du traditionalisme, et, vagabonds extravagants, ils s’abandonnent sans frein aux fantaisies de leur critique impudente et de leur scepticisme effréné. Ils forment la classe des instables, des inquiets, des inconstants, c’est-à-dire des prolétaires, et sont appelés, quand ils donnent libre cours à leur nature, des “mauvaises têtes” ».
Dans Par autan, et comme partout ailleurs dans l’œuvre de Tanguy, peut-être qu’il y a cette ode au vagabondage (dans les textes qui sont arpentés, dans l’inachèvement d’une scène, dans l’esquisse d’un geste commencé, dans la pensée qui radote, dans un mot coupé de sa finalité, dans une idée qui se perd dans le volume sonore des musiques convoquées, dans les comportements qui marquent une inaptitude à développer un ordre, jusque dans l’encadrement d’une fenêtre et de son voilage qui ont perdu toute utilité…).
Vagabondage de la pensée qui, dans Par autan, bifurque et souffle dans tous les azimuts pourvu qu’ils soient un territoire de sensations vives, de vies vraies, de bribes de questionnements sincères filés d’une création à l’autre.
Le théâtre de Tanguy relève peut-être seulement de cela : une sincérité inextanguyble.
Aussi, à mi-parcours de Par autan, quand le Crainte et tremblement de Kierkegaard est en partie convoqué (texte qui questionne la foi et le geste sacrifiant d’Abraham vis-à-vis de son fils Isaac), c’est cette sincérité qui est encore à l’œuvre.
Sincérité qui prend la forme des chevaliers : le chevalier de la foi et le chevalier de la résignation dont Kierkegaard rappelle que « le chevalier de la foi est le seul heureux, l’héritier direct du monde fini, tandis que le chevalier de la résignation est un étranger vagabond ».
Figures de chevaliers qui ont hanté tes créations, François. Que l’on a vu casqué, épée à la main, sur des montures grotesques, parfois Richard III ou sortis de nulle part, etc. Chevaliers omniprésents et défigurés, renouvelés sans cesse. Je pense, François, que tu auras été ta vie durant « le Chevalier de la résignation », l’étranger vagabond écrit Kierkegaard qui en fera aussi, pour le définir, un danseur lequel connaît le repos, la paix et la consolation dans la douleur. Ton théâtre, François, t’a réconcilié sans doute avec la vie, mais jamais avec la vue de la vie.
« Arrête tes buvardages » me dirais-tu. Alors j’arrête. Je t’embrasse.
ps : on lira avec attention la conversation entre Laurence Chable et Olivier Neveux publiée sous le titre Laurence Chable, La voix sur l’épaule. Dans les passées de François Tanguy, éditions Théâtrales. Notamment l’hommage à Jean-Luc Nancy écrit par François Tanguy. Un temps, nous avons songé parodier celui-ci…